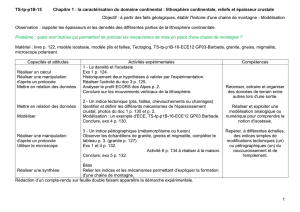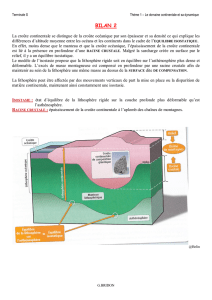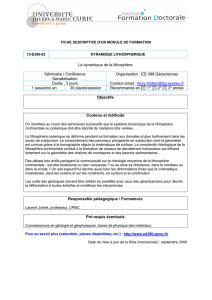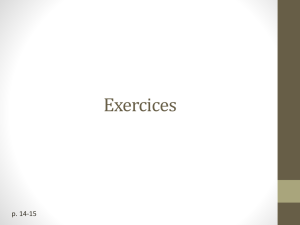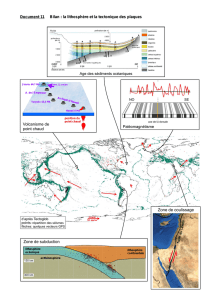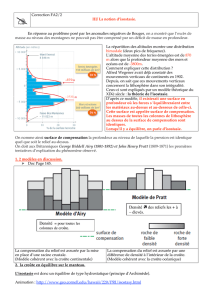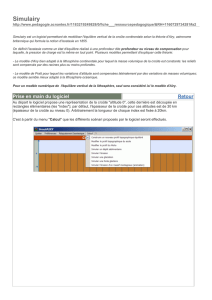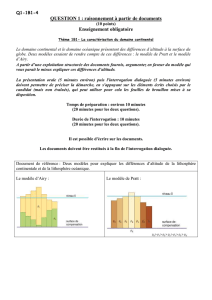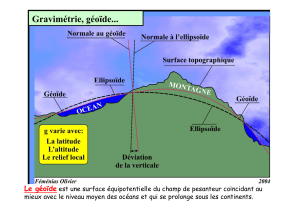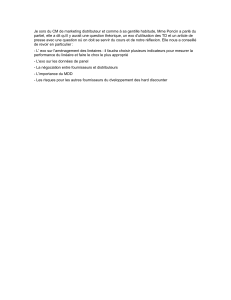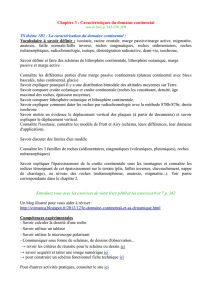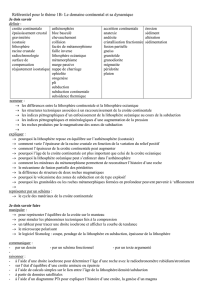TS-tp-p1B-11-CC mecanismes

TS-tp-p1B-11 Chapitre 1 : la caractérisation du domaine continental : lithosphère continentale, reliefs et épaisseur crustale
1
Objectif : à partir des faits géologiques, établir l'histoire d'une chaîne de montagnes - modélisation
Observation : rappeler les épaisseurs et les densités des différentes parties de la lithosphère continentale.
Problème : quels sont indices qui permettent de préciser les mécanismes de mise en place d'une chaîne de montagnes ?
Matériel : blouse, livre p. 122, modèle isostasie, logiciel SimulAIRY (FT 21), plis, failles et compression (sable ou plâtre), TectoGlob, TS-tp-
p1B-11-ECE-Barbade, granite, gneiss, migmatite, microscope polarisant, poly.
Capacités et attitudes
Activités expérimentales
Compétences
Réaliser un calcul
Réaliser une manipulation
d'après un protocole
Utiliser un logiciel de simulation
Mettre en relation des données
Mettre en relation des données
Modéliser
Réaliser une manipulation
d'après un protocole
Utiliser le microscope
Mettre en relation des données
Réaliser une synthèse
1 - La densité et l'isostasie
Exo 1 p. 124.
Historiquement 2 hypothèses (expliquer les différences doc 2 p. 125).
Valider par l'expérimentation, réaliser l'activité du doc 3 p. 125.
Utiliser SimulAIRY (voir FT 21).
Analyser le profil ECORS des Alpes p. 2.
Conclure sur les mouvements verticaux de la lithosphère.
2 - Un indice tectonique (plis, failles, chevauchements ou charriages)
Identifier et définir les différents mécanismes de l'épaississement
crustal, photos du doc 1 p. 130 et p. 2.
Modélisation : un exemple d'ECE, TS-tp-p1B-11-ECE12 GP03 Barbade.
Conclure, exo 4 p. 130.
3 - Un indice pétrographique (métamorphisme ou fusion)
Observer les échantillons de granite, gneiss et migmatite, compléter le
tableau p. 3. (granite p. 127).
à réaliser à la maison.
Exo 1 et 4 p. 132 + Activité 6 p. 134 + exo 5 p. 132.
Bilan
Relier les indices et les mécanismes permettant d'expliquer la formation
d'une chaîne de montagnes.
Recenser, extraire et organiser
des données de terrain entre
autres lors d'une sortie.
Réaliser et exploiter une
modélisation analogique ou
numérique pour comprendre la
notion d'isostasie.
Repérer, à différentes échelles,
des indices simples de
modifications tectoniques (un)
ou pétrographiques (un) du
raccourcissement et de
l'empilement.
Rédaction d’un compte-rendu sur feuille double faisant apparaître la démarche expérimentale.

TS-tp-p1B-11 Chapitre 1 : la caractérisation du domaine continental : lithosphère continentale, reliefs et épaisseur crustale
2
1 - La densité et l'isostasie : profil ECORS des Alpes
2 - Un indice tectonique (plis, failles, chevauchements ou charriages)
Lodève (sud Massif central)
Nappe des flyshs à helminthoïdes (Alpes)

TS-tp-p1B-11 Chapitre 1 : la caractérisation du domaine continental : lithosphère continentale, reliefs et épaisseur crustale
3
3 - Un indice pétrographique (métamorphisme ou fusion)
Granite
Gneiss
Migmatite
Croquis
Couleur
Taille des minéraux
Nature des minéraux
Disposition des minéraux
Roche d'origine
Mécanisme de formation
Type de roche
1
/
3
100%