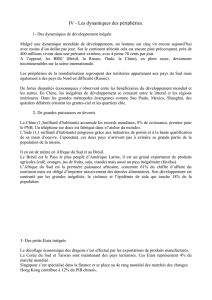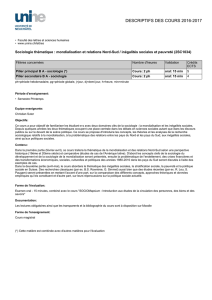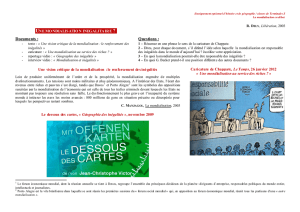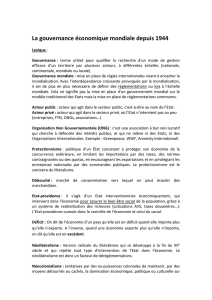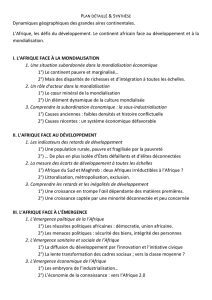Module 3. La mondialisation économique et financière Partie 1 La

ESH 2 Camille Vernet
Nicolas Danglade 2016-2017
1
Module 3. La mondialisation économique et financière
Partie 1 La dynamique de la mondialisation
Chapitre 2. L’analyse économique des échanges internationaux
1. Les déterminants des échanges internationaux : comment expliquer le contenu des
échanges commerciaux entre les pays ?
1.1 Pourquoi les économies nationales se spécialisent-elles ?
1.1.1 La réponse des théories « traditionnelles » du commerce international : la spécialisation
découle des avantages comparatifs de chaque nation
Document : les piliers de l’explication traditionnelle, la nation et les avantages comparatifs
La première explication du commerce international est due à Adam Smith qui fonde les échanges
internationaux sur des avantages absolus en coût : un pays exporte s’il produit moins cher que les autres. Cette
analyse comporte une limite évidente : une nation ne disposant d’aucun avantage absolu ne peut participer à
l’échange international. Les théories traditionnelles, celle de Ricardo et du modèle HOS, en dépit de leurs
différences considérables (…) reposent sur deux piliers communs : une définition identique de la nation et le
recours au principe des avantages comparatifs. (…) A priori, la nation n’est pas un concept de l’analyse
économique : celle-ci s’intéresse en effet à des agents économiques qui sont différenciés par leurs rôles dans
l’échange et dans la production et qui peuvent être, dans la théorie classique, les capitalistes, les propriétaires
terriens, les salariés, ou dans la théorie néoclassiques, les producteurs ou les consommateurs. La nation se situe
à un niveau de représentation des faits économiques différents : il s’agit d’une entité qui regroupe les
différentes catégories d’agents économiques afin de comprendre les échanges qui se nouent entre ces blocs
d’agents, considérés comme des entités. (…)
La conception de la nation de Ricardo en 1817 est la suivante : la nation est l’espace au sein duquel les capitaux
peuvent se déplacer sans entrave d’un emploi à l’autre ; en revanche, la mobilité internationale des capitaux est
supposée impossible. (…) Il est remarquable que l’analyse ultérieure d’HOS, postérieure de plus d’un siècle à
la théorie de Ricardo, repose sur une définition de la nation de même nature. Dans ce contexte, la nation est
définie, comme un « bloc de facteurs de production » qui se déplacent librement au sein du territoire national,
mais qui ne peuvent, du moins dans la théorie de base, se déplacer entre les nations. (…) A chaque nation sont
associées des caractéristiques particulières qui permettent d’expliquer quels sont les biens produits et donc
quels sont les biens exportés, d’une part, et quels sont les biens importés, d’autre part.
C’est là l’enjeu de l’explication de la spécialisation internationale.
Source : Michel Rainelli « La nouvelle théorie du commerce international », La Découverte, 2003, p. 9-10
1.1.1.1 L’origine des avantages comparatifs chez David Ricardo : les écarts de technologie entre
pays
Document : les hypothèses du modèle de Ricardo
Les capitaux sont supposés mobiles à l’intérieur d’un pays et immobiles entre les pays.
La production a lieu à rendements d’échelle constants.
La valeur d’échange des biens s’établit selon la théorie de la valeur travail. La valeur d’un bien est constituée
par le travail nécessaire à sa production. (…) Cela implique que le prix relatif entre deux marchandises est
déterminé par les quantités relatives de travail nécessaires à leur élaboration.
Au sein d’un même pays, les techniques sont différentes selon les biens ; entre pays, les techniques sont
différentes pour la fabrication d’un même bien. Cette hypothèse montre bien que les différences entre pays sont
d’ordre technologique.
Source : Mathilde Lemoine, Philippe Madiès et Thierry Madiès, « Les grandes questions d’économie et de finance
internationales », De Boeck, 2007, p.59

ESH 2 Camille Vernet
Nicolas Danglade 2016-2017
2
1.1.1.2 L’origine des avantages comparatifs dans le modèle HOS : les écarts de dotations
factorielles entre pays
Document : le théorème d’Ohlin, démonstration
Supposons que le pays A soit relativement mieux doté en capital par rapport au travail et que le pays B soit
mieux doté en travail (plutôt qu’en capital). Le facteur capital est donc relativement (par rapport au facteur
travail) plus abondant dans le pays A que dans le pays B. Cette abondance relative conduit à ce que le prix
relatif du capital par rapport au travail soit plus faible dans la pays A que dans le pays B.
Si K : quantité de capital en A ; K* : quantité de capital en B
Si L : quantité de travail en A ; L* : quantité de travail en B
Si w : salaire en A ; r : prix de capital en A ; w* : salaire en B ; r : prix du capital en B
Alors, on peut écrire :
Le facteur capital est relativement plus abondant en A qu’en B :
K/L>K*/L*
Donc, la rémunération relative du capital (par rapport au travail) est plus petite en A qu’en B :
r/w < r*/w*, qui peut s’écrire aussi w/r > w*/r*
Supposons par ailleurs que la production de voitures soit intensive en capital et celle de textile intensive en
travail. En autarcie, cela se traduit par le fait que les prix relatifs des deux biens sont distincts dans les deux
pays : le prix relatif des voitures par rapport au textile est plus faible en A qu’en B. Le prix relatif du textile par
rapport aux voitures est plus faible en B qu’en A. Le pays A bénéficie donc d’un avantage comparatif à
produire des voitures et le pays B à produire du textile même s’ils produisent les deux biens. (…)
Le théorème d’Ohlin des avantages comparatifs s’énonce de la façon suivante : un pays a un avantage
comparatif dans la production qui est intensive dans le facteur de production dont il est relativement le mieux
doté. Source : Mathilde Lemoine, Philippe Madiès et Thierry Madiès, « Les grandes questions d’économie et de finance
internationales », De Boeck, 2007, p. 62
Document : en résumé, les explications de la théorie traditionnelle des différences de prix relatifs
Sur quoi reposent les différences de prix relatifs des biens entre pays ? Les théories traditionnelles du
commerce international (classique et néoclassique) ont proposé des explications, se situant dans une logique de
l’offre, en se focalisant sur des différences de coût de production des biens entre pays. On arrive alors à une loi
des avantages comparatifs ou des coûts comparatifs. (…) Pour Ricardo, la loi des avantages comparatifs et la
spécialisation internationale qui en découle se fondent sur des différences technologiques conduisant à des
différences de productivité du travail. Dans le modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson ce sont des différences de
dotation en facteurs de production entre les pays qui sont primordiales. (…) Sans échanges, pas de division
internationale du travail ni de spécialisation et sans spécialisation pas d’augmentation de la productivité.
L’échange international est un substitut au progrès technique, source de croissance, et un moyen de le stimuler.
Source : Mathilde Lemoine, Philippe Madiès et Thierry Madiès, « Les grandes questions d’économie et de finance
internationales », De Boeck, 2007, p. 56
1.1.1.3 Un dépassement critique avec les travaux de Léontieff
Document : expliquer le paradoxe de Léontieff
Dans « Domestic production and foreign trade : the American capital position re-examined » (1953), Wassily
Léontief se propose de tester le théorème HOS. Permet-il de comprendre les données de 1947 du commerce
extérieur des Etats-Unis ?
Le facteur de production abondant aux Etats-Unis est le capital. Suivant le théorème HOS, l’économie
américaine devrait donc exporter des biens issus des secteurs à forte intensité capitalistique. Pourtant, les
chiffres démontrent le contraire : les Etats-Unis exportent principalement des biens qui nécessitent un usage
intensif en travail, le facteur de production relativement plus rare. Cette situation est donc paradoxale.
En tentant de résoudre ce paradoxe, Léontieff va permettre d’affiner le théorème HOS en introduisant la plus
grande efficacité du travail américain par rapport au travail du reste du monde. Il note ainsi « que dans toute
combinaison productive, avec une quantité de capital donnée, une année de travailleur américain serait
équivalente à environ trois année de travailleur étranger… le nombre de travailleurs américains doit être
multiplié par trois. » En raison de la plus forte qualification de la main d’œuvre aux Etats-Unis et d’une

ESH 2 Camille Vernet
Nicolas Danglade 2016-2017
3
meilleure organisation du travail, le travail américain est trois fois plus efficace que le travail étranger. Dès lors,
lorsqu’on mesure dotation en travail de l’économie des Etats-Unis, il faut multiplier la population active par
trois. Le facteur de production travail y devient alors le plus abondant.
Le paradoxe de Léontieff souligne donc que la productivité du facteur travail n’est pas identique partout dans le
monde (cf D.Ricardo) ; il convient d’en tenir compte au moment d’appliquer le théorème de HOS.
Source : Eric Keslassy
1.1.1.4 Validation empirique des avantages comparatifs
Document : une validation du modèle HOS (exemple 1)
Source : Matthieu Crozet, Conférence IAE Saint Etienne, janvier 2015
Document : une validation du modèle HOS (exemple 2)
Source : Matthieu Crozet, Conférence IAE Saint Etienne, janvier 2015

ESH 2 Camille Vernet
Nicolas Danglade 2016-2017
4
1.1.2 Les apports des théories contemporaines du commerce international
1.1.2.1 Les théories compatibles avec les théories « traditionnelles »
1.1.2.1.1 Les économies situées à la frontière technologique ont un avantage comparatif
Document : l’approche néo-technologique, M.Posner
Dans la continuité des théories traditionnelles du commerce international, l’ambition de cette approche est de
montrer que l’origine des différences de productivité entre les pays repose en premier lieu sur le niveau de la
technologie utilisée. Les échanges internationaux s’expliquent alors par une spécialisation fondée sur des écarts
technologiques.
Cette théorie se situe dans la continuité des travaux de Ricardo. Ainsi, l’origine des différences de productivité
entre pays se trouve dans des différences de technologie utilisée. Mais cette approche explique les échanges
internationaux directement en termes d’écarts technologique : les pays en avance technologiquement possèdent
un avantage comparatif dans la production de de biens qui nécessitent l’utilisation de cette technologie ; dans
un premier temps, les pays en retard technologique ne peuvent faire autrement que de les importer.
Dans « International trade and Technical Change » (1961), Michael Posner s’appuie sur cette logique et montre
que les entreprises innovatrices détiennent un avantage comparatif qui favorise leur production à l’échelle
internationale : disposant d’une avance sur les autres entreprises, elles exportent plus facilement. Il s’agit bien
sûr d’une position temporaire car les productions innovantes sont immanquablement copiées. Par conséquent,
rester dans une situation avantageuse, suppose de toujours procéder à des investissements en recherche et
développement. Cette approche néo-technologique se différencie donc nettement des théories traditionnelles du
commerce international dans la mesure où, d’une part, il est possible de construire ses avantages comparatifs et,
d’autre part, que la spécialisation est pensée de façon dynamique.
Partant de l’idée de Posner, Raymond Vernon (« International Investment and International Trade in the
Product Cycle », 1966) complexifie cette vision du commerce international en introduisant la théorie du cycle
de vie du produit (et en tenant compte de l’évolution de la demande).
Au départ, un pays possède un avantage comparatif fondé sur une innovation (liée à un effort préalable en
termes de recherche et de développement). Elle est donc la première – et la seule – à pouvoir produire ce bien
(ou à se servir d’une technologie). Bien sûr, dans un premier temps, les produits innovants sont faiblement
demandés au niveau national et international. A la naissance du produit (phase d’ « introduction »), les
quantités fabriquées sont donc limitées. Et les exportations sont faibles. L’objectif est d’abord de convaincre les
consommateurs à haut revenu du marché national.
Mais le marché domestique ne peut plus suffire. Il devient important de trouver des consommateurs ailleurs, ce
qui suppose d’augmenter les quantités produites. Le prix du produit peut baisser. Dans cette phase de «
croissance », les exportations se développent depuis le pays à l’origine de l’innovation (« pays leader » – à
l’instar des Etats-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale), en premier lieu vers les consommateurs
des « pays suiveurs (comme l’Europe). Mais plus les marchés extérieurs deviennent essentiels, plus le produit
se banalise. Il atteint sa « maturité ». La firme innovatrice doit alors faire face à la concurrence des firmes
étrangères (qui se sont appropriées la technologie). Dès lors, l’économie innovante exporte beaucoup moins –
la bataille pour acquérir des parts de marché fait rage – ce qui incite ses entreprises à s’implanter dans les pays
nouvellement consommateurs du produit. Par ailleurs, les pays en voie de développement commence à avoir
accès au produit et l’importe.
Dans la phase de « déclin » du produit, lorsque la technologie est complétement banalisée et que la concurrence
ne se fait plus que par les coûts de production, les filiales sont délocalisées et s’installent dans les pays en voie
de développement. Le produit est donc fabriqué dans les économies à faible coût du travail au moment où il
rapporte le moins de profit. Au bout du cycle de vie du produit, la production peut complétement cesser dans le
pays d’origine : le produit est alors importé (à bas prix) pour satisfaire ses consommateurs.

ESH 2 Camille Vernet
Nicolas Danglade 2016-2017
5
Le cycle de vie du produit de Vernon :
Cette approche néo-technologique se situe en rupture avec les modèles traditionnels car elle montre que l’Etat
est un acteur essentiel de la croissance économique : en favorisant la recherche et développement, en
investissant dans le capital humain, il peut construire des avantages comparatifs.
1.1.2.1.2 Le niveau de capital humain d’une économie fournit des avantages comparatifs
Document : l’approche néo-factorielle, R.Findlay et H.Kierzkowski
Se situant résolument dans la continuité des théories traditionnelles du commerce internationale, cette approche
parvient à affiner la proposition de Léontieff qui consiste à tenir compte de l’hétérogénéité des facteurs de
production pour déterminer les spécialisations des pays.
Ronald Findlay et Henryk Kierzkowski (International Trade and Human Capital : A Simple General
Equilibrium Model, 1983) mettent ainsi en avant l’importance du capital humain dans le niveau de productivité
d’une économie et dans la définition des spécialisations. A leurs yeux, un pays qui possède une abondance
relative en capital humain se spécialise dans la production de biens nécessitant du travail qualifié ; il les exporte
et importe prioritairement des biens usant du travail non qualifié. On reconnait ici une reformulation de la
division internationale du travail « classique » : les pays du nord qui investissent dans l’éducation échangent
avec des pays du sud qui n’ont pas les mêmes priorités.
1.1.2.1.3 Les échanges intra-branches verticaux : la spécialisation sur des niveaux de gammes
différents
Document
Les échanges intrabranches correspondent à des échanges de produits identiques. On distingue cependant les
échanges intrabranches horizontaux et les échanges intrabranches verticaux. Dans le premier cas, les pays
échangent des produits identiques de même niveau de gamme mais qui possèdent des caractéristiques
différentes. Dans le second cas, les pays échangent des produits identiques mais de niveaux de gammes
différents. C’est ce second cas qui nous intéresse. Selon leurs avantages comparatifs, les pays vont se
spécialiser sur un niveau de gamme donné : des pays qui possèdent relativement plus de travail qualifié se
spécialise sur des niveaux de gammes élevés d’un produit et délaissent les niveaux de gammes inférieurs. La
spécialisation des économies est donc compatible avec l’échange intra-branche, lorsque celui-ci est vertical.
Document : commerce intrabranche vertical et écarts de dotations factorielles
Comme les consommateurs ont un goût pour la variété, il existe un commerce international intra-branche. (…)
La part croissante des échanges qui prennent place entre les pays industrialisés peut être comprise comme du
commerce entre pays qui, globalement sont identiques (en ce qui concerne le revenu, la demande, la
technologie …) (…). Ces échanges peuvent être analysés comme résultant du goût des consommateurs pour la
variété. (…) Les variétés produites nationalement et à l’étranger n’étant pas les mêmes, il est facilement
compréhensible qu’il existe des flux simultanés d’exportations et d’importations pour un bien donné. La
différenciation est dite horizontale lorsque les produits présentent la même qualité mais sont distingués en
raison de leurs caractéristiques réelles ou perçues. Elle est verticale lorsque les consommateurs sont confrontés
à des produits qui sont de qualités différentes. (…) Dans le cas de la différenciation verticale, les
consommateurs ont des goûts identiques, mais pour un bien donné il existe un éventail de qualités distinctes.
(…) La forme précise des échanges internationaux dépend des répartitions nationales des revenus : le pays avec
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%