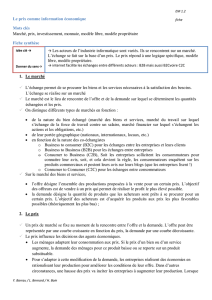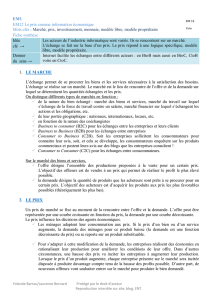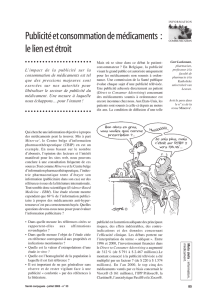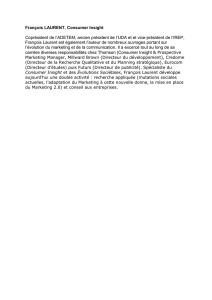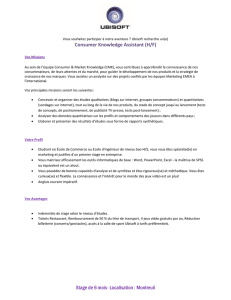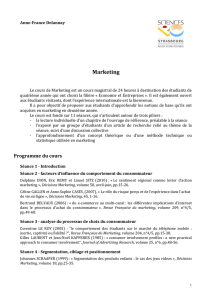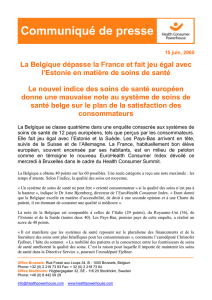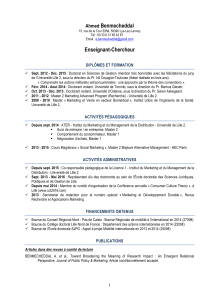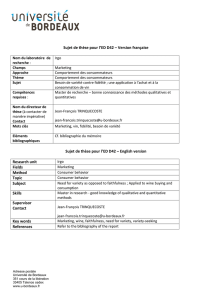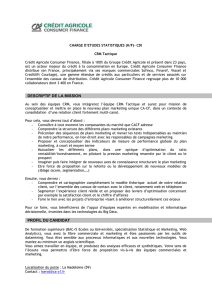Premiers tests cross-culturels de la validité prédictive de l`échelle de

Session 11 - 20
Premiers tests cross-culturels de la validité prédictive de l’échelle
de mesure du comportement de résistance à la publicité
Patrice Cottet
Maître de Conférences
Université de Reims/IUT de Troyes
9 rue de Québec BP 296 10026 Troyes Cedex
Jean-Marc Ferrandi
Professeur
ONIRIS
LARGECIA
Rue de la Géraudière BP 82225 44322 Nantes Cedex 3
Marie-Christine Lichtlé
Maître de Conférences
Université de Bourgogne
CERMAB-LEG Pôle d’Economie et de Gestion
2 Bd Gabriel BP 26611 21066 DIJON cedex
Résumé : Cet article poursuit un double objectif. Dans un premier temps, une analyse critique
est menée et une définition de la résistance à la publicité est proposée. En second lieu, après le
test de l’échelle du comportement de résistance à la publicité au moyen d’analyses factorielles
confirmatoires, un modèle PLS multi-groupes montre l’influence de la résistance à la publicité
tant en France qu’en Suisse sur le non-achat et le bouche-à-oreille négatif.
Mots clés : résistance à la publicité, analyse factorielle confirmatoire, modèle PSL multi-
groupes, non-achat, bouche-à-oreille négatif.
First cross-cultural tests of the predictive validity of the resistance behavior to
advertising scale.
Abstract: The purpose of this article is double. First, a critical review and a definition of the
concept of resistance toward advertising have been realized. Secondly, after a test of the
resistance behavior to advertising scale by means of confirmatory factor analysis, a multi-
group PLS path modeling shows the effect of the resistance to advertising on no-buying and
on negative word-of-mouth in France and Switzerland.
Key words: resistance to advertising, confirmatory factor analysis, multi-group PLS path
modeling, no-buying, word-of-mouth.

Session 11 - 21
Premiers tests cross-culturels de la validité prédictive de l’échelle
de mesure du comportement de résistance à la publicité
L'intensification de la pression publicitaire sous ses diverses formes ainsi que la multiplication
et la fragmentation des médias conduisent les consommateurs à être exposés quotidiennement
à des milliers de messages publicitaires (Gritten, 2007). Les sentiments d'encombrement,
d'intrusion, d'irritation sont amplifiés par ce contexte inflationniste entrainant une attitude
négative vis-à-vis de la publicité et générant des comportements d'évitement plus ou moins
intenses (Krugman et Johnson, 1991). Ainsi, une étude identifie que 60% des consommateurs
américains se détournent du marketing et évitent la publicité (Marion et Portier, 2006). En
quarante ans, la proportion de ces consommateurs qui jugent négativement la publicité est
passée de 14% à 36% (Darke, 2004). Par ailleurs, l'intensification de cette tendance est plus
que probable dans la mesure où, selon Campbell (1995), le public jeune développe une plus
grande méfiance face aux intentions et aux techniques de communication des firmes. Ce point
est confirmé par la recherche de Martin et Okleshen (2005), qui démontre la capacité de
décodage des stratégies publicitaires de jeunes consommatrices.
Si ces attitudes et ces comportements sont originellement consubstantiels au développement
des communications publicitaires, il semble que se développent des phénomènes de rejet de la
publicité que n'appréhendent pas les concepts d'intrusion, d'évitement et d'attitude vis-vis de la
publicité. Il s'agit de la résistance à la publicité. Le concept de résistance, stricto sensu,
constitue désormais un axe de recherche formalisé (Roux, 2007) et couvre de multiples
domaines (vente par téléphone, relation à la marque, etc.). Il est toutefois surprenant de
constater que les travaux consacrés à la publicité restent embryonnaires. Or, par sa dimension
symbolique (les mouvements anti-pub en constituent une illustration), par sa dimension
stratégique (la création de l'imaginaire de la marque) et par sa dimension économique (les
investissements publicitaires restent une charge significative dans la structure des coûts) la
publicité cristallise de nombreux enjeux qui conditionnent la réussite de la démarche
marketing. De plus, progressivement, la crédibilité de tous les dispositifs de communication
utilisés par les entreprises, y compris les plus discrets et les plus personnels, est affectée
(Kelly, Kerr et Drennan, 2010)
Parmi les interrogations relatives à la résistance à la publicité, nous retiendrons, dans le cadre
de cet article, deux thèmes d'investigation :
- Quel est le pouvoir prédictif des échelles de mesure disponibles ?
- Le comportement de résistance à la publicité présente-t-il des différences selon
l’origine culturelle des consommateurs ?
Cet article s’articulera en deux parties. En premier lieu, le cadre conceptuel de la résistance à
la publicité sera précisé, notamment par rapport aux concepts proches. Dans un second temps,
la démarche méthodologique et les principaux résultats seront exposés. La conclusion
soulignera les apports, les limites et les voies de recherche qui découlent de cette recherche.
1. La résistance : le cadre conceptuel
Roux (2007) définit la résistance comme « un état motivationnel qui pousse le consommateur
à s’opposer à des pratiques, des logiques ou des discours marchands jugés dissonants ». Cette
définition recouvre quatre construits itératifs. Le premier est la propension résistante, c’est à
dire la tendance stable du consommateur à s'opposer à des forces identifiées comme telles.
Roux (2007) suggère de limiter le terme de résistance à son aspect situationnel et non
dispositionnel. Le deuxième construit est l'état motivationnel qui correspond à l'état interne

Session 11 - 22
qui contraint le sujet à diminuer les tensions éprouvées dans un contexte d'oppression
(pratiques jugées dissonantes par exemple). Dans le cas du système marchand, le discours
publicitaire peut constituer, selon les schèmes des consommateurs une activation de cet état
motivationnel. Ainsi, la perception d'une forte dissonance peut déclencher les manifestations
de résistance. Ce troisième construit regroupe les formes de réponses oppositionnelles
spécifiques à chaque contexte déclencheur. Enfin, le quatrième construit, intitulé résistance
cumulée, désigne l'ensemble des cognitions et des émotions négatives sédimentées par le sujet
au cours des situations antérieures et vécues comme des moments de résistance.
Plus précisément, pour qu'il y ait résistance trois conditions sont nécessaires simultanément :
une force doit être exercée sur un sujet, elle doit être perçue et le sujet cherche à annihiler son
impact. Les représentations du sujet jouent un rôle prépondérant dans l'émergence du
processus de résistance. En effet, quand un stimulus heurte ses représentations, l'antagonisme
ainsi créé produit un contexte favorable à l'émergence de la résistance. Ram et Sheth (1989)
soulignent que la stabilité des représentations d’une personne intensifie l'antagonisme. La
dimension affective d'une situation peut également contribuer à l'irruption d'un conflit de
représentations notamment quand ce sont des émotions négatives qui sont éprouvées par le
consommateur vis-à-vis des stimuli (Bagozzi et Lee, 1999). Pour Kates et Belk (2001), la
résistance du consommateur est une résistance à la consommation (et non par la
consommation). Cette perspective de la résistance est plutôt individuelle. Mais des formes de
résistance plus communautaires sont décrites (Peñaloza et Price, 1993) telles que les groupes
contestataires réunis par des formes de contournement du marché (Cottet, Ferrandi et Lichtlé,
2010) ou des agissements plus offensifs, à l'instar des boycotts (Hemetsberger, 2006, Cottet,
Ferrandi et Lichtlé, 2010).
Dans leurs analyses, les auteurs retiennent souvent la partie visible de la résistance, en
l'occurrence ses manifestations sans qu'un consensus ne soit établi. Fournier (1998) suggère
qu'un continuum de comportements allant du spectre de l'évitement discret de certaines
marques à des formes d'actions engagées telles que le boycott, avec des formes médianes
comme la simplicité volontaire consistant à réduire, sans nécessité économique, son volume
de consommation (Cherrier, 2009). Pour Roux (2007), cette approche est à nuancer car seule
la dimension d'intensité structure ce continuum et aucune certitude n'est apportée pour le
justifier et aucun n'élément explicatif de l'origine de ces manifestations n'est proposé.
Dans le registre de l'intensité des manifestations, Hirschman (1970) propose également un
continuum mais où la première phase consiste à exprimer sa résistance auprès de l'entreprise
(Voice). La prise en compte de cette plainte laisse penser que la résistance sera éphémère. A
l'opposé, la posture du consommateur sera durable en ne manifestant pas son opposition mais
en cessant de consommer un produit ou les produits de la firme (Exit). Des réactions plus
viscérales peuvent conduire à des volontés de vengeance (Huefner et Hunt, 2000) ou à des
modes parallèles de consommation réduisant au maximum la dépendance au système
marchand (Hermann, 1993, Ritson et Dobscha, 1999).
1.1. La résistance à la publicité : délimitation du concept
L'application de la résistance au domaine de la publicité impose de préciser ses frontières avec
d'autres concepts proches du champ publicitaire. En effet, les réactions négatives induites par
les pratiques publicitaires (tactiques de persuasion, intensité des messages, émotions générées,
etc..) ont très tôt préoccupé les mondes académique et managérial.
Parmi ces concepts pouvant être reliés, soit comme antécédents, soit comme conséquences
supposées à la résistance à la publicité, la résistance à la persuasion, l'irritation, l'intrusion,
l'évitement, l'attitude négative vis-à-vis la publicité constituent des éléments majeurs à
intégrer dans l'identification de possibles divergences et/ou convergences.

Session 11 - 23
La résistance à la persuasion
La résistance à la persuasion peut être définie comme « le maintien d’une attitude malgré les
tentatives de persuasion » (Tormala et Petty, 2004). Elle a deux principales sources : la
première est motivationnelle (les menaces contre l’image de soi ou une perte de liberté), la
seconde est cognitive (toute tentative de persuasion décodée comme un déséquilibre potentiel
conduit à de la résistance). En se centrant sur le système de croyances des individus, le
modèle PKM (Persuasion Knowledge Model) de Friestadt et Wright (1994) permet
d'appréhender la manière dont les individus décryptent les tactiques publicitaires. Ce modèle
intègre les effets d’expérience que le consommateur accumule au cours du temps et
s’intéresse au mode de représentation du marché. Les deux acteurs en relation, les cibles et les
publicitaires, développent chacun des schémas mentaux en vue d’optimiser leurs pratiques
avec des effets d’asymétrie fluctuants. Même si les connaissances du consommateur ne lui
permettent pas de déceler tout le processus persuasif, il sera capable de repérer l’élément lui
signalant l’intention du publicitaire. Par exemple, une émotion voulue par l’annonceur sera
ressentie pendant l’exposition, puis corrigée ensuite par les consommateurs lorsqu’ils
accèdent à leurs connaissances en persuasion (Cotte et Ritchie, 2005, Ahluwalia, 2000).
Nous avons ici repris les principaux résultats des travaux sur la résistance à la persuasion. Ils
sont variés, peu cumulatifs, et surtout, n’ont pas toujours choisi la persuasion publicitaire
comme champ d’application. C’est l’une des raisons pour lesquelles il nous est apparu
important de nous intéresser plus particulièrement à la résistance à la publicité. En effet, La
résistance à la publicité peut se manifester par un comportement qui dépasse le simple
maintien de l’attitude. C’est la première différence avec la résistance à la persuasion. Par
ailleurs, les caractéristiques de la résistance à la persuasion identifiées par Knowles and Linn
en 2004 (l’inertie, la réactance, la méfiance et la vigilance) ne couvrent pas l’ensemble des
manifestations de la résistance à la publicité. Certains consommateurs développent en effet
des « stratégies d’évitement » à la publicité, qui ne sont pas abordées dans la littérature sur la
persuasion.
L'intrusion publicitaire
Li, Edwards et Lee (2002) soulignent que l'intrusion publicitaire est l'une des plaintes
traditionnelles des consommateurs car les messages publicitaires sont perçus comme
perturbant leurs objectifs initiaux. D'ailleurs, l'hypothèse selon laquelle la communication
publicitaire présente dans les nouveaux médias serait perçue comme moins intrusive (Rust et
Varki, 1996) n'a pas résisté au test du réel. Dès que les consommateurs ont un objectif à
atteindre (utilitaire ou hédonique), ce qui est fréquemment le cas avec les médias
électroniques, les publicités sont perçues comme plus intrusives que dans les autres médias
non électroniques car elles interférent avec leurs tâches (Reed, 1999). La contrainte de temps
pour une accomplir une tâche et l'effet inattendu de la publicité intensifieront la perception de
l'intrusion.
Ha (1996) définit l'intrusion publicitaire comme le degré avec lequel une publicité interrompt
le flux d'un programme. En d'autres termes, c'est la conséquence psychologique qui survient
lorsque les processus cognitifs d'une audience sont interrompus (Li, Edwards et Lee, 2002).
L'intrusion serait l'antécédent de l'irritation face à la publicité, ce qui conduirait à l'évitement.
Notons que les travaux sur l'intrusion publicitaire se sont focalisés sur des publicités
spécifiques, analysées à l'aide de protocoles expérimentaux, ce qui ne traduit pas une posture
de résistance éphémère ou durable vis-à-vis de la publicité. En ce sens, Li, Edwards et Lee
(2002) rappellent que l'identification d'oppositions à des tactiques, des contenus publicitaires

Session 11 - 24
peut s'accompagner, contre intuitivement, de la reconnaissance de l'utilité de la publicité
comme moteur économique et comme institution.
Dans la résistance à la publicité, l'unité d'analyse est la publicité dans son acception générale
et non des publicités spécifiques. L'hypothèse centrale est que cette opposition globale va se
répercuter sur le comportement de visionnage des publicités en développant des stratégies
défensives (distanciation vis-à-vis du contenu, zapping, fuite physique, hostilité forte, etc…),
sans que nécessairement des arguments détaillés sur telle ou telle campagne de publicité
précise justifient cette position. L'intrusion, par son effet cumulatif, pourrait être un
antécédent, via l'évitement, de la résistance à la publicité. En relation avec la définition de la
résistance, le concept de l'intrusion illustre parfaitement la reconnaissance d'une force exercée
sur les individus mais n'enclenche pas automatiquement des manifestations d'opposition,
condition théorique nécessaire, à la conception de la résistance (Roux, 2007).
L'irritation
Une publicité irritante est celle qui engendre du déplaisir et de l'impatience momentanée
(Aaker and Bruzzone, 1985). Les sources d'irritation sont liées au contenu de la publicité (le
contenu est perçu comme mensongé, exagéré, confus et manquant de finesse intellectuelle),
aux modes d'exécution (les codes esthétiques sont jugés trop lourds) et à l'intensité
publicitaire (le seuil d'acceptation du consommateur est dépassé par le nombre de publicités
ou le passage répétitif d'une même publicité). Le type de produit vanté ou la perte de contrôle
perçu peuvent également engendrer une forte irritation. Ainsi, le consommateur ne maîtrisant
plus son environnement informatique à cause de l'apparition inopinée de multiples pop- up
sera dans cette situation d'irritation (De Pelsmacker et Van den Bergh, 1998). L'irritation est
une conséquence de l'intrusion et, à l'instar de ce concept, ne conduit pas mécaniquement au
développement de comportements de résistance bien qu'il puisse devenir, également par des
effets cumulatifs, un déclencheur de résistance à la publicité sous toutes formes. Toutefois, les
conséquences de l'irritation peuvent ne pas influencer le comportement. Ainsi, van Diepen,
Donkers et Franses (2009) ont démontré, dans l'analyse de donateurs à des œuvres de charité,
que les meilleurs contributeurs, par effet de sélection, étaient submergés par les publicités les
sollicitant intensément. L'irritation a été mesurée comme très présente, mais les
comportements de dons n'ont pas été affectés par le niveau élevé de l'irritation publicitaire. Si
la spécificité du domaine interdit une généralisation hâtive aux produits de grande
consommation (le sentiment de culpabilité ou de responsabilité sociale étant plus fort que
l'irritation lors de dons), il convient néanmoins de s'interroger sur la labilité du sentiment
d'irritation vécue au moment des comportements d'achat ou/et de consommation et de son
impact sur les formes de résistance à la publicité dans un cadre plus traditionnel.
La résistance à la publicité et les actions tendant à éviter la publicité
En raison des sentiments d'intrusion et d'irritation, les consommateurs vont chercher à éviter
durablement ou non la pression publicitaire. Pour Speck et Elliot (1997) cela se traduit par
« toutes actions choisies par les utilisateurs des media qui réduisent leur exposition à la
publicité »1. Les stratégies d'évitement que les consommateurs vont déployer peuvent
s'articuler autour de trois voies (Speck et Elliot, 1997) :
- une voie cognitive (on choisit d’ignorer une publicité dans un magazine),
- une voie comportementale : quand l’individu commence une nouvelle activité pendant les
publicités (il parle à quelqu’un d’autre ou quitte la pièce),
1 “all actions by media users that differentially reduce their exposure to ad content”
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%