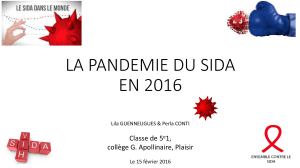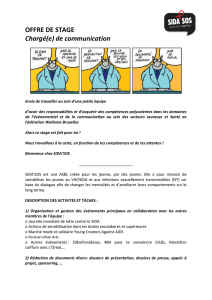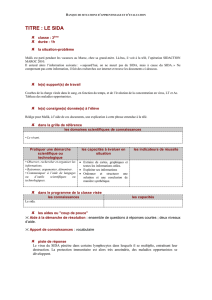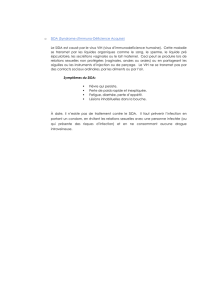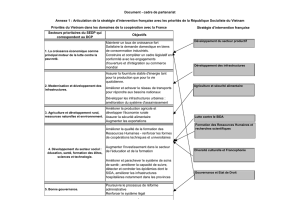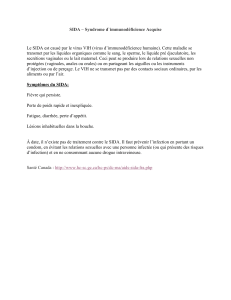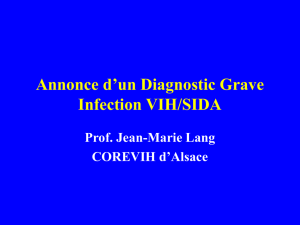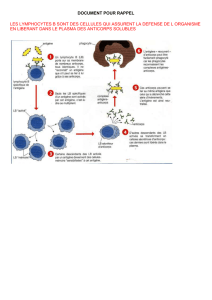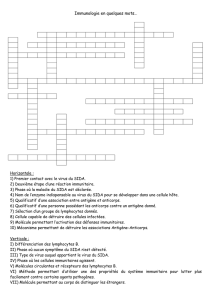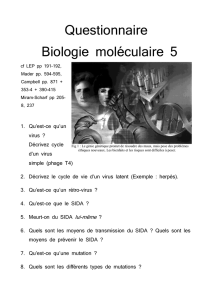Sida et croissance économique en Afrique

1
SIDA et croissance économique en Afrique
-Drouhin#, Touzé*, Ventelou*-
Résumé :
On peut présenter la littérature sur la question de l’impact macroéconomique du SIDA de plusieurs
manières : en différentiant les études par les canaux qu’elles sollicitent (section 1), en différentiant les
études par les modèles du développement qu’elles utilisent (section 2). On peut ensuite tenter de
construire un « modèle » qui synthétise ces différentes approches, autorisant de ce fait une étude
comparée des outils de prospective de l’impact du SIDA dans une économie en développement
(section 3). Le résultat de ce travail est que les modèles de croissance endogène, en multipliant les
variables de productivité comme moteurs potentiels du développement, produisent des diagnostics à la
fois plus riches et plus précis d’un choc épidémiologique tel que le SIDA dans les PED. Par exemple
(section 4), nous faisons apparaître une non-linéarité et le risque d’un effet persistant du choc du SIDA
sur le développement, chose que ne pouvait faire apparaître un modèle de croissance exogène, basé
uniquement sur une idée de « retard » par rapport à un niveau cible de régime permanent.
# Groupe de recherche sur le Risque, l'Information et la Décision (UMR CNRS 8534),
61, avenue du Président Wilson
94230 Cachan
* OFCE, Fondation Nationale des Sciences Politiques
69 Quai d'Orsay
75340 Paris cedex 07

2
SIDA et croissance économique en Afrique
-Drouhin#, Touzé*, Ventelou*-
Introduction ;
Le SIDA est un choc terrible, humainement bien sûr et peut-être même économiquement.
Certains économistes ne s’y sont pas trompés puisqu’ils ont assez rapidement (début des
années 1990) tenté de donner des évaluations de l’impact économique de l’épidémie :
l’impact serait globalement responsable d’une réduction du taux de croissance des économies
d’environ un point de pourcentage (voir suite : les évaluations portent en général sur le taux
de croissance du PIB par tête). Cependant, le présent travail part de l’hypothèse que de
nouvelles évaluations sont nécessaires : d’une part, la relative précocité des études a pu leur
faire négliger certains effets du SIDA sur les comportements économiques de long terme ;
d’autre part, les modèles d’évaluation qui ont été utilisés pour ce faire peuvent aujourd’hui
être améliorés, grâce une prise en compte systématique de phénomènes de complémentarité
existant dans l’accumulation de facteurs de productivité hétérogènes, phénomènes qu’a
notamment mis en évidence la théorie de la croissance endogène.
Plan :
On peut présenter la littérature sur la question de l’impact macroéconomique du SIDA de
plusieurs manières : en différentiant les études par les canaux qu’elles sollicitent (section 1),
en différentiant les études par les modèles du développement qu’elles utilisent (section 2). On
peut ensuite tenter de construire un « modèle » qui synthétise ces différentes approches,
autorisant de ce fait une étude comparée des outils de prospective de l’impact du SIDA dans
une économie en développement.
Section 1/ L’approche par les « impacts »
Au niveau macroéconomique, l’accumulation de richesse et le développement de l’économie
pourrait se contracter sous l’effet d’une réduction de la productivité moyenne du pays
(réduction de l’espérance de vie et altération de la productivité des travailleurs), mais aussi par
le biais de l’augmentation des dépenses de santé, qui « détournent » les ressources nationales de
leur allocation de long terme ; bien qu’à court terme les dépenses de santé soient comptabilisées
en positif dans le PIB (les soins contribuent au PIB)... Pour y voir plus clair, nous reprendrons
une classification classique : coût direct / coût indirect ; en y ajoutant, cependant, une catégorie
supplémentaire, baptisée coût indirect différé.
1.1 Trois impacts
Les coûts directs. Ces coûts regroupent les dépenses médicales liées au HIV/SIDA :
traitements pour les maladies opportunistes ainsi que l’utilisation éventuelle d’ARV + IP,
# Groupe de recherche sur le Risque, l'Information et la Décision (UMR CNRS 8534),
61, avenue du Président Wilson
94230 Cachan
* OFCE, Fondation Nationale des Sciences Politiques
69 Quai d'Orsay
75340 Paris cedex 07

3
rémunération et formation des personnels médicaux et administratifs, dépenses
d’infrastructures hospitalières, surveillance et sécurité au niveau des transfusions sanguines,
recherche scientifique (auxquels s’intègrent parfois les coûts de prévention). Dans les pays qui
socialisent une partie des revenus sous la forme d’assurance santé ou de redistribution vers les
plus démunis, on peut s’attendre à une augmentation du taux de prélèvement obligatoire pour
faire face à l’accroissement des dépenses médicales. En Afrique, ces coûts, dits directs, vont
essentiellement se traduire au niveau individuel (le revenu des ménages), par une ponction
supplémentaire sur un ‘surplus net après consommation’ déjà excessivement étroit. L’impact
économique du SIDA passera alors essentiellement par le taux d’épargne, avec le mécanisme
suivant :
SIDA = soins = ponction sur l’épargne = moins d’accumulation de capital.
Mais cette « équation » n’est vraie que si le SIDA donne effectivement lieu à des soins ; dans
le cas contraire (maladie non soignée, ce qui est fréquent en Afrique), les effets économiques du
SIDA comme ponction sur l’épargne resteront limités1.
Les coûts indirects. Une personne qui développe le SIDA voit sa capacité productive réduite
car elle tombe régulièrement malade. La réduction de la capacité de travail signifie une baisse
des ressources du ménage si la victime a une responsabilité familiale. Pour les plus pauvres,
cette baisse est d’autant plus insupportable que les maladies opportunistes viennent alourdir la
dépense en soins de santé du ménage (le coût direct). L’impact macroéconomique du SIDA est
donc analysé cette fois par l’offre de travail, avec le mécanisme suivant :
SIDA = invalidité = baisse de la productivité du travail.
Concrètement, les conséquences du SIDA sur le système productif diffèrent selon les
secteurs de production : l’agriculture, le secteur des transports, le secteur minier, le secteur
manufacturier, le secteur public. Il est en effet apparu que l’analyse d’impact variait beaucoup
selon les hypothèses faites sur la prévalence du HIV/SIDA dans les différents segments de la
main-d’œuvre (Selon leur caractère stratégique pour le développement, comptera aussi
l’éventuelle perméabilité des secteurs en termes de flux de main-d’œuvre). Certaines activités
professionnelles sont plus sensibles à la contamination, soit pour des raisons comportementales
(par exemple, dans le secteur des transports où les employés sont souvent loin de leur domicile),
soit pour des raisons d’exposition (par exemple, les professionnels de la santé). Autre effet
différentiel inquiétant : en Afrique, il s’avérerait que la prévalence de la maladie est plus forte chez
les travailleurs qualifiés (pour des raisons culturelles, liées aussi au mode de vie urbain2) ; le
secteur public, qui concentre les travailleurs qualifiés, serait particulièrement touché,
notamment, le secteur de l’éducation (selon l’UNESCO, le SIDA est la première cause de
mortalité des enseignants en Côte d’Ivoire) ; or les enseignants décédés sont difficiles à
remplacer. En général, le décès prématuré d’un travailleur conduit à la disparition d’un savoir
qui ne pourra plus servir à la production ni être transmis. Apparaît donc déjà, dans l’analyse
sectorielle (et avant même l’analyse, plus fine, des stratégies familiales d’accès à l’éducation3), la
1 ...sans compter les effets malthusiens : le choc démographique (négatif) peut avoir paradoxalement un rôle
favorable sur l’économie mesurée en variable par tête (de survivants). C’est ainsi que certaines études comme celle
de Martha Ainsworth et de Mead Over (1994) insistent sur le « coût humain » du SIDA, avec de nombreux décès,
tout en admettant un « coût économique » relativement restreint. Voir aussi le modèle développé par Cuddington
et Hancock (1994).
2 …plutôt que rural pour les moins qualifiés (les travailleurs paysans). Dans le cadre des économies africaines, deux
dualismes (liés) sont importants : le dualisme urbain / rural (agricole), le dualisme travail qualifié / travail non
qualifié ; un troisième dualisme secteur formel / secteur informel serait aussi à prendre en compte. Voir
Cuddington et Hancock (1994), Kambou, Devarajan et Over (1993) et les études menées par l’IIASA (Sanderson et
alii, 2001).
3 Voir ci-dessous, la catégorie « coût indirect différé ».

4
question importante des effets du SIDA sur le « capital humain », considéré aujourd’hui
comme le facteur porteur du développement économique et social.
Les coûts indirects différés. En l’absence d’aide, la baisse de ressources liée au SIDA pourrait
avoir des conséquences différées plus importantes encore, car elle risque de modifier la structure
productive du ménage, et notamment sa fonction « éducative ». Le conjoint non malade (ce qui
paraît souvent peu probable) ou ‘pas encore malade’ va consacrer plus de temps à son travail et
moins à l’éducation des enfants. Les enfants eux-mêmes sont parfois détournés de leur scolarité
et se voient contraints au travail ; le « détour de production » induit par l’accès à l’école paraît
trop coûteux vu l’urgence financière à laquelle fait face le ménage4. Les décès sont également
coûteux, d’autant que les rites funéraires peuvent durer plusieurs jours, nécessitant de facto une
interruption prolongée du travail pour l’ensemble de la famille concernée. Reste le problème
des mineurs survivants aux défunts. Qui va subvenir aux besoins de ces orphelins ? Qui va les
élever et les éduquer ?
L’ensemble de ces réflexions, éventuellement augmentées d’une analyse de la pyramide des âges
d’une population nationale et de sa déformation avec le SIDA (encore plus ‘creusée’ pour les
PED, voir Pison, 2002), converge vers l’idée que le SIDA affecte :
- à court terme, le rapport « actifs–capables de travailler / population totale » d’une
économie ;
- tout en jouant, à long terme, sur la qualité même du travail fourni par le travailleur
représentatif (effet « capital humain »).
Par la suite, nous évoquerons un double effet, quantitatif (court terme) et qualitatif (long
terme), du SIDA sur les économies africaines.
1.2 Quelques évaluations
Différentes études ont été menées pour tenter de mesurer, en terme de points de PNB
perdus, les conséquences économiques du VIH/SIDA. Les principales études fournissent pour
les économies africaines des ordres de grandeur comparables. En moyenne, les auteurs
pronostiquent une réduction de 1 point du taux de croissance de la richesse nationale5. Ces
études sont basées sur une modélisation ad hoc de l’économie, qui va permettre de dégager une
évolution comparée, avec ou sans pandémie de SIDA. L’étude de Bonnel (2000) fournit une
estimation économétrique qui tente de relier les taux de croissance aux taux de prévalence, en
filtrant les autres facteurs explicatifs tels que l’environnement institutionnel, le capital physique
et le capital humain. L’estimation est réalisée pour les économies africaines sur des données
observées entre 1990 et 1997.
4 « Les familles retirent souvent les filles de l’école pour qu’elles s’occupent des parents malades ou assument
d’autres responsabilités familiales, ce qui compromet l’éducation et les perspectives d’avenir de ces jeunes filles. Au
Swaziland, l’inscription a chuté de 36% en raison du SIDA » d’après ONUSIDA-OMS (cf. : Le point sur l’épidémie de
SIDA, ONUSIDA-OMS, décembre 2001).
5 L’impact sur le PIB par tête est plus faible, car le SIDA réduit la taille de la population (effet malthusien).

5
Tableau 1 - Lien entre croissance et taux de prévalence
Taux de
prévalence
Réduction du
taux de
croissance
par tête
(1)
Années perdues
d’espérance
de vie
(2)
5% -0,6 4,7
10% -0,8 9,4
15% -1 14,1
20% -1,2 18,8
30% -1,4 28,2
Sources : (1) : R. Bonnel (2000). (2) : calculs des auteurs d’après les estimations du US Census Bureau, Population
Reference Bureau, et OMS.
Tableau 2 - Réduction du PNB imputable au VIH/SIDA
Pays
Baisse moyenne
du PNB
(en points de
croissance
annuelle)
Période Année Sources/Auteurs
30 pays africains
sub-sahariens
[0,8 ; 1,4] 1990-2025 1992 Over (1992)
Cameroun 21987-1991 1992 Kambou et alii (1992)
Zambie [1 ; 2] 1993-2000 1993 Forgy (1993)
Tanzanie [0,8 ; 1,4] 1991-2010 1991 Cuddington (1992)
Kenya 1,5 1996-2005 1996 Hancock et alli (1996)
Mozambique 11997-2020 2001 Wils et alii (2001)
Dans l’ensemble (et malgré un coût humain effroyable), ces études apportent le diagnostic d’un
choc qui restera d’ampleur économique assez limitée6. D’abord, il faut savoir que les dépenses de
santé (comme les dépenses militaires) sont incorporées dans le PIB : immédiatement, il y a un
effet comptable positif ; même si, plus tard, on peut penser que ces dépenses, réorientées sur
une urgence sanitaire, entravent le processus de développement équilibré. Ensuite, il faut noter
que ces évaluations négligent le plus souvent les effets « indirects différés » (la transmission et
l’accumulation des « capitaux », physiques et humains). En général, le problème des études
précitées est qu’elles ne proposent pas une analyse valable sur la longue durée : c’est sur 5-10 ans que
l’analyse peut revendiquer une réelle validité. Cela pouvait se justifier au début des années 1990,
car, sur la durée, il était difficile de prévoir avec exactitude « l’input » du modèle, à savoir le
choc épidémiologique. Par ailleurs, les études sont en général défaillantes sur l’un des deux
premiers canaux précédemment évoqués. Sur la longue durée, elles négligent les interactions possibles
entre les deux canaux (complémentaires).
6 Une exception notable est celle de Barnett et Blaikie (1992), qui parlent du SIDA comme un désastre de « long
wave », du même ordre que le réchauffement climatique, dans la mesure où les « effets majeurs sont déjà à l’œuvre
bien avant que l’ampleur de la crise ne soit connue » et « aucune réponse déjà existante ne peut être apportée ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%