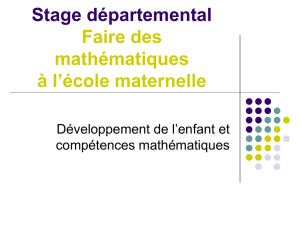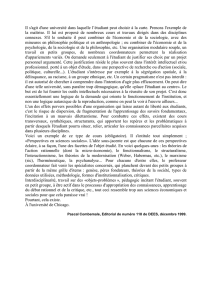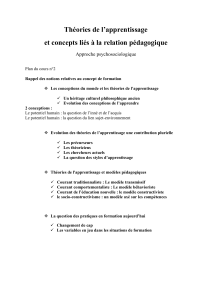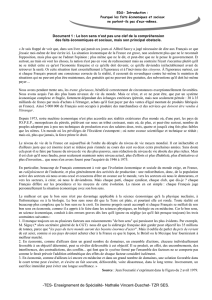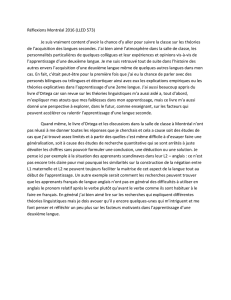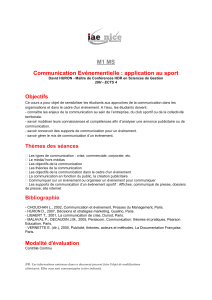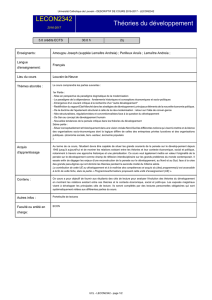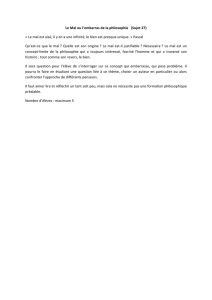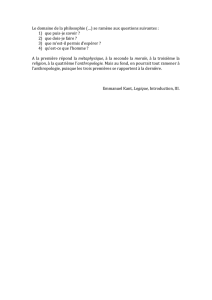L3. Notes de cours, remarques générales sur l`histoire des sciences

!Chapitre!I.!Qu’est0ce!que!l’histoire!des!sciences!?!
!
!"
"
#$"%&'()*" +," -.*,%" +,"/.01%2" -.-" 13+)(3,%" ,*" -.-" 0*)$)%'4$,%" ,-" +,5.1%" +0" /.01%" +0"%,6,%*1," !2"
'--3,"78!7978!:;"
"
"
<.1%" +," $'" +)%/0%%).-" =0)" %0)>')*" 0-," /.-?31,-/," +.--3," @" $&!"#$%&'(&"')%*&+%&""A,--,%"%01"$,"
*5B6,"C"D.66,-*"*1).6E5,"0-,"*53.1),"%/),-*)?)=0,"F"G2"0-"'0+)*,01"6,"?)*"$'"/1)*)=0,"%0)>'-*,"H"
C"I.0%"'>,J"*.1*"+&'>.)1"E'1$3"+,"$'"C"*53.1),"+,"$&3>.$0*).-"+,"K'1L)-"G2"/'1"$&3>.$0*).-",%*"0-"
?')*"13,$"=0,"%,0$"0-")-%,-%3"E,0*"/.-*,%*,12".1">.0%"%0((31,J"=0,"$&3>.$0*).-"E0)%%,"-,"E'%"M*1,"
>1'),",-"$'"=0'$)?)'-*"+,"*53.1),"G;"N,"6,"%.0>),-%"+,"-&'>.)1"E'%"+.--3"0-,"4.--,"13E.-%,",-"
6.-*1'-*"%,0$,6,-*"0-"/,1*')-"'('/,6,-*",*",-"4'$'O'-*"/,**,".4P,/*).-;""
<'"/1)*)=0,"+,"$&)-*,1>,-'-*"3*')*"E.01*'-*"?.-/)B1,6,-*")->'$)+,2"6')%"E.01"+,%"1')%.-%"=0,"P,"
-&')" E'%" Q%01" $," /.0E9" %0" E13%,-*,1;"R-," 4.--," 13E.-%," +.)*" M*1," %.)(-,0%,6,-*" ?.1(3,;" S0"
/.01%"+,"/,**,"/.-?31,-/,2"P&'>')%"'0%%)"E'1$3"+,"$'"C"*53.1),"+,"$'"(1'>)*3"G2".0"+,"$'"/50*,"+,%"
/.1E%",*"E.01*'-*"P,"-,"+.0*')%"E'%"=0&,-"$T/5'-*"6.-"%*O$.2"P,"$&'01')%"?')*"*.64,1"%01"$,"%.$2"E'%"
E$0%"=0,"P,"+.0*,"$,"6.)-%"+0"6.-+,"+,"$&3>.$0*).-"+,%",%EB/,%">)>'-*,%;"
<.1%=0,"P,"E'1$,"+,"$'"*53.1),"+,"$'"(1'>)*32"P,"?')%",-*1,1"$'"/50*,"+,"6.-"%*O$."%01"$,"%.$"($+"'
$&5)%*.)1,"+,%"%/),-/,%"U"+,"6M6,"=0&,-"E'1$'-*"+,"$'"*53.1),"+,"$&3>.$0*).-2"P,"?')%",-*1,1"+'-%"
$&5)%*.)1,"+,%"%/),-/,%"$'"*1'-%?.16'*).-"+,"/,1*')-%"+,%/,-+'-*%"+,"$.0E%",-"/5),-%;"<,"%,/.-+"
631)*,"+,"$&,VE1,%%).-"C"$'"*53.1),"+,"$&3>.$0*).-"G".0"C"$'"*53.1),"+,"$'"/50*,"+,%"/.1E%"G",%*"+,"
%.0$)(-,1"=0,"$&.-"3-.-/,"'0*1,"/5.%,"=0&0-,">31)*3"%)6E$,2""'4%.$0,2"-3/,%%')1,2"0-)>,1%,$$,;"<'"
E1.E.%)*).-" C"6.-" %*O$." *.64," ,-" >,1*0" +," $'" *53.1)," +," $'" (1'>)*3"G" E,0*" M*1," )->'$)+32" E'1"
,V,6E$,"%)"P,"6,"%)*0,"+'-%"$,"/'+1,"+,"$'"*53.1),"+,"$'"1,$'*)>)*3"(3-31'$,;"
W-" *,%*," )/)" =0&0-" 3-.-/3" /.66," C"%01" *,11,2" 6.-" %*O$." *.64,"G" -&,%*" '4%.$06,-*" >1')"
=0&'0*'-*"=0&)$"-&,%*"E'%" %/),-*)?)=0,;"X0'-+"0-"3-.-/3" E1./5," 6')%"E$0%"/.6E$,*"E13*,-+"'0"
%*'*0*"+&3-.-/3"+,"%/),-/,2")$"+,>),-*2"+0"6M6,"/.0E2"%0%/,E*)4$,"+&M*1,"E1)%",-"+3?'0*;"
"
"

!Chapitre!I.!Qu’est0ce!que!l’histoire!des!sciences!?!
!
7"
"
D5'E)*1,"#;"X0&,%*9/,"=0,"$&5)%*.)1,"+,%"%/),-/,%"F"
!;"C"<&5)%*.)1,"(3-31'$,"+,%"%/),-/,%"G"/.-%*)*0,9*9,$$,"0-".4P,*"E.%%)4$,"F"
#$" ,V)%*," 0-," )+3," 6.+,1-," $'1(,6,-*" 13E'-+0," %,$.-" $'=0,$$," $&5)%*.)1," +,%" %/),-/,%" ,%*" 0-,"
+)%/)E$)-,"*1B%"13/,-*,;""X0," $,%"%/),-/,%"%.),-*"0-,"'/*)>)*3" =0)" 1,6.-*,"@" $.)-2" $'" E$0E'1*"+,%"
E5)$.%.E5,%",*"+,%"%/),-*)?)=0,%"YE'%"*.0%Z",-"/.->),-*;"[-"1,>'-/5,2")$",%*"%.0>,-*""%.0*,-0"=0,"
$,01"5)%*.)1,"-&'01')*"3*3"/.->,-'4$,6,-*"?')*,"=0&'0"%)B/$,"+,1-),1"Y.0"3>,-*0,$$,6,-*"'0"\#\,Z;"
#$" O" '" E$0%2" /,1*')-%" '0*,01%2" ,*" -.-" +,%" 6.)-+1,%2" +.0*,-*" +," $'" E.%%)4)$)*3" 6M6," +," ?')1,"
$&5)%*.)1,"+,%"%/),-/,%;"],$.-"/,%"'0*,01%2")$",%*"-.16'$"=0&)$"-&O"')*"E'%",0"+&5)%*.)1,"+,%"%/),-/,%"
E,-+'-*"+," $.-(%"%)B/$,%",*"/,"%,1')*""'>,/"'0+'/,2" >.)1,")6E10+,-/,2" =0,"$&.-"%,"%,1')*"$'-/3"
+'-%"$&'>,-*01,"6'$"?.-+3,"=0)"/.-%)%*,"@"$'"13+)(,1;"
"
^'0$"_'--,1O"E1./$'6')*",-"!`8a"H""
C"D.66,"P,"$&')"+)*2"/,**,"5)%*.)1,"(3-31'$,"b+,%"%/),-/,%c"-&,V)%*,"E.)-*",-/.1,;"G!""
<,"6M6,"_'--,1O"'>')*"/,E,-+'-*"+3P@"/.66,-/3"@"13+)(,1"0-,"5)%*.)1,"(3-31'$,"+,%"%/),-/,%2"
+0"6.)-%"$,%"/5'E)*1,%"%01" C"$&5)%*.)1," (3-31'$," +,%"%/),-/,%" ,-"[01.E,2" +,E0)%" $," \#I,"%)B/$,"@"
!`88"G" =0)" +,>'),-*" '//.6E'(-,1"$&,*"-.*/&' 01+1/$2&'+," <'>)%%," ,*" A'64'0+;" A,-3" _'*.-"
/.-?)16," $'" 13'$)*3" +," $&,-*1,E1)%," ,-('(3,"E'1" _'--,1O" ,-" 1'EE,$'-*"=0," $,%" /5'E)*1,%" +,"
_'--,1O"C"-&3*'),-*"=0,"$'"E1,6)B1,",%=0)%%,"+&0-"(1'-+"3/$*-1'(45*"-.*/&'01+1/$2&'(&"'"%*&+%&""'
=0,"%'"6.1*"E136'*013,"-,"$0)"'"E'%"E,16)%"+&3/1)1,"G;7'
D&,%*"@"$'"6M6,"3E.=0,"Y!`8:Z"=0,"_'--,1O"*,-*')*"+,"*536'*)%,1"/,"=0,"E,0*",*"+,>1')*"M*1,"
$&5)%*.)1,"+,%"]/),-/,%"U",$$,"+,>1')*"M*1,"+3+.04$3,2",-"5*"-.*/&'01+1/$2&'",*"5*"-.*/&'"#1%*$2&;"<'"
-'*01,"+,"$'"+)%*)-/*).-2"+,"$&.EE.%)*).-"+,"$&0-,",*"+,"$&'0*1,"-,"6&'EE'1')%%,-*"E'%"/$')1,%"+0"
*.0*;"_'*.-" -.*," +&')$$,01%"=0&"C")$"$0)"b_'--,1Oc"%,64$," E136'*013"+,"E.0>.)1" +3?)-)1"$&5)%*.)1,"
(3-31'$,"+,%"%/),-/,%:;"
C"d')%.-%"+.-/"+&'4.1+"0-,"5)%*.)1,"(3-31'$,"+,%"%/),-/,%2",*"*'-*"=0&,$$,"-,"%,1'"E'%"?')*,2"-,"-.0%"
E'O.-%" E'%" +," 6.*%" =0)" %,1'),-*" ,-/.1," E$0%" .4%/01%" =0," /,0V" =0&)$%" +,>1'),-*" ,VE$)=0,1;"
S/*0,$$,6,-*2" /,**," 5)%*.)1," -&,%*" 1),-e" 1),-"=0&0-," /.-/,E*).-" )-+)>)+0,$$,;" D5'/0-" E,0*" '>.)1" $'"
%),--,",*")$"'"'0*'-*"+,"+1.)*"=0&0-"'0*1,"@"/5,1/5,1"@"$'"13'$)%,1".4P,/*)>,6,-*;"f')%"0-,"?.)%"=0,"
/,**,"13'$)%'*).-"%,1'"%0??)%'-*,"E.01"%,1>)1"+,"?.-+,6,-*"@"+,%"/.-%*10/*).-%"0$*31),01,%2".0"+,"*OE,"
E.01"$&,V3/0*).-"+&0-"E$'-"E$0%">'%*,2"$&5)%*.)1,"(3-31'$,"+,%"%/),-/,%"'01'"/.66,-/3"%.-",V)%*,-/,"
+,"?')*2",*")$"%,1'"*,6E%"+&,-"/5,1/5,1"%)".-"$,"/1.)*"0*)$,"E.01"$,%"$,V)=0,%"0-,"+3?)-)*).-"/.-/)%,",*"
,V'/*,;"Ga""
g1,?2"%)"$&5)%*.)1,"(3-31'$,"+,%"%/),-/,%"-&,V)%*,"E'%",-/.1,2"+,%"5)%*.)1,%"E'1*),$$,%",V)%*,-*",*"-0$"
-&'"E0"?.01-)1"+,"/'1'/*31)%'*).-">'$'4$,"+,"/,"=0&,$$,"+.)*"M*1,;"_.0*,?.)%"/5'/0-"E,0*"E'1*)/)E,1"
@" %.-" 3+)?)/'*).-" C"+," ?')*"G2" ')-%)" $&5)%*.)1," (3-31'$," +,%" %/),-/,%" ,%*" 'EE,$3," @" ,V)%*,1" %'-%"
+3?)-)*).-"E13/)%,",*"/.-/,E*0,$$,6,-*">'$)+,"U",$$,"%,1'"0-".4P,*"+,"?')*",*"E'%"+,"1')%.-;"
"
S$,V'-+1," h.O13" %.0*,-')*" ,-" !`i!2" '0" /.-(1B%" )-*,1-'*).-'$" +&j)%*.)1," +,%" ]/),-/,%"
+&WV?.1+"=0," C"^,1%.--," -," E,0*" E$0%" 3/1)1," $&5)%*.)1," +,%" %/),-/,%2" -)" 6M6," $&5)%*.)1," +&0-,"
%/),-/,e<,%" *,-*'*)>,%" 13/,-*,%" $," E1.0>,-*" '4.-+'66,-*"G" Y6&/"#&%-*7&"' "8/' 24,*"-.*/&' (&"'
"%*&+%&"9')-"g1;"^;"!k7Z;"D,E,-+'-*2"$,"6M6,"S;"h.O13",%*"0-"+,%"'0*,01%"$,%"E$0%"6'1=0'-*%"+,"
$&,*"-.*/&'01+1/$2&'(&"'"%*&+%&"'"+.-*"A,-3"_'*.-">),-*2"'$.1%2"+,"+)1)(,1"$'"E04$)/'*).-"'0"],0)$",-"
!`kl;"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
!"D)*3")-"g10-/5>;"^;la"
7"_'*.-2"[*0+,%"+&5)%*.)1,"+,%"%/),-/,%2"g1,E.$%2"k!k;"
:":&78&'(&'";+-5<"&'5*"-./*=8&2"*;"I###"Y!`8aZ2"!9!i"U"^;"_'--,1O2">1?.*/&"'"%*&+-*@*=8&"2"*;"\2"^'1)%2"!`:82"
!i:9!m7;"D)*3"E'1"_'*.-2"g1,E.$%2"7882"E;"k!i9k!l"
a":&78&'(&'";+-5<"&'5*"-./*=8&2"*;"I###"Y!`8aZ2"l"U"^;"_'--,1O2">1?.*/&"'"%*&+-*@*=8&"2"*;"\2"^'1)%2"!`:82"!l!9
!l7;"D)*3")-"_'*.-2"E;"k!k;"

!Chapitre!I.!Qu’est0ce!que!l’histoire!des!sciences!?!
!
:"
"
#$",%*"%E,/*'/0$')1,"+,"/.-%)+31,1"$&)-*1.+0/*).-"+,"/,**,")66,-%,",-*1,E1)%,"Y+,"_'*.-Z;"[$$,",%*"
=0'%)" )-,V)%*'-*,2" *1.)%" E'(,%" ,*" +,6)" *1B%" -,0*1,%;" D,**," 5)%*.)1," C"%," ?')*" +.-/"G2" 6')%" -," %,"
+3?)-)1')*"E'%"-)"-,"%,"+3/1)1')*2"/,"=0)",%*"/.-?.16,"'0"C"E1.(1'66,"G"+,"^'0$"_'--,1O;"
"
#$" O" '" +.-/" +,%" )-+)/,%" /.-/.1+'-*%" ?')%'-*" E,-%,1" =0," $&j+]" E13%,-*," +,%" /'1'/*B1,%" '%%,J"
E'1*)/0$),1%"=0)"$'"1,-+,"E$0%"E1.4$36'*)=0,".0"/5)631)=0,"@"13'$)%,1"=0,"$&5)%*.)1,"(3-31'$,;"
"
D,**,",-*1,E1)%,")-/,1*')-,">.)*"E.01*'-*"$,"P.01",*"n,.1(,%"]'1*.-"'0*,01"+&0-,"6.-06,-*'$,"
A+-/.(8%-*.+' B' 245*"-.*/&' (&"' "%*&+%&"' CDEFGHDEIGJ"E'1*'(," '>,/" ^'0$" _'--,1O" $&)+3," %,$.-"
$'=0,$$,"$'" 13?31,-/," E5)$.%.E5)=0," ,-" $'" 6'*)B1," ,%*" S0(0%*,"D.6*," =0)"C"+.)*"M*1," /.-%)+313"
/.66,"$,"?.-+'*,01"+,"$&5)%*.)1,"+,%"%/),-/,%2".0"*.0*"'0"6.)-%"/.66,"$,"E1,6),1"=0)",-",0*"
0-,"/.-/,E*).-"/$')1,",*"E13/)%,2"%)-.-"/.6E$B*,G;k"<,"40*"+,"$'"1,>0,"A"*""+.-*")$",%*"$,"?.-+'*,01"
,-" !`!:2" %,1'2" C"'0" E.)-*" +," >0," E5)$.%.E5)=0,"G2" +," 1,?')1," %01" +,%" 4'%,%" %/),-*)?)=0,%" ,*"
5)%*.1)=0,%" E$0%" E1.?.-+,%" ,*" E$0%" %.$)+,%2" $&o0>1," +," D.6*,G;" ^'0$" _'--,1O">.)*" /," +,1-),1"
/.66,""C"<,"E1,6),1"E,-%,01"=0)"')*"/.-p0"+&0-,"?'p.-"=0,$=0,"E,0"E13/)%,"$&5)%*.)1,"(3-31'$,"
+,%"%/),-/,%"Gi;"
A,-3" _'*.-" 3/1)*" =0&)$" %&'()*" C"+&0-," +)%/)E$)-," 1,$'*)>,6,-*" 13/,-*,;"X0.)=0&,$$," ')*" 3*3"
/5'0+,6,-*"E1q-3,"E'1"$,%",-/O/$.E3+)%*,%2"E0)%"E'1"S0(0%*,"D.6*,",*"$&3/.$,"E.%)*)>)%*,Gl""
S0*1,6,-*" +)*2" *'-*" $,%" ,-/O/$.E3+)%*,%" =0," $&3/.$," E.%)*)>)%*," -&.-*" E'%" E0" 6,-,1" @" 4),-" 0-"
E1.P,*"=0)"/,E,-+'-*"$,01"E'1')%%')*"+&)6E.1*'-/,;"
"
K,%"/.66,-*')1,%"13/,-*%"1,E1,--,-*"Q,-"$'"-0'-p'-*9"/,**,"'EE13/)'*).-"U"/&,%*"C",-"*'-*"=0,"
+)%/)E$)-,"G" =0," $&5)%*.)1," +,%" %/),-/,%" ,%*" *.0*," 13/,-*,;" [%*9/," @" +)1," =0&)$%" '+6,**,-*" %.-"
,V)%*,-/,"E13'$'4$,2"=0.)=0,"+.+'(*"%*#2*+$*/&'F"A),-"-,"$&)-+)=0,;"K'-%"$&,-/O/$.E3+),",-" $)(-,"
r)s)E3+)'2".-"E,0*"$)1,"
"C"K,E0)%" $.-(*,6E%2" +," -.641,0V" 0-)>,1%)*')1,%" ,*" %/),-*)?)=0,%" %," %.-*" ?')*" $,%" /51.-)=0,01%" +0"
+3>,$.EE,6,-*"+," $,01"+)%/)E$)-,"1,%E,/*)>,2"+,"$'"%/),-/,",-"(3-31'$;"f')%"/,"-t,%*"=0t@"E'1*)1"+0"
\\,"%)B/$," =0," %," /.-%*)*0," $t5)%*.)1," +,%" %/),-/,%" ,-" *'-*" =0," +)%/)E$)-,"G;" W-" .EE.%," $,%"
C"/51.-)=0,01%"G"@"$'"C"+)%/)E$)-,"/.-%*)*03,"G;"
],$.-"N,'-9d1'-p.)%"g1'0-%*,)-2",$$,"/.66,-/,"Q,-"*'-*"=0,"+)%/)E$)-,9"'0"6)$),0"+0"\#\,;"],%"
^B1,%""%,1'),-*"S0(0%*,"D.6*,"Y!l`m9!mklZ",-"d1'-/,",*"r)$$)'6"r5,L,$$"Y!l`a9!miiZ",-"n;g;"
h.O13"%.0*),-*"=0,"/&,%*"'0"\I###,2"'>,/"$,%"$06)B1,%"=0,"C"$&5)%*.)1,"+,%"%/),-/,%"%,"/.-%*)*0,",-"
+)%/)E$)-,")-+3E,-+'-*,"G"Y6&/"#&%-*7&"'"8/'245*"-.*/&'(&"'"%*&+%&"2"WV?.1+"!`i!2")-"g1;"!a`9!k8Z;""
"
#$"/.->),-*"+,"%)(-'$,1"$&'>)%"+&S;D;"D1.64),"%,$.-"$,=0,$2"$,"E1.P,*"+,"_'--,1O"-&,%*"E'%"%)"-,0?"H"
_5,%,")+,'%"L,1,"-.*"-,L2"?.1")-"*5,"K(7$+%&?&+-'.@'L&$/+*+02"d1'-/)%"g'/.-"5'+"'$1,'+O"$')+".0*"'"
1,6'1s'4$,"+,%)(-"?.1"'-")-*,$$,/*0'$"5)%*.1O"*5'*"%5.0$+"-.*".-$O")-/$0+,"*5,".1)()-"'-+"+,>,$.E6,-*"
.?"%/),-*)?)/"*5.0(5*")-"+)??,1,-*"%./),*),%2"40*"%5.0$+"'$%."1,$'*,"%/),-*)?)/"E1.(1,%%"'-+"+,/'O"*."*5,"
+)%E.%)*).-".?"*5,"E,.E$,"'-+"*5,)1"$'L%2"1,$)().-2"'-+")-%*)*0*).-%;m"
"
_.0%" /,%" '1(06,-*%" 6&3*.--,-*" /'12" ,-" ?')*2" )$" ,V)%*," +,%" ,*"-.*/&' (&"' "%*&+%&""+,E0)%" ?.1*"
$.-(*,6E%",*"$,"E.)-*"+,">0,"/.-*1')1,2"'%%,J"$'1(,6,-*"E'1*'(32"%,"5,01*,"'0"?')*"4),-"13,$"=0&)$"
,V)%*,"+,%" C"j)%*.)1,%" +,%"%/),-/,%"G"+,E0)%"=0," $,%" %/),-/,%",V)%*,-*".0"E1,%=0,"H" [V;" S1)%*.*,"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
k"n;]'1*.-2"!`!:2"^1,6),1"-0631."+&A"*"2"/)*3")-"g1'0-/5;""-;:2"E;7:"
i"^;"_'--,1O2"C"K,"$&5)%*.)1,"(3-31'$,"+,%"%/),-/,%"G2"Y!`8aZ"+'-%">1?.*/&"'"%*&+-*@*=8&"9'-M'N9'n3-31'$)*3%"
5)%*.1)=0,%"!m`79!`:82"^1)>'*9n'0-*5),19I)$$'1%"!`:82"1,E1.+0)*")-"g1;"E;il9m:;"
l"A,-3"_'*.-2"^13?'/,"(3-31'$,"@"$&5)%*.)1,"(3-31'$,"+,%"%/),-/,%2"E;"I;"
m"S;D;"D1.64),2"A+-/.(8%-*.+2"u]/),-*)?)/"/5'-(,"G2"]O6E.%)06".-"*5,"5)%*.1O".?"%/),-/,2"WV?.1+2"`9!k"P0$O2"
!`i!2"v,L"w.1s2"!`i:2"E;"!;"

!Chapitre!I.!Qu’est0ce!que!l’histoire!des!sciences!?!
!
a"
"
+'-%"$'"65;"*=8&"-.*'66,-*2"^$)-,"$&'-/),-"Y:l"*.6,%"+,"L45*"-.*/&'+$-8/&22&Z".0"S$4,1*"$,"n1'-+2"
.0" I)-/,-*" +," g,'0>')%2" h01*" ]E1,-(,$" Y!lii9!m::Z2"D.-1'+" n,%%-,12" .0" g0??.-2" g'/.-" YO8'
#/.0/<"'&-'(&'2$'#/.?.-*.+'(&"'"$7.*/"Z2""D.-+.1/,*"Y!"=8*""&'(48+'-$P2&$8'5*"-./*=8&'(&"'#/.0/<"'
(&'24&"#/*-'58?$*+"!l`:Z2"d.-*,-,$$,""Y,*"-.*/&'(&'24K:)"!i``;Z"
W-"E,-%,1'"'0V"*1B%"-.641,0V"'1*)/$,%"+,"$&!+%;%2.#1(*&2"=0)"1,$B>,-*2"+,"?')*2"+,"$&5)%*.)1,"+,%"
%/),-/,%2"'1*)/$,%"'0V=0,$%".-"P.)-+1'"$,"O*"%.8/"'#/12*?*+$*/&;"
[-" .0*1," +,E0)%" $.-(*,6E%" +,%" 5)%*.)1,%" +,%" %/),-/,%" E'1*)/0$)B1,%" Y1,?;" g1;" `" ,*" !!Z;" n1'-+"
,V,6E$,"N,'-9[*),--,"f.-*0/$'"Y!lkmZ2"N,'-9]O$>')-"g')$$O"Y!llk9!lm7Z2"N.%,E5"^1),%*$,O"Y!lil"U"
!ll7Z2"K,$'641,2"S41'5'6"n.**5,$?"hx%*-,1"Y!l`i9!m88Z2"N.5'--"d1),+1)/5"n6,$)-"Y!l`l9!l``Z2"
N.5'--"h'1$"d)%/5,1"Y!m8!9!m8mZ2"g,,/s6'-""
"
"
D,%",V,6E$,%"6.-*1,-*"9%,$.-"6.)9"=0,"$'"*5B%,"+,"$&,V)%*,-/,"13/,-*,"+,"$&5)%*.)1,"+,%"%/),-/,%"
Y>.)1,"+,"%.-")6E.%%)4$,">31)*'4$,"13'$)%'*).-Z"",%*"4,'0/.0E"*1.E"1,%*1)/*)>,",*"P&'01')%"*,-+'-/,"
@" /.-%)+31,1" =0," $&5)%*.)1," +,%" %/),-/,%" /.66,-/," $.1%=0," %.-*" E1.+0)*%" +,%" *,V*,%" +&5)%*.)1,"
+,%"%/),-/,%;""
<&,VE$)/'*).-"+,"/,**,"%.1*,"+,"-3('*).-",%*"E,0*9M*1,"+.--3,"E'1"f)/5,$"],11,2"+'-%"%'"6/1@$%&'
'0V"!21?&+-"'(45*"-.*/&'(&"'"%*&+%&""=0&)$"'"+)1)(3%"
C"D'1" )$" ,V)%*," 0-," 5)%*.)1," +,%" %/),-/,%" %E.-*'-3,2" /.66," '01')*" S0(0%*," D.6*,"H" *,$$," =0," $'"
E1'*)=0,1'),-*"0-," 5)%*.)1," *1.E" E,0" '>,1*)," +,%" %/),-/,%" ,*" +,%" %/),-/,%" *1B%" 6'$" )-%*10)*,%"
+&5)%*.)1,;" [*" P0%*,6,-*" /,**," E1.(1,%%).-" %'-%" '//)+,-*" +0" %'>.)1" )-*3(1'$" +'-%" 0-" *,6E%" ($.4'$2"
5.6.(B-," ,*" )%.*1.E,2" /'1'/*31)%," /,**," %E.-*'-3)*3" )113?$3/5),;" S" O" 1,('1+,1" +," E1B%" 6)$$,"
/.6E$)/'*).-%"'EE'1')%%,-*"H",-*1,"$'"/'1*," @"(1'-+," 3/5,$$,"+&0-,"/q*," +3/.0E3,"E'1"$&31.%).-"+,%"
1./5,%",*"$,"E'1/.01%"+0"1'-+.--,01"%01"$,%"/')$$.0V"+0"*,11')-2".-"E'%%,"+&0-,"/.014,"/.-*)-0,"@"+,%"
%'0*%"/5'.*)=0,%",*"'>,0($,%2"=0)",VE$.1,-*",*"41)/.$,-*2"/.66,"$,"?.-*"%.0>,-*"$,%"/5,1/5,01%;"K,"
6M6," -0$$," %/),-/," -," 1,%*," 0-)=0,2" 1,/.--')%%'4$," ,*" /.531,-*,2" 6M6," @" 6.O,-" *,16,2" $," $.-("
+&0-,"+013,"=0)",$$,96M6,"4)?01=0,",*"?$0/*0,;"<'"1')%.-"+'-%"$&5)%*.)1,"%'>'-*,"1,%%,64$,"+.-/"@"
0-,"-'y>,*3;"D,**,"%E.-*'-3)*3"%0EE.%,">1'),%"6)$$,"/5.%,%",-/.1,"H"=0&)$"%0??)*"+,"1,$'*,1"$'"%31),"+,%"
%.$0*).-%"@"+,%"E1.4$B6,%",*"+,%",VE31),-/,%"E.01"+,%")->,-*).-%"U"+,"*1'/,1"$,%"E.1*1')*%"+,%"(3-),%"
=0)" %)(-B1,-*" +,%" +3/.0>,1*,%"U" +," 1,/.--'z*1," +'-%" $," E'%%3" +,%" *1'/,%" +&,641O.-%" .0" +," 1M>,%2"
%,6,-/,%".0"?.-+,6,-*%"+,%" 13'$)%'*).-%"/.-*,6E.1')-,%"U"+," 6'1=0,1" ?.1*,6,-*"$,%"/.0E01,%",*"
13>.$0*).-%" =0)" +'*,-*" $'" -')%%'-/," )113>,1%)4$,"+&0-," %/),-/," .0" $,%" 6.6,-*%" ?.1*%" +," %,%"
*1'-%?.16'*).-%"U"+,"+3/1)1,"$,%"=0,1,$$,%2"+34'*%",*"E.$36)=0,%"+.-*"$,"?,0"'$)6,-*,1')*"$,%"6.*,01%"
+,"$&'>'-/3,")-*,$$)(,-*,"U" .0" )->,1%,6,-*" +&'//1./5,1" $," /5'E)*1," +,%" %/),-/,%" '0" $)>1," /.01'-*" +,"
$&5)%*.)1,"U" +," +3?)-)1" $," /'+1," %./)'$2" )-%*)*0*).--,$2" 3/.-.6)=0,2" /0$*01,$" ,*" E.$)*)=0," +,%" /.-*,-0%"
%'>'-*%e[$$," %0EE.%," %01*.0*" /," 6.6,-*" 13*1.(1'+," +0" >1')" =0)" E1.P,**," +'-%" $," E'%%3" $,%"
/.--')%%'-/,%" +&'0P.01+&50)" +," %.1*," =0," $&5)%*.)1," +,>),-*" 0-," E13E'1'*).-" )113%)%*)4$," ,*" =0'%)"
E1.(1'663," '0" %'>.)1" +0" P.01;" S0" >1')2" 1),-" +," E$0%" +)??)/)$," =0," +&)6'()-,1" 0-" *,6E%2" $)41," ,*"
?$0/*0'-*2" -.-" /.6E$B*,6,-*" +3*,16)-32" .{" $,%" %'>'-*%" =0)" /5,1/5,-*" -," %'>,-*" E'%" ,-/.1,"
>1')6,-*"*.0*"@"?')*"/,"=0&)$%"/5,1/5,-*"*.0*",-"$,"%'/5'-*"'>,0($36,-*;"
S0"?.-+2"/,**,"%E.-*'-3)*3"'"0-,"+.04$,"1'/)-,"H"$'"43'*,"'+6)1'*).-2"1,$)(),0%,"@"$'"$,**1,2"=0.)=0,"
E'1?.)%" P0%*)?)3,2" ,->,1%" *.0*" /," =0)" %," +)*" %'>'-*" ,*" =0)2" E'1" $@2" +,6,01," )-*.0/5'4$,2" ,*" 0-,"
%O63*1)=0,"'+.1'*).-"E.01"$&5)%*.)1,;"fM6,"%&)$%"%,"E13*,-+,-*"'*53,%".0"$)4313%2"-.%"/.-*,6E.1')-%"
%'/1)?),-*" >.$.-*),1%" @" /,%" +,0V" '0*,$%" .0" %&)-/$)-,-*" +,>'-*" /,**," +.04$," 5)31'1/5),;" " v0$" -," E,0*"
6,**1,",-"=0,%*).-"$,"%31),0V2"$'"1')%.-2"$,%"'/=0)%"$,"*1'>')$"+,%"%/),-/,%"-)"+,"$&5)%*.)1,"%'-%"%,">.)1"
'0%%)*q*"'//0%3"+,"=0)**,1"$,"1'*).--,$;"I.)$@"+,0V"*'4.0%"+,"-.*1,"*,6E%;"^'1"/.-%3=0,-*"$&5)%*.)1,"
+,%"%/),-/,%"%E.-*'-3," %," 13+0)*"%.0>,-*"@" 0-,"5)%*.)1,"%')-*,".0" E$0*q*"%'/1'$)%3,"H"$,%"(3-),%" %&O"
/.-+0)%,-*"/.66,"+,%" E1.E5B*,%2"$,%" /.0E01,%"/.66,"+,%" 13>3$'*).-%2" $,%"E.$36)=0,%" .0"+34'*%"
,V/$0,-*" $,%" 5313*)=0,%2" $,%" /.$$.=0,%" 6)6,-*" $,%" /.-/)$,%2" $'" %/),-/," %&)-/'1-," E,0" @" E,0" +'-%" $,"
*,6E%"/.66,"P'+)%"$&,%E1)*;"C"`"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
`"f)/5,$"],11,%2"Y+)1;Z"!21?&+-"'(4,*"-.*/&'(&"'"%*&+%&"2"Y!`m`Z"<'1.0%%,9g.1+'%"!``l2"E;"!a9!k;"

!Chapitre!I.!Qu’est0ce!que!l’histoire!des!sciences!?!
!
k"
"
_.0*" ,%*" +)*2" $&5)%*.)1," +,%" %/),-/,%" ,%*" )-?)-)6,-*" /.6E$,V," /'1" ,$$," ,%*" )-?)-)6,-*" 1)/5," ,*" %,"
%)*0," @" 6)$$," /'11,?.01%;" S$.1%2" .-" E,0*" *.0P.01%" +)1," =0," $,%" j)%*.)1,%" +,%" %/),-/,%2" 13'$)%3,%"
C"'>'-*"G" -&3*'),-*" E'%" %'*)%?')%'-*,%2" E'%" '%%,J" /$')1,%2" E'%" '%%,J" %/),-*)?)=0,%2" E'%" '%%,J"
E5)$.%.E5)=0,%2" E'%" '%%,J" %./).$.()=0,%2" E'%" '%%,J" (3-31'$,%" ,*/;2".-" -," E,0*" E'%2" /,E,-+'-*2"
+)1," =0&,$$,%" -&,V)%*'),-*" E'%;" #$" 6&'EE'1'z*" +.-/" E$0%" 1')%.--'4$," +," 4'$'O,1" /,%" )+3,%" %,$.-"
$,%=0,$$,%" /," (,-1," ,%*" -.0>,'0;" #$" ,%*2" '0" /.-*1')1," ?.1*" '-/),-2" '>,/" %,%" ?')4$,%%,%" ,*" %,%"
1)/5,%%,%2"%,%"E1.+0/*).-%"63+)./1,%",*"%,%"/5,?%9+&o0>1,;"S$.1%".0)2")$",%*"E.%%)4$,"+,"E1.+0)1,"
+,%",*"-.*/&'(&"'"%*&+%&"",*"/,*",V,1/)/,",%*"'-/),-;"
"
A,%*,"@"/.6E1,-+1,"E.01=0.)"$,%"'0*,01%2"6M6,"/,0V"=0)",??,/*)>,6,-*"/.-*1)40,-*"@"$&3/1)1,2"
13?0*,-*2" '>,/" E$0%" .0" 6.)-%" +," /.->)/*).-2" $'" E.%%)4)$)*3" +," $'" 13'$)%,1;" D&,%*" 0-" ,-%,64$," +,"
1')%.-%"H"0-"1'EE.1*"/.6E$,V,"+,%"%/),-/,%"@"$'">31)*32"0-,"%)*0'*).-"*.E.$.()=0,6,-*"/.6E$,V,"
+,%"%/),-/,%",*"+,"$,01"5)%*.)1,2"0-"1'EE.1*"+3$)/'*"'0V"/.-+)*).-%"%./).93/.-.6)=0,%e41,?2".-"
-,"%')*"%)".-",%*">31)*'4$,6,-*"5'4)$)*3"@",-"E'1$,1;""
A,-3"_'*.-",%*"+&0-,"(1'-+,"%.41)3*3"=0'-+")$"3>.=0,"/,**,"/.6E$,V)*3"H"
_.0/5'-*" @" $'" ?.)%" '0V" %/),-/,%2" @" $'" E5)$.%.E5)," ,*" @" $&5)%*.)1," (3-31'$,2" $&5)%*.)1," +,%" %/),-/,%" %,"
*1.0>,"+'-%"0-,"%)*0'*).-"*.0*,"%E3/)'$,2"@"$'"?1.-*)B1,"+,%"%/),-/,%"E01,%2"+,%"%/),-/,%"506')-,%",*"
+,%" *,/5-)=0,%;" #$" ,%*" /,1*')-" =0," /,**," E.%)*).-" E1)>)$3()3," ,-" 0-," J.-," +," ?3/.-+,%" /.-?$0,-/,%"
/.-%*)*0," $&0-" +,%" ?'/*,01%" ,%%,-*),$%" +," $'" 5'0*," >'$,01" /0$*01,$$," +," /,**," +)%/)E$)-,;" f')%" /,**,"
%)*0'*).-",V/,E*).--,$$,",%*"'0%%)"@"$&.1)()-,"+,"-.641,0%,%"+)??)/0$*3%;G!8"
#$"O"'"'0%%)"0-"3/5,/"13(0$),1"+,"*.0*,%"$,%"*,-*'*)>,%"E.01",-"/.6E1,-+1,"$'"+O-'6)=0,")-*,1-,2"
$'".0"$'"$.()=0,"+,"+3>,$.EE,6,-*;"D&,%*"%'-%"+.0*,"0-"+,%"E.)-*%"$,%"E$0%")-*31,%%'-*%2"@"%'>.)12"
=0,"$&5)%*.)1,"+,%"%/),-/,%"-&'"E'%"+,"#$--&/+2"E'%"+,"$.)"+,"?.16'*).-")-*,1-,"0-"*'-*"%.)*"E,0"
(3-31'$,;"[$$,"-,"/.-?)16,"=0'%)"P'6')%"$,%"(1'-+,%"13(0$'1)*3%"=0&.-"/1.)*"+,>.)1"O"*1.0>,1;""
#$"?'0+1'"1,>,-)1"%01"0-,"/.-%*10/*).-"E5)$.%.E5)=0,")6E.1*'-*,">)%'-*"@"P0%*)?),1"$&)6E.%%)4)$)*3"
.0" $," E,0" +&)-*31M*" +&0-," 5)%*.)1," +,%" %/),-/,%2" /&,%*" /,$$," +," f)/5,$" d.0/'0$*" +.-*" P," E'1$,1')"
+'-%"0-"/5'E)*1,"0$*31),01;"
"
7;" X0," +.)*9.-" /.6E1,-+1," E'1" 3>3-,6,-*%" Y.0" 3$36,-*%Z" /.-%*)*0*)?%" +,"
$&5)%*.)1,"+,%"%/),-/,%"F"
K,%"?')*%"6'*31),$%"%)6E$,%".0"+,%".4%,1>'*).-%"3$36,-*')1,%2"/.-%)+313%",-",0V96M6,%2"-,"%.-*"
E'%"/.-%*)*0*)?%"+,"$&5)%*.)1,"+,%"%/),-/,%2"4),-"=0&)$%"'),-*"0-"1'EE.1*"'>,/"$,%"%/),-/,%;"^1,-.-%"
=0,$=0,%",V,6E$,%"Y)$%"E.011'),-*"M*1,"60$*)E$)3%Z"H"
C"<,"%.$,)$"%,"$B>,"@"$&,%*"G2"C"0-,"3/$)E%,"+,"$0-,"'"$),0"G2"C"0-"/')$$.0"*.64," >,1%"$,"%.$"G2"C"$'"
*,11,",%*"1.-+,"G2"C"$'">'1).$,"-,"%&'**1'E,"E'%"+,0V"?.)%"G2"C"0-,"$,-*)$$,"(1.%%)*"$&)6'(,"E,1p0,"G2"
C"$&,'0"-,"6.-*,"E'%"+'-%"$,%"E.6E,%"'0"+,%%0%"+,"!:"E),+%"G2"C"+,%"E'1,-*%"'0V"O,0V"4$,0%".-*"
E1,%=0," *.0P.01%" +,%" ,-?'-*%" '0V" O,0V" 4$,0%"G2" C"0-" /.01'-*" 3$,/*1)=0," +3>)," 0-," ')(0)$$,"
')6'-*3,"G2"C"0-"/5'*"1,%%,64$,"@"0-"*)(1,"G2"C"$,"?1.**,6,-*"+,"+,0V"E)B/,%",-"/.-*'/*"/5'0??,"
$,"6'*31)'0G2"",*/;""
W-" -," E,0*" E'%"/.-*,%*,1" =0," /,%" E1.E.%)*).-%" '),-*"=0,$=0," /5.%," @" >.)1" '>,/" $,%" %/),-/,%"U"
'$.1%"E.01=0.)"-&,-"?.-*9,$$,%"E'%"E'1*),"F"
]'-%"-.0%"+.*,1" Q@" /,"%*'+,9" +&0-,"+3?)-)*).-2".0"+&0-,"/'1'/*31)%'*).-"+,"%&' =8&' %4&"-"=0,"$'"
%/),-/,2".0"+,"%&'=8&''%4&"-""=0&0-,"%/),-/,2".-"'+6,**1'"=0,"$&)+3,"+,"%/),-/,",V)(,"=0,$=0,%"
)-?.16'*).-%" =0)" 13E.-+,-*2" ?0*9/," )-/.6E$B*,6,-*2" '0" #.8/=8.*' ",*2" .0" '0" %.??&+-' "+," $'"
/5.%,"+.-*")$",%*"=0,%*).-;"
S)-%)2" '0%%)" (3-31'$"%.)*" $," ?')*" =0," 2&' ".2&*2' "&' 2<7&' B' 24&"-2" .0" '0%%)" E'1*'(3," $&.E)-).-" %,$.-"
$'=0,$$," 2&'%5$-'/&""&?P2$'$8'-*0/&2"/,%"+,0V"E1.E.%)*).-%"-,"6,"+)%,-*"1),-"+,"%/),-*)?)=0,2"-)"
6M6,2" '0" ?.-+2" +," 1'*).--,$;" N," /1.)%" 4),-" =0," Q*'-*" =0&,$$,%" %.-*" 3-.-/3,%" ')-%)2" %,0$,%9" $'"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
!8"_'*.-2"g1,E.$%2"78882"k!m"
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
1
/
50
100%