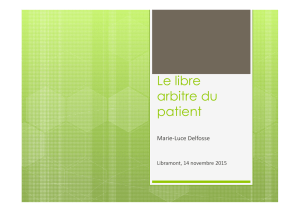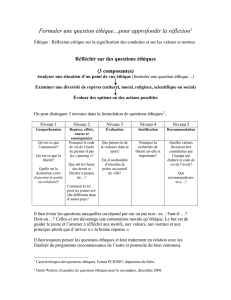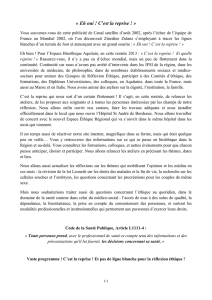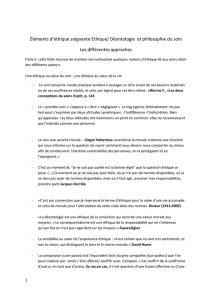3.2. Le libre arbitre du patient - Texte

1
LE LIBRE ARBITRE DU PATIENT
Marie-Luce Delfosse
Libramont, 14 novembre 2015
Introduction : Des mots, des intentions
L’objectif des organisateurs en m’invitant aujourd’hui est de vous proposer une réflexion sur la
liberté du patient. Au départ, celle-ci a été placée à l’enseigne du libre arbitre. J’ai signalé d’emblée
mes réserves à l’égard de ce titre. Pourquoi ?
Le libre arbitre, c’est le « pouvoir indéterminé de choisir (et donc de vouloir) une chose ou son
contraire et par conséquent de la faire». Certains voient en ce pouvoir l’absolu de la liberté
1
. Deux
aspects de cette définition me frappent…et me semblent problématiques :
-d’abord, associer liberté et indétermination de la volonté. Bien sûr, la liberté se vit en l’absence de
pressions extérieures. Mais elle est plus qu’un espace protégé où se déploierait une volonté
indéterminée, bien au contraire elle est structurée. Autour de quoi ? Dans le cadre de la relation
médecin-patient, elle se structure autour d’enjeux ressentis comme primordiaux par le patient et qui
vont être les axes soutenant sa décision. En ce sens, le concept d’autodétermination qui désigne le
fait de se déterminer, ou d’être déterminé par des caractéristiques internes me paraît plus proche de
la réalité car il renvoie lui aussi à cette structuration interne, sans toutefois en définir la nature.
-ensuite, le libre arbitre renvoie à une volonté solitaire saisie comme une souveraineté individuelle.
Or dans la relation médecin-patient, comme dans toutes les relations, la dimension relationnelle est
importante, et même décisive.
On définit aussi la liberté comme autonomie. Qu’entendre par là ? Littéralement, l’autonomie, c’est
se donner sa propre loi. Question candide: en quoi l’autonomie se distingue-t-elle du libre arbitre et
de l’autodétermination ? Réponse en deux temps. Elle se distingue du libre arbitre parce qu’elle
renvoie, comme l’autodétermination, à une structuration interne et pas seulement à un espace sans
entraves. Elle se distingue de l’autodétermination parce que la structuration interne à laquelle elle
renvoie est le fruit d’une dynamique existentielle et éthique qui se construit dans l’interaction avec
autrui.
Quels enjeux éthiques, personnels et relationnels peut-on dégager de ces précisions terminologiques
dans le cadre de la relation thérapeutique ?
Pour apporter des éléments de réponse à cette vaste question, impossible à traiter de façon détaillée
dans le temps dont je dispose, je partirai des définitions classiques de la relation thérapeutique, puis
montrerai, par coups de sonde, comment l’attention à la liberté du patient s’est imposée
progressivement. Ceci nous conduira de l’éthique médicale principliste et à deux lois belges récentes.
J’évoquerai ensuite une analyse de la relation médicale qui me touche particulièrement par sa
grande acuité : celle que propose le psychiatre français Henry Ey dans son texte « Mysterium
doloris » placé au début de son livre –déjà ancien, 1981- Naissance de la médecine
2
. Ces différentes
approches nous permettront-elles, comme aux glaneurs, de lester notre conception de la liberté dans
la relation thérapeutique ? Je le souhaite.
1
Définition reprise à C.GODIN, Dictionnaire de philosophie, Fayard, 2004.
2
Masson, 1981.

2
Une précision encore : je suis philosophe, et même si je fréquente de longue date les milieux
médicaux, je ne suis pas médecin ni soignante. Autrement dit, je ne vous livrerai pas ici une réflexion
basée sur des cas, des situations. Je préfère –avec l’accord des organisateurs- vous proposer une
réflexion plus fondamentale qui, je l’espère, pourra nourrir un peu votre approche des situations que
vous rencontrez.
1. Que nous disent l’éthique médicale, la déontologie et le droit belges de la liberté du
patient dans le cadre de la relation thérapeutique ?
1.1. Deux définitions « classiques » de la relation médicale : paternalisme et « contrat »
Longtemps, la profession médicale a pensé la relation thérapeutique en termes « paternalistes »
visant à protéger le patient. L’expression consacrée fut la définition que Louis Portes donna en 1950 :
la relation médicale, c’est « une confiance qui rejoint une conscience ». En 1936, le droit belge avait
pour sa part conçu la relation médicale en termes de « contrat médical », requérant ainsi que le
médecin donne à son patient des soins « conformes aux données acquises de la science »
3
. Ces deux
définitions ont fait l’objet de critiques nourries. Le paternalisme a été vu comme une infantilisation
abusive du patient : en raison de sa maladie, celui-ci deviendrait incapable de prendre une décision
cohérente à propos de sa santé. Cette critique n’est pas dénuée de justesse. On doit toutefois la
nuancer en l’interrogeant par les deux bouts :
-la confiance n’est-elle pas un ingrédient nécessaire de la relation thérapeutique dont les partenaires
sont, quoi qu’on fasse, inégaux tant sur le plan des connaissances que sur celui de la santé. ?
-la conscience n’est-elle pas une exigence à laquelle tout médecin doit satisfaire ? Le « contrat
médical » en exige précisément l’un des aspects. Dès lors, sans vouloir militer pour la restauration
d’une conception peu satisfaisante, je voudrais néanmoins souligner ce qui me paraît devoir être
retenu. Mais qui doit être intégré dans un cadre nouveau comme l’ont bien compris l’éthique
médicale, puis plus récemment la déontologie et le droit belges.
1.2. L’éthique médicale principliste
1978 fut une année décisive pour l’éthique médicale. Avec le Rapport Belmont
4
et les 3 principes
qu’il énonçait : autonomie, bienfaisance et justice, bientôt complétés par Beauchamp et Childress
5
qui avancèrent en outre le principe de non-malfaisance, une manière simple de traiter les questions
d’éthique médicale se mettait en place : examiner si le traitement envisagé pour les situations
problématiques passait victorieusement le test de ces 4 principes. Cette apparente simplicité du
principlism a favorisé sa longévité : aujourd’hui, le 1er réflexe en cas de difficulté est d’y recourir.
Mais cette apparente simplicité a aussi conduit à appauvrir le principlism: au lieu d’envisager
conjointement les principes comme un cadre quadripolaire, on en est venu à les hiérarchiser et à les
examiner successivement un à un, l’autonomie étant considérée comme le 1er d’entre eux. Inutile de
dire que cette démarche, du genre check list éthique, est peu pertinente et peu éclairante : non
seulement elle est mécanique, mais elle ressemble aussi à un filet dont les mailles sont tellement
larges qu’elles laissent échapper les poissons qui devraient précisément retenir l’attention. Une telle
3
Affaire Nicolas Mercier, Cass.civ., 20 mai 1936. Dalloz Périodique, 1936, I, p. 88.
4
Commission nationale pour la protection des sujets humains en recherche biomédicale et comportementale
(USA).
5
T.L. BEAUCHAMP et J.F. CHILDRESS, Les principes de l’éthique biomédicale, 1e éd. 1979, trad. franç.,
Paris, Les Belles Lettres, 2008.

3
démarche contredit d’ailleurs la volonté déclarée des initiateurs du principlism qui voulaient
absolument éviter ce piège stérilisant.
Comment le principlism envisage-t-il l’autonomie du patient ? Le Rapport Belmont de même que
Beauchamp et Childress la connectent étroitement à la capacité de penser et d’agir par soi-même.
Ainsi s’exprime le Rapport Belmont : « Respecter l’autonomie, c’est donner du poids aux opinions et
aux choix réfléchis d’une personne autonome (i.e. une personne capable de délibérer sur ses
objectifs personnels et d’agir dans le sens de la délibération), tout en s’abstenant de faire obstacle à
ses actions, sauf si elles sont clairement au détriment d’autrui. ».
Cette définition donne assurément une place à une certaine forme de liberté du patient capable de
d’agir dans le sens de ses choix réfléchis : le médecin prend ces choix en compte et s’abstient
d’exercer une pression sur le patient. Mais valoriser la liberté de décision du patient dit
« autonome » « en s’abstenant de faire obstacle à ses actions, sauf si elles sont clairement au
détriment d’autrui. »ne risque-il pas finalement de conduire à un simple renversement des positions
en présence : à la volonté souveraine du médecin dans l’attitude paternaliste se substituerait la
volonté souveraine du patient ; le médecin ne serait alors que l’exécuteur de la volonté de celui-ci.
Certes, le principlism a perçu la difficulté : Beauchamp et Childress précisent que le respect de
l’autonomie c’est aussi « encourager la prise de décision autonome », « développer et maintenir les
aptitudes au choix autonome des autres », notamment par une information adéquate sur les
diverses options possibles. Ce n’est plus d’abstention ou de réserve qu’il s’agit ici, mais d’une attitude
active visant à promouvoir la capacité d’autodétermination du patient, sans pour autant la
contraindre.
1.3. Deux lois belges récentes : la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et la loi du
28 mai 2002 relative à l’euthanasie.
1.3.1. La loi belge du 22 août 2002 relative aux droits du patient
La loi belge du 22 août 2002 donne au patient des droits individuels fort étendus qui visent à lui
reconnaître une maîtrise sur son destin, : droit de choisir son médecin, d’être informé, de ne pas être
informé, de consentir à toute intervention, de refuser certaines interventions ou de retirer son
consentement à celles-ci, droit à consulter son dossier, etc. Cependant, étendre ainsi le champ
décisionnel du patient n’est pas, en tant que tel, l’objectif poursuivi. En définitive, c’est bien
davantage un moyen pour exprimer ce que requiert actuellement le respect dû aux patients et
mettre ainsi en place une conception renouvelée de la relation thérapeutique. C’est ce que donnait
clairement à entendre Mr Hubert Brouns (CD&V) présentant ses propositions de lois en vue de
l’élaboration du texte finalement adopté:
Nous entendons transformer la relation verticale paternaliste classique entre le médecin et le
patient en une relation horizontale basée sur l’égalité ainsi que sur une collaboration et une
confiance réciproques.
6
Toutefois,
Placer au centre des soins de santé, le patient capable de se défendre n’a pas pour but de lui
procurer un super ego autonome, mais plutôt de l’inviter, en tant qu’être humain social, à
6
Documents parlementaires, Chambre, 50-1642/012 (2001-2002), p.24 (je souligne).

4
participer activement au développement de sa santé personnelle et à celle de sa communauté
ainsi qu’à un partenariat réel lorsqu’il nécessite des soins de santé.
7
La loi réalise-t-elle son objectif ? Certes, par sa force contraignante, elle imprime un style nouveau
aux relations entre soignant et soigné qui doivent désormais respecter les droits définis. Même si elle
ne peut dépasser un certain formalisme, ni empêcher une application mécanique des droits
proclamés, l’importance de la relation est constamment soulignée. En témoigne également le fait
qu’elle fasse valoir la médiation comme mode de traitement des conflits, privilégiant ainsi le
dialogue, plutôt que les recours juridiques classiques. Ellelaisse ainsi entendre que la liberté comprise
comme souveraineté individuelle, dans l’absence de dialogue, conduit à des impasses.
Toutefois, certains droits semblent bien en première approche relever d’une liberté comprise comme
souveraineté individuelle. Ainsi en est-il notamment du droit de refuser des soins, éventuellement
par une directive anticipée. Ce droit a suscité d’intenses débats avant et après l’adoption de la loi. Il
ouvre à une redéfinition de la mission du médecin, traditionnellement axée sur « sauver la vie », mais
qui doit désormais tenir compte de la volonté du patient. Cette redéfinition a bien évidemment
suscité la réaction du Conseil national de l’Ordre. Ayant clairement affirmé la priorité de la loi
démocratiquement adoptée sur le code de déontologie
8
, il admet que le prescrit légal est plus
catégorique que ses propres positions. Il incite vivement les médecins à établir le dialogue avec leur
patient et à examiner l’absence de pression extérieure sur celui-ci. En l’absence d’une telle pression
et lorsqu’il est établi aux yeux du médecin que le refus écrit de soins formulé par le patient coïncide
avec sa ferme conviction, il pose que le médecin est tenu de respecter cette volonté du
patient, « tout comme il doit accepter que des patients en mesure d'exercer leurs droits renoncent
parfois à des interventions pouvant être importantes pour leur santé »
9
. En s’exprimant de la sorte, le
Conseil national souligne l’importance d’une relation active entre le médecin et son patient, faite à la
fois de dialogue et de réserve. Et il introduit le concept majeur de « ferme conviction » dont le
médecin doit s’assurer.
1.3.2. La loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie
Ce concept de « ferme conviction » est au cœur de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.
Après avoir défini strictement celle-ci, cette loi ouvre un droit du patient à la demander. L’initiative
revient donc au patient non au médecin (qui peut d’ailleurs faire valoir la clause de conscience).
Cette loi redistribue ainsi les rôles et les responsabilités, en accord avec le mouvement général
d’opposition au paternalisme médical. Encore faut-il que le patient soit réellement libre et que sa
volonté soit réitérée : le médecin doit s’en assurer.
De toutes manières, le patient voit l’exercice de sa liberté encadré par des conditions strictes :
souffrance physique ou psychique constante, inapaisable et insupportable ; situation médicale grave
et incurable attestée par le médecin et le confrère consulté.
Bien que l’euthanasie consiste à poser un acte qui met fin à l’intégrité physique du patient, c’est bien
le respect de l’intégrité psychique et éthique de celui-ci qui constitue la valeur fondamentale sous-
7
Documents parlementaires, Chambre, 50-1642/012 (2001-2002), p.24 (je souligne).
8
Dans son avis du 23 mars 2003 relatif aux soins palliatifs, à l’euthanasie et à d’autres décisions concernant la
fin de vie.
9
Avis du 22 septembre 2007 : Validité des déclarations anticipées - Soins palliatifs..

5
tendant la loi
10
. Préciser quelque peu ces termes nous éclairera sur notre question d’aujourd’hui.
L’intégrité psychique désigne la cohérence interne de la personne, son équilibre psychique. Elle peut
être mise à mal par des souffrances physiques insupportables et inapaisables. Elle est en étroite
connexion avec l’intégrité éthique entendue comme adhésion à un code de valeurs, capacité des
personnes à agir en suivant leur conscience. L’intégrité éthique n’est pas la rigidité de qui se refuse à
toute discussion et elle ne peut se réduire à la résistance face aux tentatives de faire changer d’avis.
Elle exprime bien plutôt la dynamique existentielle et éthique propre à chacun qui le conduit à se
forger ses propres positions et conceptions sur le monde et sur soi en fonction desquelles il prendra
des décisions. Construire ses propres positions n’est jamais une aventure solitaire, bien au contraire
notre lot commun est de nous construire en interaction avec autrui : que serions-nous sans parents,
amis, enseignants, collègues qui nous aidés à construire notre propre point de vue ? L’intégrité
éthique n’est donc pas l’affirmation d’un égo souverain, elle est bien plutôt le ressort et
l’aboutissement d’une quête personnelle d’autonomie.
La loi insiste sur la dimension relationnelle. Plusieurs entretiens entre le médecin et son patient sont
requis, qui ne peuvent se borner à une communication d’informations puisqu’ils doivent déboucher
sur une conviction commune : l’euthanasie est la seule solution raisonnable. Le terme « conviction »
n’est pas anodin : il donne à entendre qu’il s’agit de mener ensemble un processus de réflexion qui
prolonge la demande initiale du patient, et qui s’échelonne dans le temps, même lorsque celui-ci
devient bref. On est donc bien dans la construction progressive d’une décision partagée, dans le
respect de l’intégrité éthique de chacun des partenaires. On retrouve ainsi la notion de « ferme
conviction », mais cette fois élaborée par le médecin et le patient et partagée par chacun d’eux.
2. La relation médecin-patient analysée par Henri Ey
C’est ici que je voudrais opérer la connexion avec l’analyse de la relation médicale que propose Henri
Ey. Elle est éclairantes pour la relation thérapeutique « en général » comme pour les situations plus
délicates que je viens d’évoquer. Pour bien la comprendre, il faut accepter de prendre un peu de
recul en se situant au niveau « général » qui englobe tous les types de situation.
A quel niveau se situe la médecine ?
La question qu’Henri Ey veut traiter dans son livre est : comment la médecine, entrelacée au départ à
la morale et à la religion, a-t-elle pu devenir une science des maladies et un art de guérir l’être
humain malade, atteint dans la vulnérabilité de son corps ? Sa réponse : doter le phénomène
pathologique de sens, c’est en donner une interprétation naturaliste, le constituer comme un mal de
l’organisation corporelle
11
. Ey lance simultanément un avertissement : cette interprétation
naturaliste est construite à un niveau spécifique entre une physique et une éthique qui menacent
constamment d’en compromettre la progression
12
. Cet avertissement pointe très exactement une
des difficultés de la connaissance et de la pratique médicales : elles ont à se déployer au niveau
d’une connaissance objective tout en s’articulant à une éthique. Autrement dit, la médecine doit
trouver son lieu propre : être à la fois une approche objective, scientifique et une approche éthique.
10
Pour une approche plus développée des enjeux philosophiques de cette thèse, voir : M.-L.DELFOSSE,
« Euthanasie et intégrité. Enjeux de la loi belge et relation médecin-patient : une réflexion éthique », Frontières,
2011-2012, vol. 24, n° 1 et 2, p. 105-112.
11
H.EY, Naissance de la médecine, p.10.
12
Idem, p.3.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%