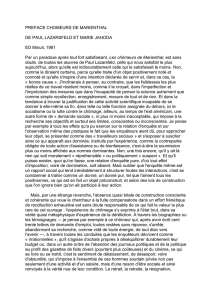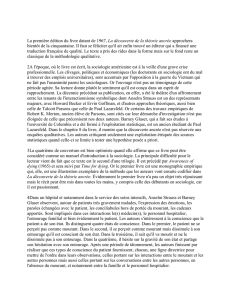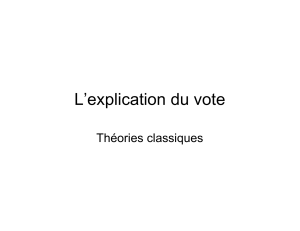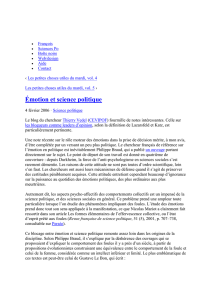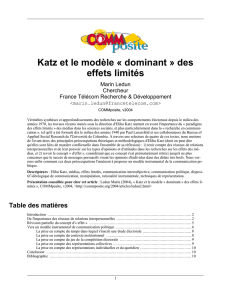L`impact des médias, les modèles théoriques

1

JEAN·LOUIS
MISSIKA*
L'IMPACT
DES
MÉDIAS:
LES
MODÈLES
THÉORIQUES**
Le
modèle de Paul Lazarsfeld demeure la principale référence théo·
rique de l'analyse de l'influence
des
médias sur
les
individus.
D'autres approches (critique, p9litique, technologique) ont
cherché
à
réfuter
ou
à renouveler
ce
modèle.
D
ÈS
LES PREMIERS pas des
recherches en sciences
de
la
communication, la question de
l'influence des médias sur les individus
a constitué
un
des
principaux
objets
d'investigation des chercheurs. A la
suite des travaux fondateurs de Harold
H. Lasswell, et surtout
de
ceux de Paul
Lazarsfeld, de nombreux modèles d'in-
terprétation se sont progressivement
construits.
L:essentiel de
ces
travaux est d'origine
anglo-saxonne. En France, les recher-
ches sur
la
communication médiatique
ne
se
sont développées que ponctuelle-
ment
et tardivement,
et
aujourd'hui
encore, il n'existe pas à
proprement
parler une
communauté
scientifique
constituée sur
la
question. A l'exception
notable de Georges Friedmann gui a
discuté
les
thèses de Paul Lazarsfeld, de
Theodor Adorno, etc. (1), ou de Jean
Cazeneuve (2), il n'y a pas eu d'inser-
tion de la
communauté
scientifique
française dans le
débat
international.
Cette déconnexion s'explique
par
le
fait gue les médias
ont
été rapidement
pris
comme
objet d'analyse
par
la
frange
la
plus radicale de la sociologie.
Le paradigme (3)
de
P.
Lazarsfeld,
modèle dominant d'interprétation dans
le monde, s'est retrouvé paradoxale-
ment
ultraminoritaire en France.
En
* Maitre
de
conférences à l'Institut d'études politiques
de Paris.
** Sciences Humaines,
n'
13
, janvier
1992,
revu
par
l'auteur, juillet
1998.
1.
Dans Sept
études
sur
l'homme
et
la technique,
Denoël,
1966.
2.
J.
Cazeneuve,
Les Pouvoirs de la télévision, Gallimard,
1970;
L'Homme téléspectateur, Denoël,
197
4.
3.
Voir
mots clés en fin d'ouvrage.
287

LES MÉDIAS
ET
LA
COMMUNICATION
DE
MASSE
revanche,
la
pensée critique, autour de
l'Ecole
de
Francfort
(4)
, était en posi-
tion dominante, mais dans un registre
caricatural, sans aucune volonté de
se
confronter à une sociologie pratique
avec
la
mise en place
d'une
méthodo-
logie de recherche et des enquêtes sur
le
terrain.
Des
effets limités
et
indirects
Le paradigme
de
P.
Lazarsfeld, établi à
l'aube
des années 40, reste dans une
certaine mesure
la
référence dominante,
aujourd'hui encore.
TI
peut être réswné
en quelques mots : les médias ont des
effets limités, indirects et à court terme.
Il s'agit
donc
d'une
théorie des effets
puisque
P.
Lazarsfeld s'est principale-
ment intéressé à l'influence des médias
sur l'opinion.
Il
s'inscrit dans
le
courant
de
la
sociologie empirique et s'est natu-
rellement
porté
sur
l'analyse du court
terme
dans
ses ouvrages les plus
connus. Ces travaux, contrairement aux
analyses
précédentes
datant
des an-
nées
30
(le
modèle
de
la
seringue hypo-
dermique, dans lequel les médias sont
conçus comme inoculant directement
les
messages dans
la
tête des gens), ont
montré
que
l'individu possède des
outils de défense et des filtres.
Il
utilise
trois niveaux
de
sélectivité par rapport
aux messages médiatiques :
-l'exposition sélective: l'attention por-
tée à tel
ou
tel message
dépend
de
la
relation personnelle
que
l'individu
entretient avec cette information. Autre-
ment dit, les individus sélectionnent
les
informations auxquelles
ils
sont expo-
sés,
en fonction de leur socialisation, des
contraintes techniques,
de
leur éduca-
tion, de leur histoire personnelle, etc.
?JUI
Un
sympathisant
d'un
parti politique,
par exemple, aura tendance à s'exposer
aux messages politiques qui sont en
accord avec ses préférences. Inverse-
ment, il évitera
d'être
confronté aux
«opinions opposées» ;
-la
perception sélective : nous ne per-
cevons qu'une partie des messages aux-
quels nous nous exposons, et nous en
rejetons d'autres. Ainsi, lorsqu'une per-
sonne regarde un journal télévisé, elle
ne saisit réellement (immédiatement
après l'écoute)
que
20 à
30%
de l'en-
semble des sujets traités;
-
la
mémorisation sélective : nous ne
nous souvenons que de manière impar-
faite
de
la partie
que
nous avons per-
çue, nous n'en retenons que quelques
éléments.
Cette
sélection par
la
mémoire
s'effectue en fonction du
cadre
de
pensée, des préférences cul-
turelles et
de
la vision du
monde
de
l'individu concerné.
:Ceffet
de
la
communication médiatique
n'est pas seulement limité, il est aussi
indirect:
en
1955,
Elihu Katz et Paul
Lazarsfeld établissent l'hypothèse de
«la
communication à deux niveaux»
(Two-step flow
of
communication), puis
à plusieurs niveaux
(5).
Ce
faisant,
ils
remettent
en cause la vision d'une
société composée d'individus atomisés
d'un
côté, et
de
médias de l'autre. Ils
soutiennent au contraire que l'influence
des médias s'
opère
par
un système
complexe d'influences et de filtrages.
Les groupes de référence (communauté
de travail, associations, syndicats,
rela-
4.
Voir
mots
clés en fin d'ouvrage.
5.
E.
Katz
et
P.
Lazarsfeld, Personnallnfluence: the Part
P/ayed
by
the People
in
the Row
of
Mass Communic<r
tian,
Free
Press,
1955.
L'IMPACT
DES
MÉDIAS :
LES
MODÈLES THÉORIQUES
rions
familiales
et amicales, etc.) dans
les-
quels sont insérés
les
individus, et l'exis-
tence de leaders d'opinions au sein
de
ces groupes, ont une importance déci-
sive.
La première diffusion
du
message
des médias s'effectue de façon verticale,
en direction des leaders d'opinion. Elle
se
poursuit à l'intérieur
du
groupe,
de
manière horizontale, par l'intermédiaire
des leaders. Ce processus horizontal
s'opère par des discussions, réinterpré-
tations, prises de positions, rejets.
E. Katz et
P.
Lazarsfeld
introduisent
donc un niveau
de
médiation supplé-
mentaire. Certes, les médias touchent
directement
les
individus, mais lorsque
ceux-ci rencontrent des difficultés pour
s'approprier
ou
interpréter
le
message,
ils
se
tournent vers leurs groupes d'ap-
partenance.
De
ce
fait,
les
messages que
délivrent les médias
sont
soumis à
la
pression des groupements quels qu'ils
soient et reflètent en grande partie les
opinions et idéologies préétablies
de
ces
derniers. Dans cette perspective, les
médias, et en particulier la télévision,
sont, sauf exception (lorsqu'il y
a,
comme aujourd'hui, crise vis-à-vis des
leaders, ou désir
de
changement
de
la
part des individus
ou
des groupes) des
outils de renforcement d'opinion et non
pas de changement d'opinion.
De nouveaux modèles
interprétatifs
Depuis ces travaux fondateurs, le
modèle interprétatif
de
P.
Lazarsfeld a
donné
lieu à
de
multiples tentatives
d'approfondissement
ou
de
fondation
de nouveaux paradigmes
(6).
Parmi ces
différentes approches, nous nous limi-
terons à présenter sommairement les
trois courants principaux :
le
paradigme
critique de l'Ecole de Francfort,
le
para-
digme politique, établi
par
les théori-
ciens
de
la fonction
d'agenda
des
masses-médias, le paradigme technolo-
gique établi
au
cours des années
60,
dont
la
figure la plus connue est Mar-
shall McLuhan (7).
Le questionnement
de
P.
Lazarsfeld,
nous dit E. Katz, postulait que les
médias
indiquent
aux
gens
<<ce
qu'il
faut penser». Les théoriciens cri-
tiques (8) considèrent que cette idée
est
fausse :
pour
eux, fondamentalement,
les
médias prescrivent «ce qu'tl ne faut
pas penser»
Oa
révolution,
le
change-
ment,
la
modification des situations
col-
lectives et individuelles).
Pour
les
pro-
moteurs du paradigme politique (9),
les
médias disent aux individus «ce à
quoi
ils doivent penser».
Il
ne s'agit pas
d'inoculer ou
de
transmettre des opi-
nions
sur
tel
ou
tel sujet,
il
s'agit de
déterminer quels sont
les
sujets impor-
tants, ceux auquel
les
gens doivent s'in-
téresser.
Dans
cette perspective, les
sujets dont
on
ne parle pas ne sont pas
importants. Les médias remplissent une
fonction d'agenda (10), c'est-à-dire de
sélection,
par
les journalistes et
les
pro-
fessionnels des médias, des faits majeurs
parmi
la
masse des informations qui
sont émises et qui circulent.
Dans
le
paradigme technologique enfin, les
médias sont conçus comme des opéra-
6.
E.
Katz. "
La
recherche en communication depuis
Lazarsfeld
",
Hermès, n" 4,
1987.
7.
Voir,
dans ce volume, l'article d'Alexandrine
Civard-
Racinais.
p.
297.
8. Principales figures : Theodor Adorno, Max Horkheimer.
Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Jurgen Habermas.
9.
En
particulier Maxwell McCombs et Donald
Shaw.
10.
Voir
mots clés en fin d'ouvrage.

LES MÉDIAS
ET
LA
COMMUNICATION
DE
MASSE
teurs
de
la
pensée
: ils modifient la
façon de voir
le
monde. Ainsi
la
récep-
tion et
la
transmission, par
les
individus,
des messages écrits diffère fondamen-
talement
de
celles des messages audio-
visuels: à tel point que l'on peut oppo-
ser une civilisation
de
l'écrit à une
civilisation de l'image électronique. Ce
dernier paradigme s'intéresse au long
terme et
non
au court terme.
Les
changements
du
contexte politique
Si
la
démarche critique
de
T.
Adorno et
de
H.
Marcuse remettait en cause les
fondements
du
modèle
de
P.
Lazars-
feld, le paradigme politique, établi dans
les
années 70, peut être analysé comme
une tentative
pour
sauver
le
point de
vue
de
P.
Lazarsfeld. Il
adopte
une
approche empirique, qui a permis d'in-
terpréter des phénomènes que
le
para-
digme de
P.
Lazarsfeld ne pouvait expli-
quer : les
tenants
de
ce
courant
ont
montré,
par
exemple,
que
lorsque les
médias
mettent
en lumière un pro-
blème
que
les individus considèrent
comme important,
ils
ont
un effet puis-
sant, sans
pour
autant modifier la struc-
ture des opinions individuelles
(11).
En outre,
le
contexte politique a singu-
lièrement changé depuis que
P.
Lazars-
feld s'interrogeait dans
un
monde sans
télévision, où l'identification partisane
était très forte. Depuis, le phénomène
de
l'électorat flottant s'est développé:
les
électeurs se déterminent en fonction
d'un
problème
(par
exemple
le chô-
mage, l'insécurité
...
)
et
non pas
d'un
choix global qui résulterait d'une idéo-
logie.
Une
fraction
de
la
population
témoigne à
la
fois d'une faible apparte-
290
nance partisane, et
d'un
fort intérêt
pour
la
politique. C'est dans
les
médias
que ces personnes vont puiser
les
élé-
ments
de
leurs choix. Lorsque 20
ou
30%
d'un
électorat refuse de
se
définir
comme républicain ou démocrate aux
Etats-Unis,
ou
en France, de gauche
ou
de
droite, les
données
du problème
sont radicalement changées. Cette évo-
lution,
peut-être
liée à l'élévation
du
niveau d'éducation et à
la
généralisation
des masses-médias, aboutit à renforcer
le
rôle des messages médiatiques.
La
fin
de la fracture
empirisme/critique?
Au
cours
de
la
période
récente, plu-
sieurs évolutions marquantes se sont
manifestées. En premier lieu, des cher-
cheurs s'inscrivant dans le courant cri-
tique
ont
commencé à mettre
en
place
des processus
de
recherches empi-
riques :
les
travaux de David Morley sur
les
réactions face au journal télévisé en
Grande-Bretagne ne seraient pas reniés,
au
plan
de
l'enquête,
par
des socio-
logues empiristes américains (12). Il
s'agit,
par
exemple,
de
construire le
concept
de
knowledge
gap.
Ce terme
désigne le fossé culturel qui peut exis-
ter
entre
différents individus ou diffé-
rents groupes sociaux :
il
est un obstacle
à
la
communication, à l'acquisition des
savoirs, et plus généralement à la capa-
cité à
décoder
et
de
donner
un sens à
des informations.
Nous
avons
là
un
11.
G.R.
Funkhouser, "The Issues of the Sixties :
an
Exploratory Study
in
the Dynamics
of
Opinion
...
Public
Opinion Quarter/y,
n'
37, 1973.
12.
D.
Morley,
Nationwide
Audience : Structure
and
Decoding. British
Rlm
lnstitute.
1980
;
T.
GiUin
(dir.).
Wat-
ching Television, Pantheon, 1987.
L'IMPACT
DES
MÉDIAS : LES MODÈLES THÉORIQUES
concept
critique typique, construit à
partir d'une enquête de terrain.
De leur côté,
les
chercheurs empiriques
s'interrogent sur des notions
qu
'
ils
uti-
lisaient jusqu'à présent comme des don-
nées
:l'opinion
publique, l'informa-
tion, etc. La grande ligne de fracture
entre empirisme et critique, qui était
l'une des caractéristiques
de
la
sociolo-
gie
de
la
communication depuis les
années 50, est en train de se combler et
laisse
la
place à
de
nouvelles contro-
verses scientifiques.
En second lieu, des chercheurs
pr
a
ti-
quent «
un
écl
e
ctis
me
de
bon
aloi».
Ils
cherchent, ch
ez
les linguistes pragma-
tistes, chez E. Goffman,
de
nouveaux
outils d'interprétation.
Nous
sommes
donc dans une période
de
refondation.
Mais
le
travail accumulé par
la
sociolo-
gie de
la
communication demeure une
base de départ essentielle.
291.

1
1
1
:
l'IMPACT
DES
MÉDIAS :
LES
MODÈLES THÉORIQUES
Sommes-nous
manipulés?
Les
théories
sur
l'impact
des
médias
Les
interrogations
sur
les
effets
de
masses-médias
sont
aussi
anciennes
que
les
médias
eux-mêmes.
Le
regard
porté
sur
leur
mode
d'influence
est
passé
par
trois
grandes
périodes,
chacune
ayant
apporté
son
lot
de
théories,
dont
les
prolongements
ont
pu
perdurer
bien
au-delà
des
limites
de
leur
période.
L'INFLUENCE
IMMÉDIATE
ET
MASSIVE
(1930-1945)
Dans une première période, la théorie dominante e
st
que les
masses-médias ont
un
effet immédiat, massif et prescriptif sur leur
audience.
La
seringue
hypodennique
Les
médias injectent des idées, des attitudes
et
des modèles de
comportement dans les cerveaux vulnérables
du
public composé
d'individus séparés. C'est pourquoi
on
l'a appelé le modèle de
la
"seringue hypodermique"·
Les
premières observations relèvent
surtout les effets émotionnels de masse de certains messages
(ex.
:l'arrivée des Martiens simulée par Orson Welles
en
1938),
et les effets comportementaux des campagnes de persuasion.
La
domination
idéologique
Les
sociologues critiques de l'Ecole de Francfort (Theodor Adomo,
Max Horkheimer, Herbert Marcuse) théorisent
l'idée
que les
médias (ou "industries culturelles
..
) sont l'instrument de diffu-
sion de l'idéologie dominante. Leur influence consiste dans une
uniformisation des cadres de pensée
et
des comportements
dans le sens de l'acceptation
du
système capitaliste.
Ce
cou-
rant a été important
en
France
dans les années
70
et
conserve
des partisans.
lEs
EFFETS
LIMITÉS
(1945-1960)
Les enquêtes détaillées menées dans les années
40
et
50
aux
Etats-Unis
ont
bousculé l'image
d'une
toute
puissance des
médias sur l'opinion publique. Elles ont fait apparaître
un
modèle
plus complexe d'influence
et
attiré
l'attention
sur
le pouvoir
exercé par le public de choisir les informations qui l'intéressent.
Le
modèle
" à
deux
temps " ( tw05tep
flow)
A partir d'études empiriques
Paul
Lazarsfeld,
Elihu
Katz
(The
Peo-
p/e's
Choice,
1948,
Persona! Influence,
1955)
montrent que
?0-:l
 6
6
 7
7
1
/
7
100%