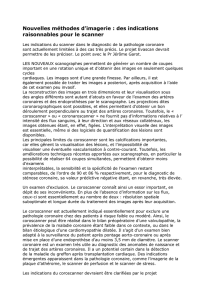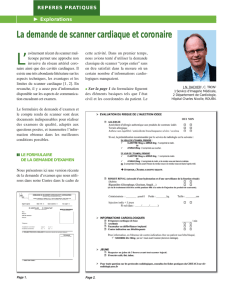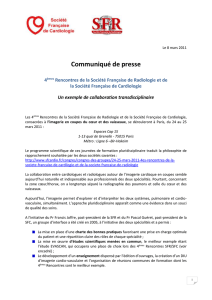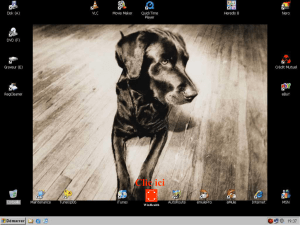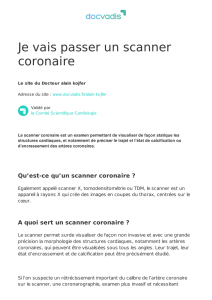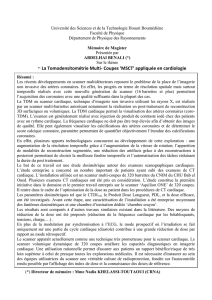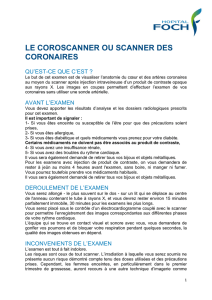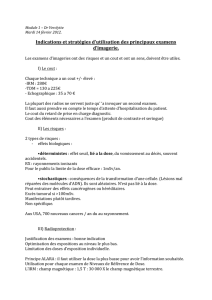p2-ue5-ranouil-imagerie-cardiovasculaire-radio-et-scanner-word

1
UE5 - Ranouil
Imagerie cardio-vasculaire
I. Radiographie thoracique
1. Introduction à la radiographie thoracique
A. Définition
Examen radiologique de base destiné à l’ensemble cœur-poumon
Émission de rayons X
4 incidences : face, profil, oblique antérieur gauche (OAG) 45°, oblique antérieur droit (OAD) 45°. On
ne fait quasiment plus d’OAG et OAD. En pratique seul une ou deux incidences sont effectuées : à
savoir de face et de profil.
Idéalement, le cliché doit être fait en position debout, inspiration profonde, incidence postéro
antérieure (les rayons passent de l’arrière vers l’avant).
Ces conditions réunies définissent le cliché standard.
Parfois, cliché au lit quand on ne peut pas déplacer le malade (mais risque d’erreurs diagnostiques
déformation du cœur, étalement de la silhouette cardiaque, modification de vascularisation pulmonaire)
B. Principe de radiographie
Rayons X découverts en 1895 (19ème siècle) par Rontgen
Mesure de l’atténuation des rayons X par un tissu biologique
Plus un tissu est dense, plus il va arrêter les rayons X (donc les photons) et moins la quantité de lumière qui
va frapper la pellicule derrière, plus l’image sera noire (ou blanche, si on veut son négatif). Et plus les
rayons passent, plus on a de clarté.
Gamme d’énergie des rayons X : 28 à 130 KeV
Sert surtout à analyser les os. En cardiologie, sert surtout pour la morphologie de l’ombre cardio-
médiastinale et la vascularisation pulmonaire.
Imagerie surtout morphologique, étude de la nature et de la forme des tissus
L’inconvénient est qu’il s’agit d’un examen irradiant.
Bases physiques des rayons X
L’image est obtenue en contraste et dépend des tissus traversés :
- Os : éléments calcifiés, absorbant beaucoup les RX, apparaissant comme opaques (surtout quand ils
sont denses et donc jeunes. A l’inverse en vieillissant, l’os devient moins dense chez les
ostéoporotiques)
- Tissus mous (cœur, vaisseaux, médiastin…) absorbant moins les RX, donc moins opaques
- Air (poumons) : RX non absorbés, apparaissent comme clair (et donc noir car les alvéoles
contiennent de l’air qui n’arrête quasiment pas les RX. Cependant les poumons comportent une
vascularisation donc ce n’est jamais totalement noir)
Opacité : aspect blanchâtre (exemple : tumeur qui apparaît anormalement blanche autour du poumon)
Clarté : aspect noirâtre (exemple : pneumothorax)
On a une image en négatif mais si on développait la photo ils apparaitraient en noir (les photons n’ont pas
atteint la plaque).

2
2. Les différents types de clichés
A. De face
Aspect du cœur (silhouette cardio-médiastinale) : pyramide triangulaire (base inférieure et sommet
tronqué)
- Bort droit : quasi vertical
De haut en bas (3 arcs) : TVBCD (tronc veineux brachio-céphalique droit) bord externe de VCS, OD (bord
plus saillant convexe) +/- VCI
- Bord gauche : oblique en bas et en dehors
3 arcs, de haut en bas : bouton aortique (arc supérieur), bord gauche du TAP (arc moyen), bord gauche du
VG (arc inférieur gauche) (et pas le bord droit du VG : c’est le septum qui est en relation avec le ventricule
D et n’apparaît pas sur la radiographie du poumon)
- Sommet : crosse de l’aorte et vaisseaux artériels cervico-céphaliques
- Base : de droite à gauche : OD, VD et pointe du VG
Ces abréviations seront utilisées par la suite dans la ronéo : ASD (Arc Supérieur Droit), AID (Arc Inférieur
Droit : début de la VCI), ASG (Arc supérieur Gauche), AMG (Arc Moyen Gauche) et AIG (Arc Inférieur
Gauche).
Tout cela correspond à la silhouette cardio-médiastinale. On a autour, tout ce qui constitue le thorax, avec
le squelette osseux, puis les champs pulmonaires qui sont plus noirs au niveau du sommet : il y plus d’air
(du fait des lois de l’apesanteur). Il y a plus de liquide aux bases.
ASD : qui est constitué par la veine cave supérieure principalement
AID : oreillette droite et début de la VCI
ASG : bouton aortique
AMG : tronc de l’AP
AIG : Partie gauche du ventricule gauche
B. De profil
Peu utilisé (c’est surtout la radio de face qui est utilisée)
À distance du sternum en avant et du rachis en arrière

3
Permet de voir certaines structures cardiaques que l’on ne peut pas voir de face, avec essentiellement 3
bords :
- postérieur : convexe, OG 2/3 sup puis VG 1/3 inf
- antérieur : aorte ascendante, infundibulum pulmonaire (partie haute du VD) et VD
- inférieur : VD en avant et VG en arrière
.
Ici en A on voit une image de radio classique et en B image « anatomique » pour mieux comprendre la
radio.
En arrière : l’OG. En avant du rachis, on a l’aorte, à peine visible ici. En avant de l’aorte on a l’œsophage,
quasiment non visible évidemment car c’est une cavité virtuelle. En avant de l’œsophage (juste à son
contact), on a l’OG.
Si on transperce le sternum, on tombe d’emblée dans le VD. L’infundibulum pulmonaire (partie haute du
VD) va déboucher sur l’AP, qui va donner un tronc d’AP, puis 2 branches (D et G) mais comme on est de
profil, on ne les voit pas bien…
LA : Atrium gauche
LV : Ventricule Gauche
PA : Artère pulmonaire
A : crosse de l’aorte
RAA : auricule droit constitue l’appendice de l’oreillette droite
3. Les renseignements obtenus grâce à la radiographie thoracique
A. Les structures observables
Cœur : cardiomégalie, hypertrophie, dilatation d’une ou plusieurs cavités (exemple : saillie
anormale des arcs), calcifications (exemple : au niveau de structures valvulaires (aorte) ou au niveau du
péricarde)
Les calcifications ne sont pas faciles à voir. Il faut qu’elles soient vraiment très importantes pour espérer
pouvoir les voir à la radio. Donc si on voit ces calcifications à la radio, c’est qu’elles sont probablement
massivement calcifiées.
Gros vaisseaux : morphologie du pédicule vasculaire (aorte I et II, Ca2+, dilatation, anévrysme,
pathologie des artères pulmonaires (congénitales ou acquises))

4
Coronaires : Ca2+ , on ne voit généralement pas les coronaires, cependant, ce qu’on peut voir, c’est
leurs calcifications éventuelles (rare).
Retentissement de la cardiopathie sur la circulation artérielle et veineuse : sang de stase
(augmentation de la quantité de sang augmentation de la trame pulmonaire, qui sera alors
anormalement visible, alors qu’elle n’est pas très importante chez un individu sain).
Pathologies pulmonaires
Anomalie de la cage thoracique :
- parfois associée à une maladie cardiovasculaire
exemple : pectum excavatus
Analyse des appareils de stimulation cardiaque (boitier de pacemaker et sondes) et des valves
cardiaques
B. Les mesures importantes
Un élément classique à mesurer en radio : Index cardiothoracique (= ICT = RCT) :
- RCT = rapport entre diamètre cardiaque transverse (somme de la flèche de l’arc inférieur D et de
l’arc inférieur G (pas toujours la même hauteur) / diamètre thoracique transverse (ligne tracée à la
partie supérieure de la coupole diaphragmatique droite, entre les bords internes des espaces
intercostaux)
- N < 0,50. Ce rapport est normalement inférieur à 0,50.
- Cardiomégalie si > 50%. On considère qu’au-delà il s’agit d’une cardiomégalie (cardiomégalie :
augmentation du volume du cœur : traduit une cardiopathie sans préciser laquelle, il peut s’agir
d’une cardiopathie hypertrophie ou cardiopathie dilatée hypokinétique,…).
- Inconvénient : Peu fiable, surtout au lit (car quand le sujet est allongé : car étalement de la
silhouette cardiaque)
RCT = (a+b) / c
Plus le RCT est gros, plus le pronostic du patient
est mauvais ; dans les formes majeures le cœur
peut aller jusqu'à proximité de la cage thoracique
avec un RCT proche de 0 ,8 (n’existe quasiment
plus de nos jours).
C. Résultats et interprétations des anomalies
Dilatation de l’OG
- de face : se caractérise par un déplacement de son bord D, qui se superpose au bord de l’OD
image de « double contour ». L’arc inférieur D c’est l’OD. Si on a une OG dilatée qui vient
déborder, une 2ème image vient se superposer à la 1ère et créée un aspect de « double contour ». Donc
on va avoir 2 bords : un pour OD et un pour OG.
- auricule dilatée G apparaissant entre les arcs inférieur et moyen G

5
Si on a une grosse dilatation de l’OG (exemple : rétrécissement mitral), on aura un auricule G très dilaté
également, entrainant une saillie, un dédoublement de l’arc moyen gauche. Permet de faire des hypothèses
diagnostiques.
Le plus souvent, une dilatation de l’OG, c’est un dédoublement du bord inférieur D et éventuellement une
saillie de l’arc moyen G.
En OAD : saillie du bord postérieur de la silhouette cardiovasculaire
Dilatation de l’OD : de face : saillie de l’AID (arc inférieur D) (il est anormalement proéminent. Il n’est
pas dédoublé car il n’y a qu’une seule structure, mais est anormalement gros) et agrandissement du
diamètre transverse.
Augmentation du VG :
- allongement et accentuation de l’arc inférieur G, la pointe du VG plongeant dans la coupole
diaphragmatique G.
Cette augmentation de l’arc inférieur gauche, qui est constitué presque exclusivement par le VG, va venir
s’étaler sur la coupole diaphragmatique G. Cela va entrainer :
- une augmentation de l’ICT
La principale cause de l’augmentation de l’Index CardioThoracique est la dilatation du VG, car il constitue
l’essentiel de l’arc inférieur gauche en terme de volume.
Cependant, même une grosse dilatation de l’OD peut ne pas entrainer d’augmentation de l’ICT.
Augmentation de la taille du VD :
- de face : détachement de la pointe du VG de la coupole diaphragmatique G (le VD le refoule), aspect
de cœur en sabot
- profil et OAG : le VD occupe normalement la partie juste en arrière du sternum. S’il est
anormalement gros on aura donc un comblement de la partie supérieure de l’espace clair rétrosternal,
par l’infundibulum pulmonaire
Radio de face : Saillie de l’arc inférieur G
(comblement de cet espace clair rétro-sternal)
avec un aspect de cœur en sabot évocateur
d’une dilatation du VD. Une partie du VG est
refoulée vers le haut.
Si on a un comblement de l’espace clair pré-
vertébral (ou rétro-cardiaque), c’est en faveur
d’une augmentation de l’OG ou du VG.
4. Intérêts de la radio
La radio est un examen de débrouillage devant une symptomatologie thoracique avec les applications
suivantes :
Bilan de douleur thoracique
Il peut s’agir d’une dilatation de l’aorte, d’un anévrysme (pathologie cardiaque), ou d’une pathologie
pulmonaire ou encore d’une pathologie costale.
Bilan de dyspnée
Principales causes de dyspnée : cardiaque ou pulmonaire (pas les seules mais en grande majorité)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%