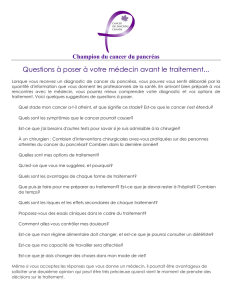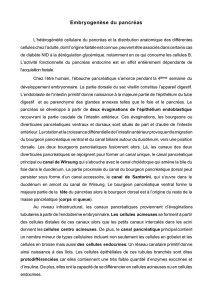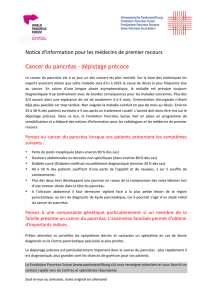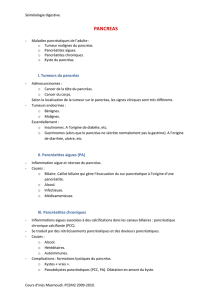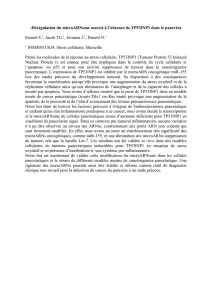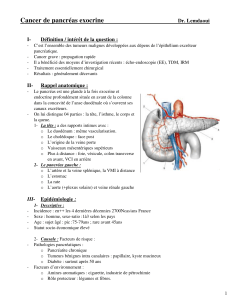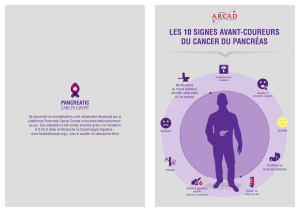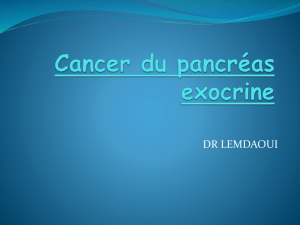Mise au point

-6-
Mise au point
Au cours des dernières années, le dévelop-
pement des techniques d’imagerie (scanner
hélicoïdal et Cholangio-pancréato-IRM) et de
l’écho-endoscopie a permis (1) un diagnostic
plus précoce et une meilleure surveillance des
tumeurs solides, kystiques ou mixtes, bénignes
ou de malignité réduite, et (2) une meilleure
visualisation des rapports anatomiques de ces
lésions avec les structures adjacentes (canal
pancréatique principal, cholédoque, vaisseaux
mésentériques) [4,5]. Ces points ont été des
éléments déterminants pour proposer aux
malades ayant des tumeurs bénignes ou de
malignité réduite, des exérèses pancréatiques
non-réglées ou «atypiques ». Il s’agit princi-
palement de la pancréatectomie médiane (ou
isthmectomie) qui consiste en l’exérèse de
l’isthme (ou de la partie corporéale du pan-
créas), de l’énucléation qui consiste à résé-
quer la tumeur sans exérèse de parenchyme
pancréatique sain, de l’exérèse pancréatique
gauche (PG) ou caudale sans splénectomie, et
de façon beaucoup plus rare l’exérèse du cro-
chet du pancréas (pancréas ventral) [6]. Dans
de rares cas, on peut être amené à éviter une
pancréatectomie totale (PT) en poussant l’exé-
rèse du pancréas au maximum vers la droite ou
la gauche.
Le principal but des exérèses atypiques est
d’obtenir la guérison de la maladie tout en
préservant le maximum de parenchyme
pancréatique fonctionnel et de structures
anatomiques adjacentes (cholédoque, cadre
duodénal, papille, rate). La préservation du
parenchyme pancréatique est particulièrement
importante pour les malades ayant une
pancréatite chronique (PC). Dans le cas
particulier d’une tumeur intracanalaire papillaire
et mucineuse du pancréas (TIPMP), compte
tenu du risque possible d’atteinte diffuse et
surtout de la possibilité d’une récidive, même
après exérèse, une exérèse pancréatique limitée
(avec conservation des vaisseaux spléniques
et périgastriques) est toujours discutée. En
cas de PC symptomatique avec une atteinte
importante du pancréas céphalique et en cas
d’échec du traitement endoscopique, on peut
être amené à proposer des exérèses pancréa-
tiques céphaliques (sans duodénectomie) telle
que l’intervention de Frey ou l’intervention de
Beger [7].
LES DUODÉNOPANCRÉATECTOMIES
« ATYPIQUES »
Après DPC, le bénéfice fonctionnel de la conser-
vation du pylore, et la supériorité de l’un ou
l’autre type d’anastomose pancréatico-digestive
(pancréatico-jéjunale ou pancréatico-gastrique)
assurant la meilleure fonction exocrine ne sont
pas démontrés. Globalement, la DPC pour cancer
a une mortalité inférieure à 5% dans les centres
spécialisés et sa morbidité est entre 25-55 %,
essentiellement représentée par les fistules
pancréatiques (plus fréquentes lorsque le
parenchyme pancréatique est normal), les
troubles de vidange gastrique, les complications
infectieuses et hémorragiques [3,8]. Le risque
de diabète après DPC pour cancer est inférieur
à 10 % [6]. Sur le plan chirurgical, la PT
(ou la totalisation d’une pancréatectomie
antérieure) est l’intervention qui expose
théoriquement à un risque plus important de
PEUT-ON RÉALISER DES PANCRÉATECTOMIES
« ATYPIQUES »?
Les exérèses
pancréatiques
partielles se
sont longtemps
limitées
à la spléno-
pancréatectomie
gauche (SPG) et à
la duodéno-
pancréatectomie
céphalique (DPC)
sans conservation
du pylore
(intervention de
Whipple).
Elles permettent
une exérèse large
du pancréas
et des structures
avoisinantes
avec un curage
ganglionnaire et
restent largement
indiquées
pour traiter
l’adénocarcinome
et les autres
tumeurs malignes
du pancréas [1-3].
Figure 1 : Scanner montre un canal secondaire dilaté à la jonction
entre l’isthme-tête et le crochet du pancréas découvert à l’occasion
de plusieurs crises de pancréatite aiguë.

Mise au poinT
-7-
dévascularisation gastrique surtout en cas de section
des vaisseaux spléniques et/ou peri-gastriques. Elle
entraîne toujours une insuffisance exocrine complète
et surtout un diabète insulino-dépendant parfois très
difficile à équilibrer avec un risque important d’ac-
cidents hypoglycémiques [6]. La mortalité à long
terme après PT a conduit à préserver dans la mesure
du possible un fragment de queue du pancréas en
cas d’affection maligne ou à réaliser des greffes d’îlots
pancréatiques [9,10]. En cas de TIPMP à prédomi-
nance céphalo-isthmo-corporéale, il est parfois néces-
saire de pousser la DPC vers la gauche tout en évitant
une PT, sous réserve de plusieurs recoupes pancréa-
tiques gauches et l’absence de signe de dysplasie sur
le canal pancréatique principal et/ou de dysplasie de
haut grade sans les canaux secondaires à l’examen
extemporané [11]. Dans ces cas, l’insuffisance
pancréatique exocrine est de règle. Les avantages
théoriques de cette intervention sont la meilleure
prise en charge sur le plan endocrine et la préservation
de la vascularisation veineuse gastrique, même après
section des vaisseaux gastro-épiploïques droits.
Cependant, contrairement à la PT, elle ne permet pas
d’éviter la surveillance du moignon pancréatique
restant.
PANCRÉATECTOMIES GAUCHES
« ATYPIQUES »
Les pancréatectomies gauches (PG) incluent la
splénopancréatectomie gauche (SPG), les pancréa-
tectomies caudales (ou corporéo-caudales) sans
splénectomie et les PG (avec ou sans conservation
splénique) « poussées à droite ». Le taux de mortalité
est moindre que la DPC de l’ordre de 1-2 %. La
principale complication postopératoire est la survenue
de fistule (15-20 %). Les deux complications à
distance sont la survenue d’un diabète et les
complications infectieuses liées à la splénectomie
[12-16]. La SPG reste indiquée pour les malades ayant
un cancer du pancréas gauche. Elle est parfois faite
de principe (PC avec hypertension portale segmentaire)
ou de nécessité (difficulté technique de préservation
de la rate et/ou vaisseaux spléniques du fait de
l’inflammation peripancréatique). La splénectomie
ajoute un risque thrombo-embolique persistant dans
le mois suivant l’exérèse et surtout majore le risque
d’infections bactériennes postopératoires et à distance
[12-16]. Le point important est que le risque de
mortalité liée aux infections bactériennes, qui
surviennent le plus souvent dans les 2 années suivant
la splénectomie, est 10 à 50 fois plus élevé par rapport
à la population générale
avec une gravité et une
évolution parfois fulmi-
nante chez les jeunes
enfants, et les adultes
immunodéprimés [12-16].
Il est donc recommandé
d’informer les malades et
leurs médecins traitants
concernant ce risque
(carnet de santé) [13-17].
De façon non consensuelle,
il est conseillé de pres-
crire une antibioprophy-
laxie à base de pénicilline
A au moins pendant 2
ans et dès suspicion
d’infection bactérienne
ORL, pulmonaire ou
méningée [13-17]. Les
malades doivent être
vaccinés quelques
semaines avant l’interven-
tion (ou à défaut quelques
semaines après la chirur-
gie) contre les souches de
Streptoccocus pneumoniæ ;
les vaccinations contre
Hemophilus influenzae
type b et Neisseria menin-
gococcus restent recom-
mandées chez les enfants
et les immunodéprimés
[13-17]. Ainsi, en cas de
tumeur bénigne (tumeur
endocrine, TIPMP bénigne,
cystadénomes bénins) ou
de PC sans hypertension
portale segmentaire, on
tentera de préserver la
rate chaque fois que les
conditions locales le per-
mettent. Dans ce cas, les
vaisseaux spléniques sont habituellement disséqués
à la face postérieure du pancréas et conservés. Plus
simplement, ils peuvent aussi être réséqués avec la
pièce de pancréatectomie, la rate restant alors
vascularisée par les vaisseaux courts et l’arcade gastro-
épiploïque [18].
Dans la SPG, la section est classiquement effectuée
au niveau de l’isthme. Au cours des TIPMP, ou en cas
d’envahissement de la tranche de section par une
Figure 2 : La cholangiowirsungoIRM montre la dilatation
d’un canal secondaire isthmique sans dilatation du canal
pancréatique principal.
Figure 3 : Enucléation d’un canal secondaire de l’isthme du
pancréas : l’analyse anatomopathologique a révélé une tumeur
intracanalaire papillaire et mucineuse non dégénérée.

-8-
Mise au point
tumeur bénigne à potentiel de
malignité (cystadénome muci-
neux, tumeur endocrine, tumeur
pseudopapillaire solide et kys-
tique), l’exérèse gauche peut
être étendue vers la tête du
pancréas. Dans ce cas, elle
nécessite le plus souvent le
décollement de l’artère gastro-
duodénale, et la limite droite et
postérieure de l’exérèse est le
bord antéro-gauche du cholé-
doque intrapancréatique qui est
préservé. Après exérèse, le
canal pancréatique principal et
la tranche pancréatique sont
fermés sur eux-mêmes sans
anastomos pancréato-
digestive. La résection paren-
chymateuse est d’environ 75 %
en cas de section au niveau de
l'isthme, d’environ 50 % lorsque
la section est localisée à
gauche de la région cœliomésentérique, et
d’environ 90 % lorsque la section porte devant
la voie biliaire principale. Les PG n’entraînent
en général pas d’insuffisance pancréatique
exocrine (même après section isthmique) sauf
en cas de pancréatopathie sous-jacente [6].
A l’inverse, si elles intéressent 75 % ou plus du
parenchyme pancréatique, elles peuvent
entraîner sur pancréas sain l’apparition
d’un diabète (2-10%). Sur PC, les PG majorent
nettement le risque de survenue ou l’aggra-
vation d’un diabète lié à l’évolution de la
maladie.
PANCRÉATECTOMIE
MÉDIANE
La pancréatectomie médiane (ou pancréatec-
tomie segmentaire centrale, ou isthmectomie)
emporte l'isthme et éventuellement la partie
médiane du corps. La tranche pancréatique est
suturée du coté céphalique et anastomosée à
une anse jéjunale en Y ou à l'estomac du coté
corporéal. Cette intervention est indiquée pour
des tumeurs bénignes ou de faible malignité
non accessibles à une énucléation en raison de
leur rapport étroit avec le canal de Wirsung. Les
limites de cette exérèse sont prédéfinies par les
examens morphologiques pré et peropératoires.
Le risque postopératoire immédiat de la
pancréatectomie médiane est la fistule
pancréatique (20-40 %) [19-21]. Les consé-
quences fonctionnelles de cette intervention
sont très limitées. La glycémie à jeun et après
charge orale en glucose est généralement
normale. Dans une série rassemblant 53
malades, le risque de diabète et celui d’insuf-
fisance exocrine traitée par extraits pancréa-
tiques étaient inférieurs à 5 %, sauf chez les
malades opérés pour TIPMP pour lesquels ces
risques étaient plus élevés [19]. La fonction
exocrine post-opératoire (mesure de la stéa-
torrhée, test d'absorption d'un peptide labile en
présence de chymotrypsine) est normale chez
plus de 90 % des malades. Ces résultats
suggèrent que la pancréatectomie médiane
évite le risque de diabète lié à la pancréatec-
tomie gauche et celui d'insuffisance exocrine
liée à la DPC. Au cours de pancréatectomie
médiane, l’exérèse est parfois élargie vers la
droite et/ou la gauche essentiellement en
présence d’une TIPMP bénigne. Dans ce cas, le
PEUT-ON RÉALISER DES PANCRÉATECTOMIES « ATYPIQUES » ? (SUITE DE LA PAGE 7)
Figure 4 : Cystadénome mucineux bénin de la
partie postéro-inférieure du corps du pancréas
située à distance du canal de wirsung accessible
à une énucléation.
Figure 5 : Tumeur endocrine bien différenciée de moins (< 2 cm) non fonctionnelle de l’isthme du pancréas venant au contact du canal de wirsung.
L’intervention la plus adaptée est la pancréatectomie médiane.
le moignon gauche
sera anastomosé
à l’estomac ou au
jéjunum
le moignon céphalique
sera fermé sur lui-
même

Mise au poinT
-9-
moignon droit est suturé après examen extemporané
sur lui-même et la partie gauche du pancréas, selon
sa taille, est soit anastomosé à l’estomac (ou au
jéjunum sur une anse en Y), soit fermée sur lui-même
[19-21].
ENUCLÉATION
Une énucléation consiste en l'ablation d'une tumeur
située au sein du parenchyme pancréatique sans
aucune résection parenchymateuse. Elle est indiquée
pour des tumeurs de petite taille, bien limitées,
bénignes ou à faible malignité, principalement les
tumeurs endocrines bénignes < 2cm, (insulinomes ou
tumeur endocrines non fonctionnelles), ou des
tumeurs kystiques (cystadénome mucineux non dégé-
néré, une exceptionnelle TIPMP bénigne localisée)
situées à distance du canal de Wirsung. Elle n'entraîne
pas de modification de la fonction pancréatique, en
revanche elle expose à un risque élevé de fistule
pancréatique (15-35 %) surtout lorsque le canal
pancréatique est proche de la zone de la dissection
[22]. Ceci souligne l’importance du repérage de la
distance entre le canal et la lésion aussi bien sur les
examens préopératoires (CPIRM et écho endoscopie)
que peropératoires. L’énucléation peut intéresser tous
les secteurs pancréatiques y compris certaines tumeurs
du crochet pancréatique et dans certaines conditions,
comme pour les autres exérèses pancréatiques limitées,
est réalisable sous vidéolaparoscopie [23-25].
EXÉRÈSE LIMITÉE DU CROCHET DU
PANCRÉAS
Il s’agit d’une indication exceptionnelle de l’exérèse
partielle ou totale du pancréas dorsal [256-27]. Elle
s'adresse aux tumeurs bénignes ou à faible malignité,
trop profondes pour être énucléées. Elle est contre-
indiquée pour les adénocarcinomes. Le crochet du
pancréas est souvent abordé de bas vers le haut et
d’arrière en avant et séparé des éléments vasculaires
de l’artère et de la veine mésentérique supérieures et
nécessite la libération de l’angle duodéno-jéjunal.
L’échographie permet de repérer le canal de Wirsung
céphalique. L’indication peut être une TIPMP sympto-
matique sans argument en faveur d’une malignité (taille
< 3cm, absence de bourgeon tissulaire ou d’épaissis-
sement pariétal) localisée aux canaux secondaires du
crochet, trop profonde pour une énucléation, et pour
laquelle on souhaite éviter une DPC. Il est donc capital
de s’aider de l’échographie peropératoire, de repérer la
pièce notamment au niveau de sa jonction avec le
canal pancréatique principal et d’avoir un examen
extemporané sur la pièce d’exérèse, le malade étant
prévenu de la possibilité d’une DPC en cas de dysplasie
sévère.
PANCRÉATECTOMIES CÉPHALIQUES AVEC
CONSERVATION DUODÉNALE
Ces interventions ne sont indiquées que pour les
malades ayant une PC associée à des douleurs
invalidantes et des lésions céphaliques prédominantes
(hypertrophie de la tête, calcifications localisées ou
prédominantes). Sur le plan technique, il est possible
de réaliser soit une résection céphalique ne préservant
qu'une lame de parenchyme pancréatique au contact
du duodénum et de la voie biliaire principale (inter-
vention de Beger), soit un évidement antérieur de la
tête du pancréas laissant du parenchyme au contact
du duodénum et en arrière au contact de l'axe
mésentérico-porte (intervention de Frey) [7]. Le
pancréas gauche est drainé dans une anse jéjunale en
Figure 6 : Duodénopancréatectomie céphalique poussée à gauche ne
laissant qu’un moignon caudal du pancréas fermé sur lui-même.
Flèches blanches : artère et veine spléniques
Flèche jaune : moignon pancréatique
Figure 7 : Intervention de Beger : exérèse du pancréas céphalique
avec conservation du cadre duodénal suivie d’une anastomose
pancréato-jéjunale sur chacune des tranches pancréatiques.

-10-
Congrès
Y par une anastomose
qui porte sur la tranche
pancréatique corporéale
dans la technique de
Beger, ou sur la totalité
du canal pancréatique
et la cavité résultant de
l'évidement dans la
technique de Frey. La
conservation du circuit
duodénal dans ces
interventions semble en
particulier associée à
une meilleure vidange
gastrique qu’après DPC avec conservation du
pylore et permettent par rapport à une DPC
(pour PC) de favoriser une meilleure évolution
pondérale [28]. La fonction endocrine est peu
modifiée par ces interventions. Dans une étude
prospective contrôlée ayant comparé les deux
interventions chez 42 malades avec un suivi
moyen d'une année et demie, un diabète
insulinodépendant était apparu chez 2 des 11
malades (18 %) non-diabétiques avant
l'intervention de Beger et aucun des 12 malades
non-diabétiques avant l'intervention de Frey
[29]. Dans la même étude, 40 % des malades
prenaient des extraits pancréatiques avant
l’intervention quel que soit son type et 50 %
en prenaient après. Du fait de leur bonne
efficacité antalgique, et en comparaison avec
les autres interventions réalisées au cours de
la PC (DPC, PG, dérivation wirsungo-jéjunale),
ces interventions représentent un bon
compromis entre traitement efficace des
douleurs et limitation de la détérioration des
fonctions endocrine et exocrine.
Dr Reza Kianmanesh,
Dr Nicolas Carrere,
Pr Alain Sauvanet,
Service de Chirurgie Digestive,
Hôpital Beaujon
1. Yeo CJ, Cameron JL, Lillemoe KD et al.: Pancreaticoduodenectomy for
cancer of the head of the pancreas. 201 patients. Ann Surg 1995:
221:721-731.
2. Yeo CJ, Cameron JL: Pancreatic cancer. Curr Probl Surg 1999: 36:59-
152.
3. Delpero JR, Giovannini M: [Treatment of pancreatic adenocarci-
noma]. Rev Prat 2002: 52:1534-1539.
4. Zins M, Sauvanet A: [Diagnosis of pancreatic tumors]. Rev Prat 2002:
52:1525-1531.
5. Le Borgne J: [Cystic and intraductal tumors of the pancreas]. Rev Prat
2002: 52:1540-1545.
6. Sauvanet A: [Functional results of pancreatic surgery]. Rev Prat
2002: 52:1572-1575.
7. Partensky C: [Endoscopic and surgical treatment of chronic
pancreatitis]. Rev Prat 2002: 52:1567-1571.
8. Yeo CJ, Cameron JL, Lillemoe KD et al.: Pancreaticoduodenectomy with
or without distal gastrectomy and extended retroperitoneal
lymphadenectomy for periampullary adenocarcinoma, part 2:
randomized controlled trial evaluating survival, morbidity, and
mortality. Ann Surg 2002: 236:355-366.
9. Gruessner RW, Sutherland DE, Dunn DL et al.: Transplant options for
patients undergoing total pancreatectomy for chronic pancreatitis.
J Am Coll Surg 2004: 198:559-567.
10. White SA, Davies JE, Pollard C et al.: Pancreas resection and islet
autotransplantation for end-stage chronic pancreatitis. Ann Surg
2001: 233:423-431.
11. Paye F, Sauvanet A, Terris B et al.: Intraductal papillary mucinous
tumors of the pancreas: pancreatic resections guided by preoperative
morphological assessment and intraoperative frozen section
examination. Surgery 2000: 127:536-544.
12. Schwarz RE, Harrison LE, Conlon KC et al.: The impact of splenectomy
on outcomes after resection of pancreatic adenocarcinoma. J Am
Coll Surg 1999: 188:516-521.
13. Davidson RN, Wall RA: Prevention and management of infections in
patients without a spleen. Clin Microbiol Infect 2001: 7:657-660.
14. Sumaraju V, Smith LG, Smith SM: Infectious complications in
asplenic hosts. Infect Dis Clin North Am 2001: 15:551-65.
15. Ejstrud P, Kristensen B, Hansen JB et al.: Risk and patterns of
bacteraemia after splenectomy: a population-based study. Scand J
Infect Dis 2000: 32:521-525.
16. Waghorn DJ, Mayon-White RT: A study of 42 episodes of
overwhelming post-splenectomy infection: is current guidance for
asplenic individuals being followed? J Infect 1997: 35:289-294.
17. Shatz DV: Vaccination practices among North American trauma
surgeons in splenectomy for trauma. J Trauma 2002: 53:950-956.
18. Balcom JH, Rattner DW, Warshaw AL et al.: Ten-year experience with
733 pancreatic resections: changing indications, older patients,
and decreasing length of hospitalization. Arch Surg 2001: 136:391-
398.
19. Sauvanet A, Partensky C, Sastre B et al.: Medial pancreatectomy :
a multi-institutional retrospective study of 53 patients by the
French Pancreas Club. Surgery 2002: 132:836-843.
20. Rotman N, Fagniez PL: Medial pancreatectomy. J Hepatobiliary
Pancreat Surg 2000: 7:453-455.
21. Christein JD, Kim AW, Golshan MA et al.: Central pancreatectomy
for the resection of benign or low malignant potential neoplasms.
World J Surg 2003: 27:595-598.
22. Talamini MA, Moesinger R, Yeo CJ et al.: Cystadenomas of the-
pancreas: is enucleation an adequate operation? Ann Surg 1998:
227:896-903.
23. Gagner M, Inabnet WB, Biertho L, Salky B: [Laparoscopic
pancreatectomy : a series of 22 patients]. Ann Chir 2004: 129:2-
7.
24. Tagaya N, Kasama K, Suzuki N et al.: Laparoscopic resection of the
pancreas and review of the literature. Surg Endosc 2003: 17:201-
206.
25. Masson B, Sa-Cunha A, Laurent C et al.: [Laparoscopic
pancreatectomy : report of 22 cases]. Ann Chir 2003: 128:452-456.
26. Sakamoto Y: Dorsal pancreatectomy with preservation of the ventral
pancreas. Surgery 2003: 134:845.
27. Thayer SP, Fernandez-del Castillo C,Balcom JH, Warshaw AL:
Complete dorsal pancreatectomy with preservation of the ventral
pancreas: a new surgical technique. Surgery 2002: 131:577-580.
28. Frey CF, Mayer KL: Comparison of local resection of the head of the
pancreas combined with longitudinal pancreaticojejunostomy (frey
procedure) and duodenum-preserving resection of the pancreatic
head (beger procedure). World J Surg 2003: 27:1217-1230.
29. Izbicki JR, Bloechle C, Knoefel WT et al.: Duodenum-preserving
resection of the head of the pancreas in chronic pancreatitis. A
prospective, randomized trial. Ann Surg 1995: 221:350-358.
Références
Figure 8 : Intervention de Frey : évidement partielle de
la tête du pancréas suivie d’une anastomose pancréato-
wirsungo-jéjunale sur une anse en Y.
1
/
5
100%