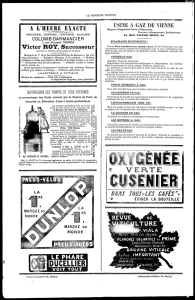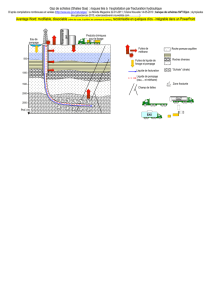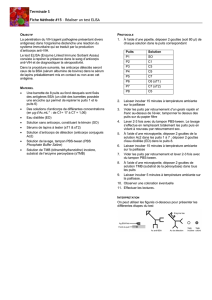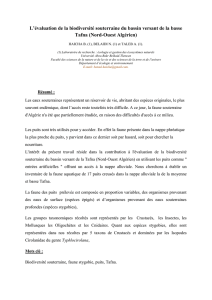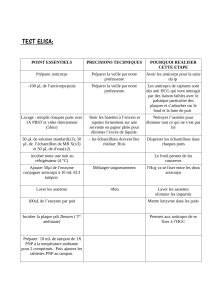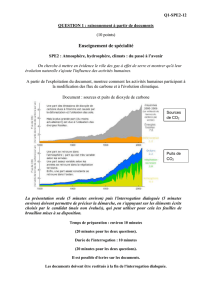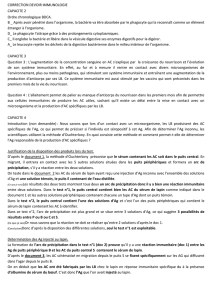Rapport en Français - Infoterre

Modélisation de l'influence des
variations de pression barométrique
sur le profil de concentration dans un
piézomètre.
Contexte du Plateau de Saclay
(France)
BRGM/RP-63870-FR
Septembre 2014
D. Thiéry


Modélisation de l'influence des
variations de pression barométrique
sur le profil de concentration dans un
piézomètre.
Contexte du Plateau de Saclay
(France)
BRGM/RP-63870-FR
Septembre 2014
Recherche réalisée dans le cadre des projets
de développement du BRGM 2013-2014
D. Thiéry
Vérificateur :
Nom : Yves Barthélemy (D3E/GDR)
Date : 25/08/2014
Signature :
Approbateur :
Nom : Serge Lallier
Directeur adjoint de D3E/DIR
Date : 25/08/2014
Signature :
Le système de management de la qualité et de l’environnement
est certifié par AFNOR selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Mots-clés :
En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :
Thiéry D. (2014) – Modélisation de l'influence des variations de pression barométrique sur le profil de
concentration dans un piézomètre. Contexte du Plateau de Saclay (France). BRGM/RP-63870-FR, 35 p.,
24 fig.
© BRGM, 2014, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM.

Influence de la pression barométrique sur la stratification
BRGM/RP-63870-FR – Rapport final 3
Synthèse
Pour déterminer la stratification de pollutions dans un aquifère, il est classique de faire des
mesures dans des piézomètres d’observation. Plusieurs techniques sont possibles, dont
notamment :
introduction d’une chaîne verticale de capteurs passifs suspendue dans le piézomètre, de
façon à déterminer où se situe la pollution ;
réalisation de « pompages ponctuels », entre « packers » (ou obturateurs ») positionnés à
différentes profondeurs, ou au moyen d’un procédé d’échantillonnage sélectif multi-niveaux
(p. ex. dispositif mobile à trois pompes superposées).
Dans un certain nombre de cas, l’utilisation de capteurs passifs, sans pompage, met en
évidence une concentration uniforme ou quasi uniforme sur toute la hauteur du piézomètre,
alors que des « pompages ponctuels » montrent un profil de concentration nettement stratifié.
Il est donc nécessaire d’expliquer les divergences constatées entre les résultats fournis par ces
deux approches, afin de mieux définir leurs périmètres d’utilisation respectifs.
Ce rapport s’attache à comprendre et à modéliser les phénomènes mis en jeu.
Les ordres de grandeur des paramètres utilisés correspondent à ceux du Plateau de Saclay,
l’un des cas où ont été observées de nettes divergences entre profils de concentration obtenus
par chaîne de capteurs passifs et par « pompages ponctuels ».
L’analyse hydrogéologique détaillée de la zone du Plateau de Saclay montre que l’aquifère des
Sables de Fontainebleau comporte une épaisse zone non saturée (ZNS), scellée par une
couche superficielle d’argiles imperméables à l’air. Dans ce contexte, les piézomètres
d’observation montrent des oscillations rapides de niveau, directement corrélées à la pression
barométrique, alors que la nappe elle-même, libre et de grande extension, évolue très
lentement du fait de son inertie importante. Les oscillations « barométriques » observées dans
les piézomètres s’expliquent par la couverture argileuse superficielle qui joue un rôle d’écran
entre l’atmosphère et la ZNS.
L’une des hypothèses formulées pour expliquer les divergences constatées sur les profils de
concentration selon le dispositif de mesure utilisé, est que, dans le tubage du piézomètre
d’observation, les oscillations de niveau provoquées par les variations de la pression
atmosphérique brassent et homogénéisent la colonne d’eau, avec pour conséquence le fait que
celle-ci ne reflète plus exactement la distribution verticale des concentrations dans la nappe
alentour.
Pour vérifier la validité de cette hypothèse, on a utilisé le code de calcul MARTHE du BRGM
(Thiéry 1993, 1995, 2010a, 2010b, 2010c, 2014) pour modéliser l’influence d’oscillations
barométriques sur un profil de concentration dans un piézomètre d’observation.
À l’issue d’une série de simulations, il apparaît en effet que des variations barométriques
cycliques, de l’ordre de 60 cm d’eau d’amplitude sur 3 jours, peuvent conduire, après une
période de l’ordre de 1 à 3 ans, à une homogénéisation du profil de concentration dans un
piézomètre d’observation.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%