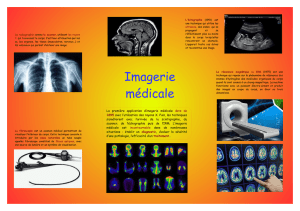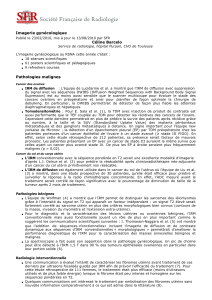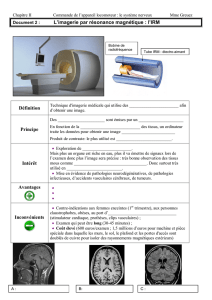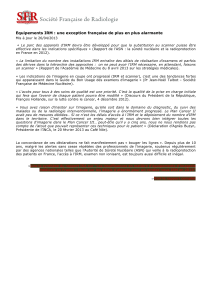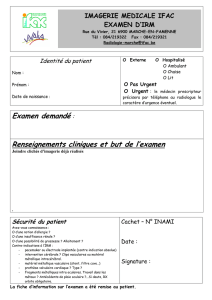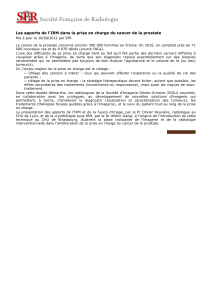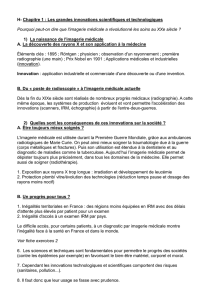Etat de l`art en Imagerie médicale

96 th Assembly and Annual Meeting
november 28 to December 3, 2010
Mc Cormick Place, Chicago Illinois
Etat de l’art en Imagerie médicale
GROUPE D’EXPERTS AFIB 2010
Coordination
POMMIER Marc
(APHP) GH Henri MONDOR
DECOUVELAERE Martine Editorial Hôpital de TOULOUSE
GOSSO Françoise Editorial GH BICHAT (APHP)
FABREGA Danielle Editorial Hospices Civils de LYON
PARRET Christophe Echographie Hôpital de CHAMBERY
SALGA Elodie Échographie AGEPS (APHP)
SERPOLAY Hubert Radiologie numérique CHU RENNES
CONY Philippe Radiologie numérique Hôpital de la REUNION
CAVASIN Yannick IRM DAPSA Orléans
BOISSART Valérie IRM CH Luxembourg
LORCY Philippe Scanner Médecine nucléaire CHU de Brest
BRESSON Béatrice Scanner Médecine nucléaire Agence Régionale de Santé
BACZINSKI Stéphane Réseaux et consoles CH LAON
LE HEN Alain Réseaux et consoles Siège (AP-HP)
RSNA 2010 pages : 1/136
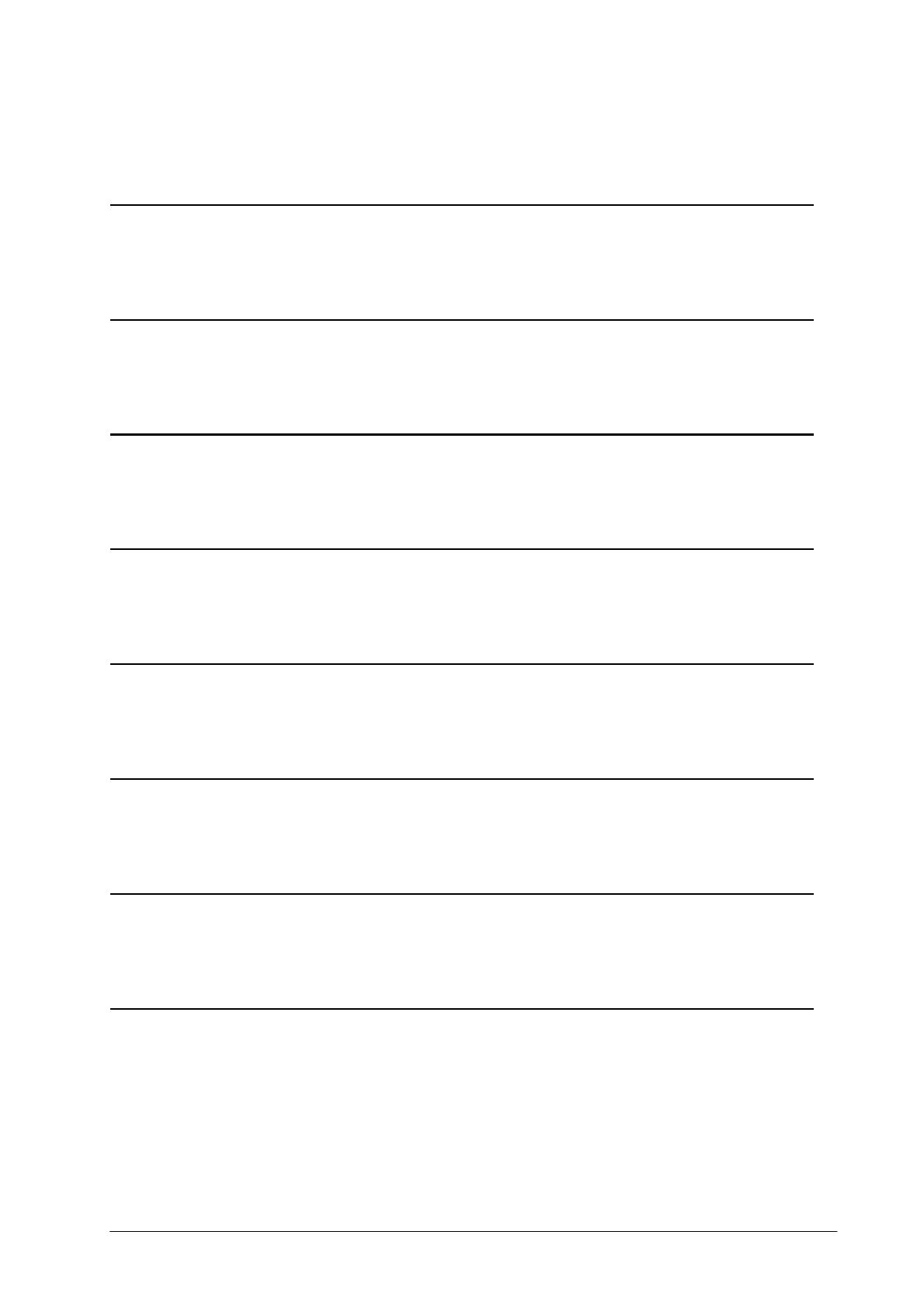
SOMMAIRE
EDITORIAL 3
UNE APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE CENTREE SUR LE PATIENT 3
DANIELLE FABREGA*, FRANÇOISE GOSSO**, MARTINE DECOUVELAERE***, 3
SCANNER 19
REDUCTION DE DOSE ET AMELIORATION DU WORKFLOW
BEATRICE BRESSON*, PHILIPPE LORCY **,
IMAGERIE MOLECULAIRE 32
IMAGERIE EN PLEIN BOOM : NOUVEAUX TRACEURS ET NOUVELLE MODALITE
BEATRICE BRESSON*, PHILIPPE LORCY **,
IRM 42
L'IRM DANS TOUS SES ETATS
VALERIE BOISSART *, YANNICK CAVASIN**
MAMMOGRAHIE 62
SANS COMPROMIS
VALERIE BOISSART *, YANNICK CAVASIN**
ECHOGRAPHIE 70
AU PLUS PRES DES BESOINS CLINIQUES
CHRISTOPHE PARRET*, ELODIE SALGA**
RADIOLOGIE NUMERIQUE 87
CONFORTATION DES ORIENTATIONS PRISES ET RECHERCHE DE L’ERGONOMIE.
PHILIPPE CONY*, HUBERT SERPOLAY**
PACS 106
LA TETE DANS LES NUAGES, LES PIEDS SUR TERRE MAIS SANS LAISSER D’EMPREINTES
(« CLOUDING AND ZERO FOOTPRINT »)
LE HEN*, STEPHANE BACZYNSKI**
RSNA 2010 pages : 2/136
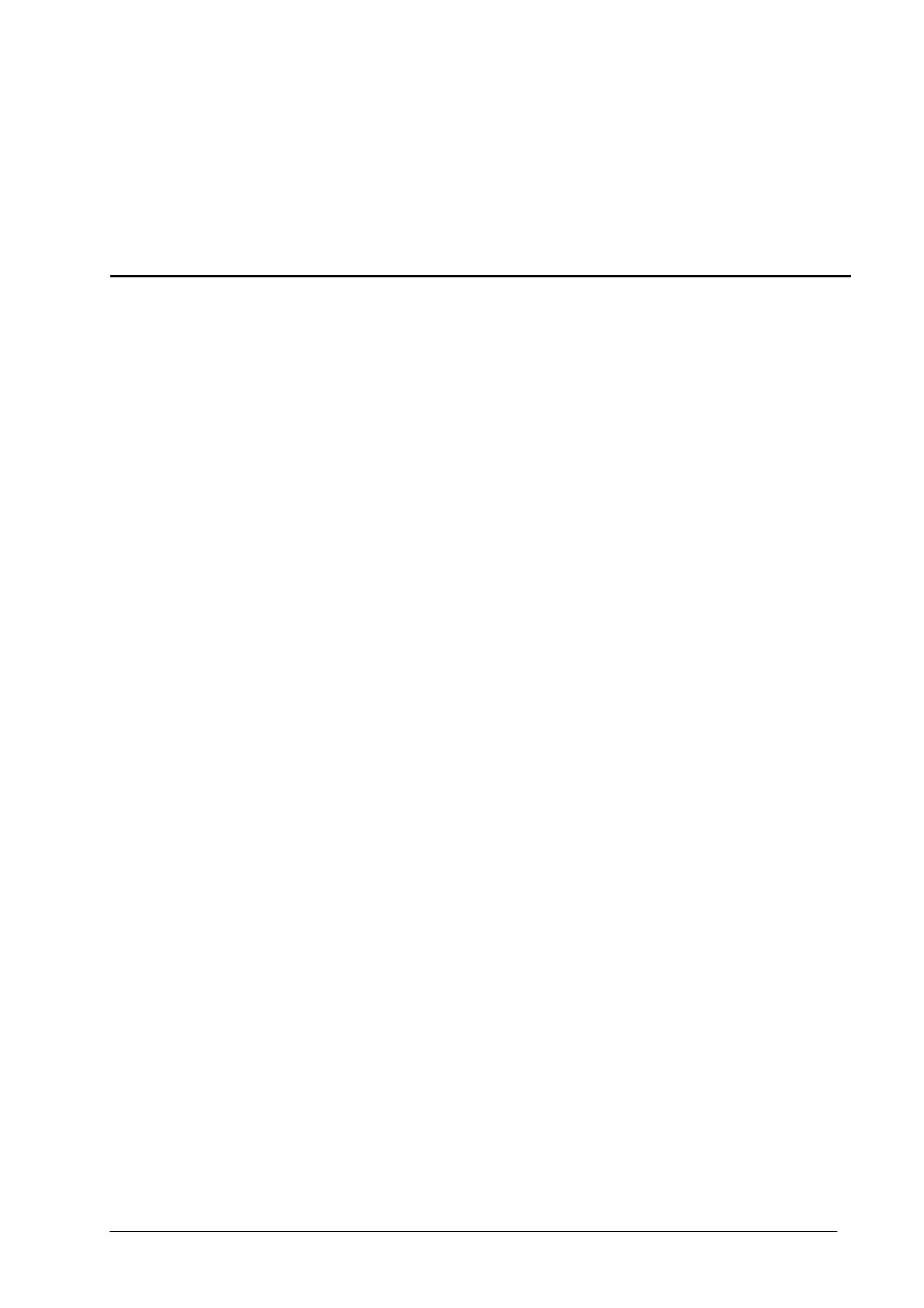
EDITORIAL
Une approche multidisciplinaire centrée sur le patient
Danielle FABREGA*, Françoise GOSSO**, Martine DECOUVELAERE***,
* Hospices Civils de Lyon, **Assistance Publique Hôpitaux de Paris, ***Présidente de l’AFIB - CHU de
Toulouse,
Introduction
Au-delà de la crise économique des pays occidentaux, la période actuelle est surtout
marquée au niveau international par le changement d’équilibre déplaçant le centre
de gravité de la croissance vers les pays dits « BRIC » (Brésil, Russie, Inde, Chine).
Les modifications d’organisation au plan international et en conséquence l’adaptation
des stratégies industrielles des années précédentes affirment à un degré raisonnable
l’optimisme d’un nouveau marché en expansion.
Le thème choisi pour la séance d’inauguration du RSNA 2010 est la personnalisation
de la médecine.
Une médecine personnalisée résumée dans le slogan « the right care to the right
patient at the right time » qui recouvre plusieurs notions : une médecine performante
en termes de moyens mis à disposition, une médecine raisonnée qui traduit une
prise de conscience de la dosimétrie, une médecine attentive aux coûts qu’elle
engendre. Sur ce dernier point, l’accent est mis sur le développement de bio-
marqueurs permettant de prédire la réponse d’un patient à un traitement
médicamenteux, évitant une perte à la fois de chance et d’argent dans le choix d’une
thérapeutique inappropriée.
Ce thème met en avant l’absolue nécessité d’un travail collaboratif entre radiologues,
médecins nucléaires, physiciens, informaticiens et ingénieurs biomédicaux au
service du patient.
Tendances générales
Au plan politique, les gouvernements ont la préoccupation d’assurer l’accès aux
soins du plus grand nombre dans les maladies chroniques et le cancer en particulier.
L’amélioration de la prise en charge des patients doit se traduire également par le
développement de collaborations entre généralistes et spécialistes sous la forme de
plateformes d’échanges de données médicales annoncées par les industriels.
Ainsi, les mots-clefs sont l’accès aux soins et leur sûreté, le maintien à domicile des
personnes et la maîtrise des coûts de santé. Pour l’imagerie, cela signifie tout autant
la maîtrise de la dose de rayonnements ionisants, le développement de projets de
plateformes régionales d’échange des données que l’augmentation constante de la
productivité des plateaux techniques d’imagerie.
RSNA 2010 pages : 3/136

Au plan médical, le cancer est devenu la principale cause de mortalité au niveau
international, et la recherche se poursuit dans le sens de la médecine dite
personnalisée, dont l’objectif est d’adapter le traitement au patient et à sa tumeur.
Annoncée depuis de nombreuses années, cette évolution se traduit désormais en
pratique, et l’imagerie morphologique, fonctionnelle et moléculaire en devient un des
piliers pour la détection, l’aide à la décision, la planification, le guidage et le suivi du
traitement.
Au plan technique la machine TEP/IRM intégrée dans le même anneau apparaît
comme la seule innovation technologique du millésime 2010. De plus, l’imagerie
médicale bénéficie des progrès constants de l’informatique et des
télécommunications, avec les capteurs « sans fil », la généralisation de l’interface
utilisateur « unique et multimodalités », la répartition « en nuage » (Cloud-based)
des traitements et des données et l’archivage « neutre » (indépendant du fournisseur
de l’image) et « universel » (indépendant de la nature du format de l’image ou de la
donnée : DICOM, JPEG, etc…) ».
Les majors de l’imagerie en coupe développent leurs gammes en de multiples
produits, pour s’adapter aux différents marchés.
Simultanément, on constate la confirmation de l’offre de salles et appareils de
radiologie dite « conventionnelle » proposée par les industriels fournisseurs de
surfaces sensibles.
Les aspects techniques à souligner sont :
- la généralisation du large tunnel et des antennes matricielles en IRM.
- la poursuite des solutions techniques de maîtrise de la dose en scanner qui
semble maintenant bien ancrée en tant que performance technique
- l’approche technologique différente des trois majors vis-à-vis de la PET/MR
- le principe d’une imagerie de la Femme multimodale
- la disparition des arceaux en U de la gamme des fournisseurs
- la généralisation de capteurs sans fil (WIFI ou équivalents) dans les salles à
capteur-plan
- l’adjonction d’un échographe portable dans la gamme des industriels qui n’en
disposaient pas en propre
- le positionnement du PACS comme noeud de plateforme d’échanges : d’une
part, pour les spécialistes, une offre logicielle étendue alternative aux
consoles des modalités ; d’autre part, pour les généralistes appelés aussi
clients « légers », une interface simplifiée à visée iconographique
- la notion d’interopérabilité des PACS et/ou des serveurs d’application de
toutes marques.
On observe une tendance chez quelques industriels de dépasser le cadre de leur
métier de fournisseur d’équipement en s’orientant vers le service et la notion de
« client/partenaire » : soit par le développement d’une activité de conseil, voire
d’« Infogérance » en réponse aux difficultés financières des établissements de soins,
soit par le développement de la télémédecine avec une division de surveillance à
domicile des malades chroniques.
RSNA 2010 pages : 4/136

Plus éloigné encore de l’imagerie, certains industriels développent des produits
grand public orientés sur le bien-être : cosmétiques, soins du corps.
Le Marché de l’imagerie
Monde
Il faut bien avouer qu’aujourd’hui la vision des industriels de leur marché est bipartite.
Ainsi, si l’on parle d’année post-crise pour le monde occidental, on parle de
croissance à deux chiffres pour les pays du BRIC. Il est d’autant plus difficile de tirer
des enseignements des chiffres annoncés qu’ils masquent aussi des disparités entre
modalités.
Les Etats-Unis semblent reprendre le chemin d’une croissance timide (quelques %)
tandis que l’Europe stagne globalement. Ainsi, devant l’ampleur des déficits publics,
l’Espagne et le Portugal passent à de nouveaux modèles de gestion de leurs
plateaux techniques externalisés. La France enregistre selon les industriels une
bonne voire une très bonne année, soutenue par le marché de l’IRM
Les pays du BRIC continuent à doper le marché : marché de volume, marché haut
de gamme également. Pour cela, les industriels y répondent à la fois par
l’implantation d’usines « champignons » pour produits standards ou spécifiques à ce
marché mais aussi par la fourniture de produits « premium » fabriqués encore dans
les unités des maisons mères. L’impact indirect sur le marché occidental est
aujourd’hui la conception de produits adaptés aux besoins de base et non la
recherche de produits à visée purement technologique.
En un mot, l’industriel cherche à s’adapter au marché et cela se traduit par une
attention particulière portée à la clientèle : la recherche de produits avec plus de
confort pour le patient, la recherche d’une image de marque plus lisible pour le client,
la recherche d’un réseau commercial avec un point d’entrée unique pour le client.
Parallèlement, il affiche l’impérieuse nécessité de continuer à investir dans la
Recherche et le Développement pour rester visible pour le client grâce à des
produits innovants.
La part du chiffre d’affaires de la division médicale chez les industriels reste stable,
les profits réapparaissent.
On n’enregistre pas de mouvement industriel particulier à l’exception du
rapprochement des sociétés HITACHI et ALOKA par complément de leur gamme
d’échographie.
Les organisations se stabilisent après un nouveau découpage de leurs activités ou
de leur clientèle.
Au bilan, l’année 2010 est vécue comme une année de reprise pour le monde
industriel.
RSNA 2010 pages : 5/136
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
1
/
136
100%