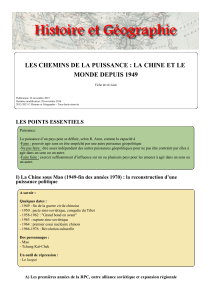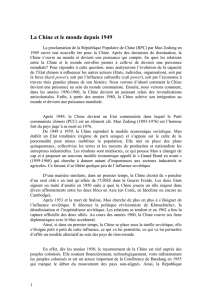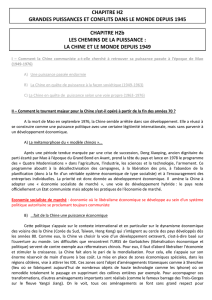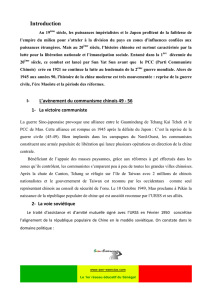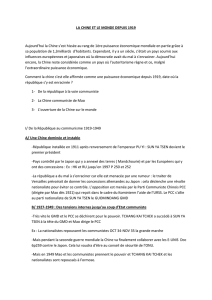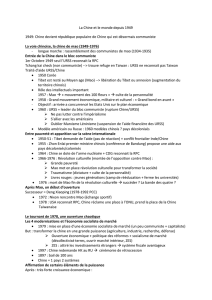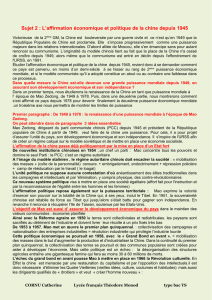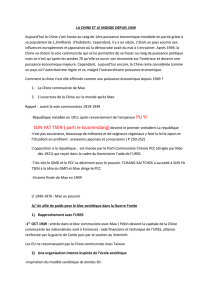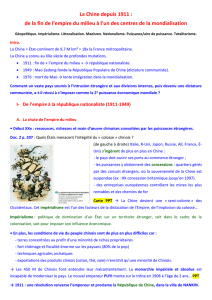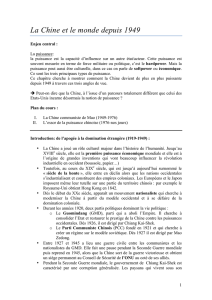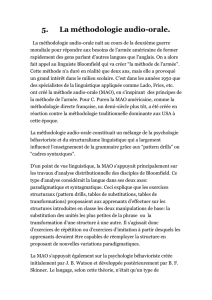Thème 1 chine - WordPress.com

1
La Chine et le monde depuis le « mouvement
du 4 mai 1919 »
Problématique : Comment se construit et évolue une puissance ? Peut-on dire que la
Chine, à l’issue d’un parcours totalement différent que celui des Etats-Unis incarne
désormais cette notion de puissance ?
Définition de puissance : capacité d’influence sur un autre état/acteur par la force (hard
power), l’influence culturelle (soft power) ou l’économie.
Plan du cours :
1. Introduction: de l’apogée à la domination étrangère (1700-1919)
2. Une Chine divisée en quête d’indépendance (1919-1949)
3. La Chine communiste de Mao (1949-1976)
4. L’essor de la puissance chinoise (1978-nos jours)
1. Introduction: de l’apogée à la domination étrangère :
La Chine a joué un rôle culturel majeur dans l’histoire de l’humanité. Jusqu’au
XVIIIe siècle, elle est la première puissance économique mondiale et elle est à
l’origine de grandes inventions qui vont beaucoup influencer la révolution
industrielle en occident (boussole, papier…)
Toutefois, au cours du XIXe siècle, qui est jusqu’à aujourd’hui surnommé le
« siècle de la honte », elle entre en déclin alors que les nations occidentales
s’industrialisent et constituent des empires coloniaux. Les Européens et le Japon
imposent même leur tutelle sur une partie du territoire chinois : par exemple le
Royaume-Uni obtient Hong Kong en 1842.
Dès le début du XXe siècle, apparaît un mouvement qui cherche à moderniser la
Chine et à se défaire de la domination coloniale. En 1911, l’Empire est renversé
et une République prend sa place. Mais celle-ci est extrêmement fragile car le
pays est fragmenté politiquement d’une part à cause de la domination étrangère,
mais également parce que des milliers de « seigneurs de la guerre » se partagent
le territoire chinois (ils ont chacun une armée privée et se regroupent en cliques
pour s’affronter les uns les autres).
Pendant la Première Guerre mondiale, la domination européenne est plus faible,
ce qui encourage l’industrialisation par une bourgeoisie nationaliste implantée
surtout dans les grandes villes du littoral (Pékin, Shanghai). Celle-ci cherche à
établir un Etat fort sur le modèle occidental et rejette le confucianisme
(l’idéologie impériale qui incitait les individus à s soumettre à la hiérarchie).
2. Une Chine divisée en quête d’indépendance (1919-1949)
Pendant la Première Guerre mondiale, le Japon profite de son alliance avec la
France et le Royaume-Uni pour annexer la province du Shandong jusque là
allemande. Pour faire valoir ses droits et s’assurer des appuis contre son
dangereux voisin, le gouvernement chinois s’allie à son tour avec ces trois pays
en 1917. Toutefois, los du Traité de Versailles, le Shandong est confié au Japon.

2
Cette décision provoque la colère de la jeunesse chinoise et le « mouvement du
4 mai 1919 ». Dans toutes les villes ont lieu des manifestations nationalistes
contre le confucianisme, pour une occidentalisation rapide du pays et contre les
traités diplomatiques qui défavorisent la Chine depuis un siècle (ils sont appelés
les « traités inégaux »). Devant l’ampleur des protestations, le gouvernement
chinois refuse de signer le traité de Versailles et finit par récupérer le Shandong
grâce au soutien des Etats-Unis inquiets des ambitions japonaises en Asie.
Durant les années 1920, deux partis politiques dominent la vie politique :
o Le Guomindang (GMD), parti qui a aboli l’Empire. Il cherche à
consolider l’Etat et restaurer le prestige de la Chine. Dès 1926, il est
dirigé par Chiang Kai-Shek.
o Le Parti Communiste Chinois (PCC) fondé en 1921 et qui cherche à
créer un régime sur le modèle soviétique. Dès 1927 il est dirigé par Mao
Zedong.
En 1927, Chiang Kai-Shek lance une campagne contre les seigneurs de guerre,
pour récupérer le contrôle du territoire, puis il se dirige contre les communistes.
Le 12 avril 1927 il en fait éliminer 5000 à Shanghai. C’est le début d’une guerre
civile entre nationalistes et communistes. Ces derniers fuient vers l’intérieur du
pays et le Nord et parcourent 12000km à pied, c’est la « Longue Marche »
(1934-1935) au cours de laquelle Mao se confirme comme leader du PCC.
Le Japon profite de la guerre civile pour occuper la Mandchourie en 1931 puis à
partir de 1937, il se lance dans la conquête systématique du littoral chinois. Cette
expansion s’accompagne de terribles massacres. En 1941, le gouvernement
japonais lance la politique des « trois Tout » : « Tue tout, Brûle Tout, Pille
Tout ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chiang Kai-Shek est donc
contraint de cesser le combat avec Mao et de s’allier avec lui contre le Japon. En
1945, la Chine sort de la guerre victorieuse et obtient un siège permanent au
Conseil de Sécurité de l’ONU au coté de ses alliés.
Mais dès 1945, la guerre civile reprend entre le GMD et le PCC. Mais entre
temps, le culte de Mao a commencé à se diffuser dans toute la Chine. En effet,
pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de Chiang Kai-Shek est
caractérisé par une corruption généralisée. Les paysans qui vivent sous son
contrôle sont frappés de lourdes taxes et de corvées, puis par une famine (2 à 3
millions de morts). Au Nord du pays, par contre, Mao a procédé à des réformes
agraires (confiscation des terres des grands propriétaires pour les offrir aux
paysans) et une diminution des impôts.
Grace au soutien des paysans et à la popularité de Mao, le PCC parvient à
vaincre le GMD qui s’exile sur l’île de Taiwan en 1949. Mao proclame le 1er
octobre 1949 la naissance de la République Populaire de Chine (RPC).
Chiang Kai-Shek reste le chef d’une autre république de Chine qui est armée et
protégée par les Etats-Unis et qui occupe le siège de la Chine à l’ONU.
3. La Chine communiste de Mao : un Etat totalitariste en quête de puissance
(1949-1976)
a. La Chine sous l’influence soviétique
Mao reprend le contrôle de tout le territoire chinois et occupe le Tibet en 1951.
C’est le début de la Guerre Froide. La Chine, comme le reste du monde est
divisée entre les deux blocs. D’un coté, le Guomindang à Taiwan est reconnu et

3
protégé par les gouvernements occidentaux, tandis que Hong Kong reste
anglaise. D’un autre, la Chine Populaire de Mao choisit de « pencher d’un seul
côté », une expression pour dire qu’elle s’engage du côté de l’URSS contre le
bloc capitaliste. Elle signe ainsi un traité d’amitié avec l’URSS début 1950.
L’Union Soviétique ouvre des bases militaires en Chine.
Mao met en place un régime totalitaire : le seul parti politique autorisé est le
PCC, un culte de la personnalité entoure la figure de Mao, des camps de travail
sont organisés pour « rééduquer » les dissidents politiques (ce sont les laogaï,
l’équivalent des goulags soviétiques), la censure est généralisée…
Le système économique adopté par Mao dès 1953 est calqué sur le modèle
soviétique : mise en place de plans quinquennaux (document de planification
économique fixant des objectifs de production sur une période de cinq ans), les
terres des grands propriétaires sont collectivisées, les entreprises industrielles
sont nationalisées (elles ne sont plus privées mais appartiennent à l’Etat).
La Chine est l’allié principal de l’URSS en Asie. Elle joue ainsi un rôle majeur
dans divers conflits de la Guerre Froide. Elle s’engage dans la Guerre de
Corée (1950-53) au côté de l’armée nord-coréenne (sous influence soviétique)
en déroute devant une intervention de l’ONU. Entre 1946 et 1954 elle soutient
les Vietminh (communistes vietnamiens) dirigés par Hô Chi Minh contre la
France et les Etats-Unis (Guerre d’Indochine). Elle aide aussi les « khmers
Rouges », un mouvement politique communiste, à s’emparer du pouvoir au
Cambodge en 1975.
b. L’affirmation politique Maoïste (1955-1978)
A la mort de Staline, en 1956, Nikita Khrouchtchev prend la tête du
gouvernement soviétique, commence une campagne de « déstalinisation » qui
dénonce le culte de la personnalité et les excès du régime stalinien (déportations
massives, arrestations arbitraires…) et renoue des liens diplomatiques avec les
Etats-Unis. Mao rejette ces initiatives et accuse les soviétiques d’être des
impérialistes. Les relations avec l’URSS se dégradent de plus en plus : en 1960
Moscou rappelle ses conseillers et en 1962, elle met fin à son aide économique
(rupture officielle entre les deux pays).
En 1955 a lieu la Conférence de Bandung qui réunit 29 pays d’Asie et
d’Afrique qui choisissent de former le mouvement des pays non-alignés (qui
choisissent de s’allier ni avec l’URSS ni avec les Etats-Unis). En froid avec
l’URSS, la Chine prend une part active dans cette conférence et cherche à se
poser en chef de file du Tiers-Monde en tant que modèle anti-impérialiste et
anti-occidental (elle soutien les luttes de décolonisation).
Dans les années 1960, le hard power de la Chine est de plus en plus confirmé.
Non seulement les non-alignés, mais également certains pays occidentaux
comme la France reconnaissent la RPC sur le plan diplomatique. Elle obtient
l’arme nucléaire en 1964. En 1971, la RPC remplace Taiwan au Conseil de
Sécurité de l’ONU et en 1972, elle commence à se rapprocher des Etats-Unis.
c. Un nain sur les plans sociaux et économiques
Si la Chine a retrouvé une place de choix dans le concert des nations entre 1949
et 1979 sur le plan politique, sur les plans économiques et sociaux, ces trente
années sont désastreuses. En 1957, pour améliorer l’image du parti, Mao décide

4
de donner plus de liberté d’expression et lance le mouvement des Cent Fleurs,
encourageant les « bons communistes » à dénoncer les responsables des
injustices et des difficultés. Les critiques sur le parti sont tellement nombreuses
que Mao est contraint d’étouffer le mouvement et plus d’un million de chinois
sont finalement sanctionnés (déportations dans les campagnes).
En mai 1958, cherchant à proposer un modèle de communisme indépendant et
alternatif, Mao lance le « Grand Bond en Avant » pour moderniser l’économie
chinoise. Les communes populaires sont généralisées (regroupement de
villages en unités de production agricole et industrielle où la vie de famille et
privée est proscrite). Les paysans sont mobilisés pour réaliser des grands travaux
et produire de l’acier. Cette initiative tourne à la catastrophe car les paysans
n’ont plus le temps de s’occuper des récoltes. Entre 1959 et 1961, entre 18 et 23
millions de chinois meurent de faim.
Face à cet échec, Mao doit se retirer, tandis que les lopins de terre individuels et
la vie de famille sont à nouveau autorisés. Pour reconquérir le pouvoir, Mao
lance la Grande Révolution Culturelle : il mobilise la jeunesse contre les
nouveaux dirigeants taxés d’anti-communistes. Les jeunes ouvriers et les
étudiants forment des « gardes rouges » qui sillonnent le pays, dénonçant les
révisionnistes (les cadres qui remettent en question le système de Mao). Cet
épisode fait des centaines de milliers de morts, tandis que 16 millions de chinois
sont envoyés en rééducation.
4. L’essor de la puissance chinoise (1978-nos jours)
a. Les réformes des années 1980
A la mort de Mao en 1976, la Chine est influente en Asie, mais elle n’est pas une
puissance mondiale. Le pays est rural et sous-industrialisé, un tiers de la
population vit dans la pauvreté. En 1978, Deng Xiaoping remplace Mao. Pour
sortir de cette précarité économique, il opte pour l’économie de marché, tout en
maintenant un communisme de façade.
Il lance les « quatre modernisations » (1978-1979):
o Agriculture : usage libre et individuel de la terre pour les paysans.
o Industrie : autorisation de petites entreprises privées, création de 4 Zones
Economiques Spéciales (ZES) où les investissements financiers
étrangers sont autorisés et permettent des transferts de technologie (puis
de plus en plus de régions sont transformées en ZES : en 1988 toutes les
villes du littoral puis en 1990 les villes des régions transfrontalières)
o Commerce : réouverture des frontières. L’industrie est orientée vers les
exportations de produits manufacturés.
o Société : c’est en 1979 qu’est lancée la politique de l’enfant unique dans
le but de stabiliser la croissance démographique et d’améliorer le niveau
de vie des Chinois.
b. L’affirmation d’une grande puissance économique
Durant les années 1990, la Chine est l’ « atelier du monde ». de nombreuses
entreprises occidentales se délocalisent en Chine pour produire avec une main-
d’œuvre bon marché.
Le parti valide le principe d’« économie socialiste de marché » en 1992.

5
En 1993, la Chine connait un record : 13% de croissance ! Une classe moyenne
de plusieurs millions de personnes voit le jour.
L’entrée à l’OMC en 2001 parachève la libéralisation de l’économie chinoise.
Elle est désormais la seconde puissance économique mondiale et ambitionne de
détrôner les Etats-Unis. Elle fait de plus en plus d’Investissements Directs à
l’Etranger (IDE) notamment en Afrique. Les IDE chinois dans le monde ont
triplé entre 2003 et 2011.
c. La recherche de la puissance totale (hard et soft)
Si la puissance économique de la Chine est indéniable (2e PIB mondial), le pays
cherche encore à affirmer sa puissance diplomatique, militaire, politique et
culturelle. En 1984 est signé un accord pour la rétrocession de Hong-Kong,
rétrocession qui a lieu en 1997. La démocratie est laissée en place à Hong-
Kong : on dit de la Chine actuelle « un pays, deux systèmes ». Toutefois, la
Chine revendique encore l’île de Taiwan.
En opposition à l’OTAN, la Chine et la Russie créent l’Organisation de
Coopération de Shanghai en 2001. Elle fait en outre partie du G20.
En outre, la Chine cherche à développer son soft power (organisation des Jeux
Olympiques en 2008, Instituts Confucius…)
d. Une puissance contestée
Le soft power devient une priorité pour Pékin car son image est ternie par de
nombreux éléments. Dans les années 80, chez son voisin soviétique, la dictature
s’affaiblit avec la Glasnost et la Perestroika (deux mouvements de réformes
lancées par Gorbatchev dès 1985). Ce vent de liberté trouve un écho en Chine où
les étudiants protestent en 1989. Le pouvoir enverra l’armée pour réprimer le
mouvement, avec notamment le massacre de la place Tian’anmen, le 4 juin
1989 qui fera 2000 victimes.
De nombreuses violations des droits de l’homme par le régime chinois sont
régulièrement dénoncées. Si les événements de 1989 ont entrainé une réaction
internationale, avec un embargo sur la vente d’arme à la Chine et une baisse
des investissements, ces mesures punitives sont de plus en plus rares. Par
ailleurs, internet est censuré, ce qui révèle une absence de liberté d’expression.
La croissance économique chinoise a un fort impact en terme de dégradation de
l’environnement : elle est le premier émetteur de gaz à effet de serre, la
pollution et la gestion de l’eau et des déchets sont calamiteux.
Le pays est également traversé par des tensions intérieures avec des minorités
qui veulent l’indépendance comme les tibétains et les Ouïgoure (une minorité
musulmane).
Enfin, malgré ses succès économiques, la Chine demeure un des pays les plus
inégalitaires du monde.
5. Conclusion :
Si elle est clairement une grande puissance, la Chine n’est pas encore
l’« hyperpuissance » capable de rivaliser avec les Etats-Unis : si ses succès
économiques sont réels, son modèle culturel, idéologique et politique est peu attractif,
sa puissance militaire ne peut rivaliser avec celle des Etats-Unis…
1
/
5
100%