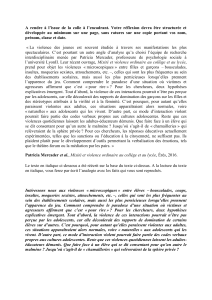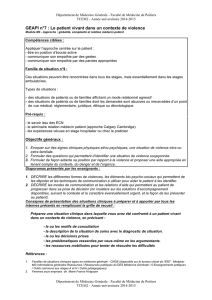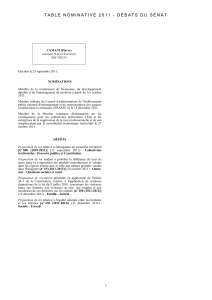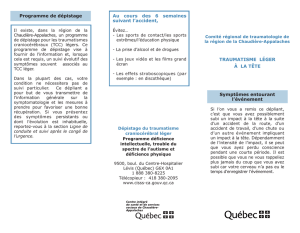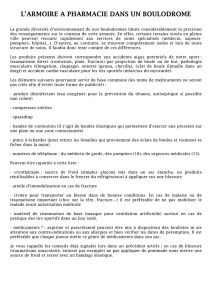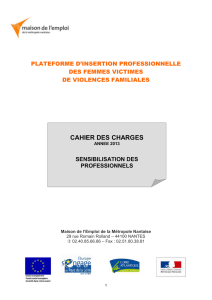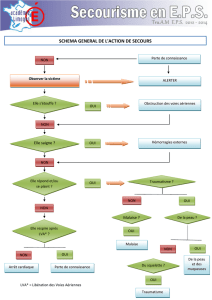Des violences extrêmes aux violences

S
ciences-
C
roisées
Numéro 9 : Contributions libres
Des violences extrêmes aux violences quotidiennes :
Approches critiques de la notion de traumatisme
Alexis
Cukier
Allocataire moniteur, Département de Philosophie
(Sophiapol - Université de Paris-Nanterre)
alexis.cukier@gmail.com
Cécile Lavergne
Allocataire monitrice, Département de Philosophie
(Sophiapol - Université de Paris-Nanterre)
Valentina Ragno
Doctorante, Département de Philosophie
(Sophiapol - Université de Paris-Nanterre)
Des violences extrêmes aux violences quotidiennes :
approches critiques de la notion de traumatisme
Résumé
Après un examen des usages courants et des théories (psychologiques, sociologiques,
philosophiques) contemporaines de la notion de traumatisme, nous proposons une
approche critique de la conception dominante des « violences traumatiques » comme
événements « traumatogènes » produisant des « drames sociaux ». A partir d’une
analyse des conceptions contemporaines de phénomènes de « violences extrêmes »
(pratiques de guerre, torture, agressions) et de « violences quotidiennes » (harcèlement,
management par le stress, dominations), nous proposons de critiquer à la fois
l’individualisation des traumatismes et l’utilisation de cette catégorie à des fins de
gouvernement des populations et de management des subjectivités. Dans cette
perspective, nous proposons l’esquisse d’une nouvelle thématisation de cette catégorie
de traumatisme, inspirée de la philosophie sociale, et attentive aux nouvelles formes de
« violences ordinaires » et de « souffrances sociales », et à leurs effets de subjectivation
et de désaffiliation spécifiques.
Mots-clés : traumatisme – violences – subjectivités – culture thérapeutique –
souffrance sociale
- 1 -

Introduction
Nous employons les termes de violence et de traumatisme, dans l’usage
courant, théorique ou clinique, pour comprendre des situations et des
souffrances apparemment très diverses. Mais qu’y a-t-il de commun, par
exemple, entre les violences « extrêmes » – qu’elles soient « politiques »
(guerre, emprisonnement, torture) ou « privées » (agressions, viols, etc.) – et les
violences « quotidiennes » – qu’elles soient professionnelles (harcèlement
moral au travail, management par le stress), psychologiques (harcèlement,
dominations) ou sociales (licenciements, menaces) ? Et entre les traumatismes
dus, par exemple, à une catastrophe naturelle, à un attentat, à un événement
social brutal ou à une agression intentionnelle ? Même s’ils peuvent se recouper
ou se cumuler, les types de causes et de souffrances psychiques qui y sont en jeu
semblent difficilement identifiables. Mais surtout, la multiplicité des usages des
notions de violence et de traumatisme, ainsi que leur relative imprécision,
semblent atténuer leur pouvoir thérapeutique (diagnostic et prise en charge),
politique (dénonciation et lutte) et social (compréhension et aide adéquate).
C’est pour répondre à ce constat que nous proposons une approche critique
« des violences traumatiques » et de la compréhension de la violence à partir de
la catégorie de traumatisme.
A cette fin, nous n’adopterons pas la perspective de leurs causes – les
facteurs dits « traumatogènes » – mais celle de leurs effets, autrement dit, le
point de vue de ce qu’elles produisent (représentations, émotions et souffrances)
sur les individus, sur leurs psychismes ou sur leurs corps. Nous serons ainsi
amenés à nous demander quel pouvoir certaines violences, comprises comme
traumatiques, ont dans la constitution des subjectivités.
Nous partirons, plus précisément, du constat d’une rencontre entre la
compréhension savante du traumatisme (comme conséquence psychique d’un
choc) et sa compréhension usuelle (comme drame psychique et social d’un
peuple) et de l’hypothèse que cette rencontre a des conséquences cliniques,
théoriques et politiques, décisives. On peut citer à cet égard un extrait L’Empire
du traumatisme de Didier Fassin et Richard Rechtman (2007), qui pourrait
résumer notre point de départ : « Ce terme [traumatisme] doit […] s’entendre à
la fois au sens restreint que la santé mentale lui confère (la trace laissée dans le
psychisme) et en suivant l’usage toujours plus répandu dans le sens commun
(une brèche ouverte dans la mémoire collective) […]. De l’acception littérale
des psychiatres (le choc psychologique) à l’extension métaphorique dans les
médias (le drame social) – et souvent, d’ailleurs, on passe au sein d’un même
discours de l’une à l’autre sans précaution particulière –, la notion de
traumatisme s’impose donc comme un lieu commun du monde contemporain,
autrement dit comme une vérité partagée ». C’est donc de cet emploi généralisé
de la notion de traumatisme, qui inquiète les frontières entre discours cliniques
et quotidiens, que nous proposons d’effectuer une critique – non pas au sens
d’une attaque, mais plutôt d’une clarification et d’une précision des contextes
sociaux de ses usages, de sa portée thérapeutique et politique et des limites de
ses applications légitimes. Nous espérons que cette critique pourra contribuer à
rendre intelligible les effets de certaines violences, ainsi que leur
compréhension comme traumatiques, sur la construction contemporaine des
subjectivités.
- 2 -

1. Les usages politiques et nosographiques de la catégorie de traumatisme :
ce que nous dit le traumatisme de la vérité contemporaine des violences
L’enjeu de ce premier temps de l’analyse sera de dégager trois usages
distincts de la catégorie de traumatisme, usages neuro-cogntif,
psychothérapeutique et culturel, pour montrer ce qu’ils peuvent nous apprendre
des régimes de véridiction des violences contemporaines, autrement dit de la
manière dont les effets traumatiques des violences sur les subjectivités sont pris
dans des dispositifs discursifs ayant valeur de vérité. Nous verrons que c’est un
langage commun de l’événement qui subsume ces trois usages.
On peut définir la violence de manière minimale comme excès ou abus
dans le déchaînement de la force, c'est-à-dire comme effet d’une contrainte
physique ou psychique qui se traduit par de la souffrance, des blessures,
pouvant conduire à la mort. Il faut ajouter que la violence n’est le plus souvent
qualifiée comme telle que lorsque s’atteste la conjonction entre l’intensité de la
force et son caractère illégitime. C’est d’ailleurs sur cette illégitimité que
s’appuie la revendication de la condition de victime, qui sera d’autant plus
difficile à faire valoir que les violences subies seront qualifiées de légitimes1.
Mais la reconnaissance du statut de victime est-elle absolument nécessaire à
l’individu traumatisé pour amorcer une « sortie de crise » ? C’est ce que laisse
entendre une série de travaux en victimologie, portant notamment sur les
violences conjugales, où la sanction de la loi et la reconnaissance des violences
vécues sont présentées comme un préalable nécessaire à la reconstruction de
l’identité (Faget, 2004). Nous ne pourrons pas aborder ici la discussion de ces
travaux, mais souhaitions pointer le lien entre vécus de violence et vulnérabilité
des identités individuelles – qui fera l’objet d’une approche critique dans la
deuxième partie de cette contribution. Ce lien entre identité et violence est
ressaisi par Françoise Héritier (1996), lorsque dans ses définitions liminaires de
la violence, elle insiste sur le noyau conceptuel de l’effraction : « tantôt du
corps comme territoire clos, tantôt du territoire physique ou moral conçu
comme un corps dépeçable ». C’est justement cette effraction de la violence,
lorsqu’elle implique une expérience de grande tension émotionnelle pour
l’individu, qui est pensée comme proprement « traumatique ».
Catherine Malabou dans Les Nouveaux Blessés (2007), oppose à la
définition psychanalytique et freudienne du trauma2, celle neurocognitive de
traumatisme (sur la base de la « méthode des lésions »3 employée par exemple
par Antonio R. Damasio, 19954). En fait, la catégorie de traumatisme psychique
réfère pour elle à des types de conduites que l’on retrouve à la fois chez les
cérébro-lésés (individus souffrant de maladies dégénératives comme
Alzheimer), mais aussi chez les victimes de ce qu’elle appelle des
1 On sait par exemple la difficulté qu’il y a faire reconnaître la condition de victime
pour certains groupes d’individus, à l’image des prisonniers : comme le montre les
travaux de la sociologue Corinne Rostaing (2008) sur l’institution carcérale en France,
les violences qu’elle appelle « institutionnelles » (qui ne rentrent pas au sens strict dans
la catégorie juridique de coups et blessures) de même que les violences des personnels à
l’encontre des prisonniers, sont très difficiles à mettre au jour, et donc aussi à pénaliser,
ce qui rend difficile pour un prisonnier de se faire reconnaître comme victime.
2 Le trauma tel que le définit Freud n’est pas seulement la réaction de l’organisme à un
événement externe, il est la caractéristique essentielle du fonctionnement psychique :
« le terme traumatique n’a pas d’autre sens qu’un sens économique. Nous appelons
ainsi un événement vécu qui, en l’espace de peu de temps, apporte dans la vie
psychique un tel surcroit d’excitation que sa suppression ou son assimilation par les
voies normales devient une tâche impossible, ce qui a pour effet des troubles durables
dans l’utilisation de l’énergie » (Freud, 1916, p. 256-257).
3 Elle consiste à penser les pathologies du sujet à partir des cas de lésion des réseaux
cérébraux correspondants aux capacités affectées.
4 Professeur en neurologie.
- 3 -

« traumatismes sociopolitiques » : guerre, terrorisme, torture, captivité, abus
sexuels, etc. Ces traumatismes renvoient à l’ensemble des dommages causés par
ce que l’auteure appelle « l’extrême violence relationnelle ». Sans qu’il y ait de
lésion cérébrale effective (ou tout au moins sans qu’il soit besoin de les attester
cliniquement), on peut repérer chez des individus qui ont été victimes
d’extrêmes violences des comportements identiques aux cérébro-lésés.
Catherine Malabou en conclut : « je m’autoriserai donc à considérer aussi
comme des « nouveaux blessés » tous ceux qui sont en état de choc et qui, sans
avoir subi au départ de lésions cérébrales, n’en voient pas moins leur
organisation neuronale et leur équilibre psychique altérés par le trauma. Eux
aussi souffrent en particulier d’un déficit émotionnel » (2007, 36-37). Sur la
base de cette analogie entre cérébro lésés et victime de violences
sociopolitiques, le traumatisme se définit ainsi comme l’indice d’un dommage
cérébral. Tout traumatisme aurait donc des conséquences sur l’organisation
neuronale, en particulier sur les sites inducteurs d’émotion. Dans le cas des
neuropathologies, les changements neuronaux sont la cause de la
désorganisation psychique alors qu’ils n’en sont que la conséquence dans le cas
des traumatismes sociopolitiques. « Dans toutes ces situations, écrit Malabou,
un même impact de l’événement est à l’œuvre, une même économie de
l’accident, un même rapport du psychisme avec la catastrophe » (ibid, p. 38-39).
Dès lors, la blessure devient la cause déterminante d’une transformation
psychique. Il y a donc bien au sens fort effraction de la violence dans l’identité
psychique de l’individu ; elle aurait un pouvoir plastique sur cette identité,
pouvoir de destruction et d’anéantissement, ce que Malabou appelle « la
création d’une identité post lésionnelle ». L’auteure la pense comme une forme
d’altérité à soi radicale qu’elle relie à des symptômes de dérèglements
émotionnels pouvant durablement grever l’existence quotidienne : « Je ne suis
plus le même qu’avant la torture » dit celui qu’on a torturé (Sironi, 1999, p. 11).
Si on se reporte à DSM-III5, c’est-à-dire la troisième révision de la
classification américaine des troubles mentaux faisant autorité dans le champ
psychiatrique, il est patent que le traumatisme n’est pas identifié à travers des
formes d’évènements mais par l’identification d’une série de symptômes : les
psychiatres qui ont établi la nosographie du PTSD (Post Traumatic Stress
Disorder) se sont appuyés sur des critères précis. Les symptômes sont de trois
ordres : 1/ souvenirs envahissants (rêves, cauchemars, flash back douloureux) ;
2/ un évitement des situations risquant d’évoquer la scène initiale, accompagnée
d’un émoussement affectif qui peut avoir d’importants effets sur la
socialisation. 3/ hypervigilance avec des réactions exagérées de sursaut. En
outre, ce tableau doit durer depuis plus de six mois pour rentrer dans la
catégorie nosographique. Ainsi l’usage psychiatrique de la catégorie de
traumatisme (qui correspond à celle, psychiatrique de PTSD) ne conduit pas à
une approche spécifique des violences dans leurs effets sur les subjectivités :
elles peuvent correspondre à des évènements traumatiques au même titre que
des catastrophes naturelles, aériennes, mais rien ne nous permet de statuer sur
l’idée que l’intentionnalité des violences (politiques, génocidaires, mafieuses
etc.) pourrait avoir des effets traumatiques spécifiques sur les modes de
subjectivation des victimes.
Pour autant, si toute violence produit des effets (si ténus et si invisibles
soient-ils), ils ne sont pas nécessairement à comprendre comme traumatiques.
La prise en compte de formes quotidiennes de violences peut même apparaître
comme antinomiques avec la définition neuro-cognitive du traumatisme comme
choc ou catastrophe. L’analyse qu’en propose les anthropologues Veena Das et
Arthur Kleinman tendrait à le montrer : dans leur introduction à Violence and
Subjectivity, les violences (guerre, tortures, mutilations, mais aussi violences
5 Le PTSD a été introduit dans la troisième révision de la classification américaine des
troubles mentaux (en 1980). Sa prise en compte est le résultat de longues années de
luttes au sein de l’association psychiatrique.
- 4 -

symboliques, verbales) sont présentées comme dotées d’un pouvoir constituant
sur les subjectivités – ce qui conduit ces chercheurs à refuser de penser leurs
effets comme nécessairement exceptionnels ou spectaculaires – effets qui ne
sont pas d’emblée pensés sur le mode de la lésion, ou du dommage. Au
contraire, saisir les effets constituants des violences, c’est rendre intelligibles les
traces qu’elles laissent dans « l’ordinaire » des vies. La question philosophique
formelle « quelles sont les violences qui sont traumatiques ? » apparaît donc
comme partiellement insoluble : c’est d’abord et avant tout une approche
clinique et/ou anthropologique qui peut en décider. Dans le continuum des
violences qui va des violences quotidiennes aux violences extrêmes, il semble
impossible de tracer une taxinomie a priori associant des formes de violences à
des symptômes traumatiques spécifiques.
L’hypothèse en jeu est que le sens traumatique des violences est
toujours situé et contextuel ; il se ressaisit dans la conjonction entre l’histoire
sociale et politique de l’individu et la catastrophe. C’est ce que nous
désignerons comme le deuxième usage de la catégorie de traumatisme, l’usage
psychothérapeutique, en nous appuyant sur les travaux de Françoise Sironi
(1999, 2007). À l’opposé des thérapies du « déchoquage » (Lebigot, 2005)
s’appuyant sur une psychologie comportementaliste, la démarche de Sironi se
situe dans la tradition de l’ethnopsychiatrie, en particulier des travaux de
Georges Devereux et de Tobie Nathan. Elle pense le traumatisme sur le modèle
de l’effraction psychique (qui dans les travaux de Sironi n’a pas la signification
d’une lésion cérébrale) : « La redondance, c’est-à-dire la correspondance exacte,
terme à terme, entre marquage physique et empreinte psychique fabrique
l’effraction psychique. Quand les tortionnaires énoncent des injonctions comme
« tu ne seras plus jamais un homme » pendant qu’ils appliquent un courant
électrique sur le pénis d’un homme, ils induisent une modification brutale et
parfois irréversible de la représentation de l’ordre des choses chez la personne
que l’on torture. Ce qui peut être une contrainte fantasmatique devient une
réalité. Par la redondance, la pensée et le fantasme sont court-circuités. Seule
l’intentionnalité de celui qui torture est agissante, faisant tragiquement voler en
éclats tout sentiment d’avoir une identité propre » (Sironi, 2007, p. 46).
Ainsi, dans la clinique de la torture, il faut être très attentif à la parole
des tortionnaires, car elle reste active à travers des symptômes traumatiques. Sur
la base de ses travaux sur la torture et de sa pratique clinique de psychothérapie
avec des victimes et des bourreaux de guerre, Sironi a théorisé une approche des
violences collectives comme traumatismes intentionnels (c’est-à-dire
délibérément induits par l’homme) qui nécessite d’introduire une dimension
géopolitique à la psychologie clinique. D’un point de vue thérapeutique, cela se
traduit par la multiplication des matrices de sens, car chaque situation clinique
est considérée à partir du point de vue de la construction des personnes, à partir
des expériences successives qu’elles traversent. C’est le rôle du contexte, de
l’événement extérieur, qui est pleinement pris en compte. Avec les victimes de
traumatismes intentionnels, le thérapeute va s’attacher à mettre en évidence un
vécu authentique de « présence intérieure d’éléments parasites », car ce vécu est
directement lié à la manière dont le patient a été pensé par le tortionnaire ou
l’agent traumatisant. En outre, la thérapie sera menée d’avantage sur un mode
intellectuel qu’émotionnel : « ceci est dû au fait que l’attaque du système
tortionnaire a lieu au point d’articulation entre l’histoire singulière et l’histoire
collective. La tentative de déshumanisation ou de déculturation qu’ont subie les
victimes de traumatismes intentionnels provoque un blocage ou une
obnubilation de la pensée, attestées physiquement lors des séances de
psychothérapie » (ibid). Donc récupérer cette faculté de penser passe par
l’expulsion de l’agresseur intériorisé6. Cette approche thérapeutique repose donc
6 Les éléments suivants sont mobilisés au cours de la psychothérapie, en les adaptant
bien entendu au contexte de l’histoire singulière du patient : 1/ attribution d’un sens aux
symptômes qui vise l’attribution la lutte contre la présence agissante de l’agresseur
- 5 -
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%