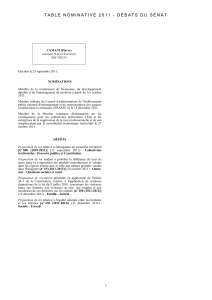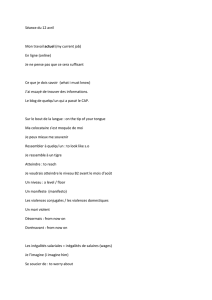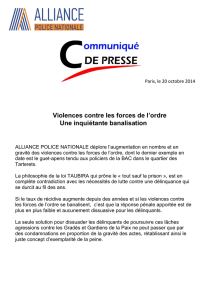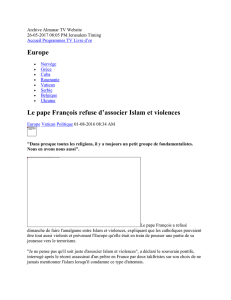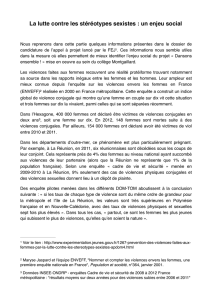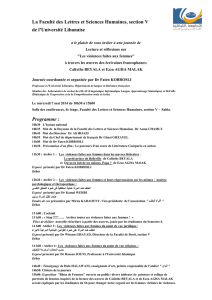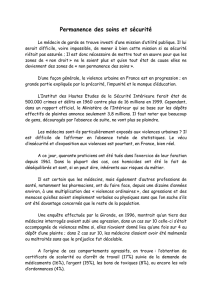Lire l'article complet

3
La Lettre du Gynécologue - n° 263 - juin 2001
igne des temps ou effet de mode, on parle de plus en
plus de violences envers les femmes, au point que la
secrétaire d’État aux Droits des femmes a organisé
une journée nationale sur le sujet, le 25 janvier, et que la secré-
taire d’État à la Santé a créé, en octobre 2000, un groupe de tra-
vail dont le ministre m’a confié la présidence.
J’ai découvert, à cette occasion, l’ampleur d’un problème que je
ne soupçonnais pas. Il faut se rendre à l’évidence, certaines de
nos consultantes sont insultées, menacées, frappées par leur
conjoint avant, pendant et après la grossesse, indiscutable fac-
teur déclenchant ou aggravant pour les auteurs anglo-saxons. En
effet, le phénomène est depuis longtemps connu aux États-Unis,
où il a fait l’objet de nombreuses publications inquiétantes.
Dans huit études entre 1990 et 1998, la proportion de victimes
de violences parmi les femmes enceintes varie de 3,9 % à 8,3 %.
Pour certains, les conséquences des violences seraient même
une pathologie plus fréquente que l’éclampsie, le diabète gesta-
tionnel ou le placenta prævia.
Ne souriez pas ! Le phénomène ne se limite pas, ou plus, aux
Amériques. D’une part, notre confrère psychiatre Benghozi en
témoigne dans un article de La Lettre du gynécologue de janvier
2001, d’autre part, l’une des rares études françaises sur le sujet,
portant sur 706 femmes ayant accouché dans trois maternités de
l’Hexagone, le confirme. Elle montre que 4,1 % d’entre elles ont
bel et bien subi des violences dans l’année suivant l’accouche-
ment. L’agresseur n’est pas forcément un paranoïaque ou un
alcoolique invétéré, mais peut être monsieur tout le monde, avec
une propension, toutefois, à un certain autoritarisme.
Mais, me direz-vous, que viennent faire les gynécologues-obsté-
triciens dans cette galère ? D’abord, les conséquences peuvent
être graves. Au plan de la grossesse, les violences sont facteurs
d’avortements spontanés, de consultations tardives et de gros-
sesses mal suivies, de ruptures prématurées des membranes et
d’accouchements prématurés, de décollements du placenta et de
souffrances fœtales, d’hémorragies, de retards de croissance in
utero, encore qu’il existe fréquemment dans ces cas des causes
associées telles que le tabagisme ou l’alcoolisme. Au plan gyné-
cologique, les violences, souvent soigneusement camouflées,
peuvent être à l’origine de douleurs pelviennes chroniques
désespérantes, d’irrégularités menstruelles, de dysménorrhées,
de dyspareunies profondes, de vaginisme. Mais à côté de ces
aspects gynécologiques et obstétricaux, il en est d’autres. Les
traumatismes physiques et psychiques, particulièrement destruc-
teurs, subis par la femme entraînent toute une kyrielle de
troubles psychosomatiques, de troubles du sommeil, de dépres-
sions, de tentatives de suicide, mais aussi une consommation
excessive de médicaments analgésiques, anxiolytiques, antidé-
presseurs ou hypnotiques.
Les gynécologues-obstétriciens et les sages-femmes ont un rôle
clé puisque les consultations de gynécologie, et surtout de gros-
sesse, sont des moments privilégiés pour interroger les femmes
dans un climat de confiance. Il convient avant tout de repérer
les violences, ce qui n’est pas évident en l’absence de lésions
visibles. Peu de femmes en parlent spontanément. Elles ont ten-
dance à les nier, à les minimiser, voire à défendre leur agres-
seur, même lorsque les signes sont apparents. D’où l’intérêt au
moindre doute de poser quelques questions simples sur les rela-
tions avec le partenaire. L’existence de dépliants placés dans les
salles d’attente pourrait utilement amorcer le dialogue.
Si la femme parle, on doit alors évaluer la gravité des faits pour
elle-même et les enfants de la fratrie, toujours pris en otage,
consigner l’histoire et la nature des lésions dans le dossier, faire
un certificat d’incapacité totale de travail (ITT) selon des règles
précises. On doit aussi informer la femme de ses droits : droit de
quitter le domicile conjugal et de partir avec ses enfants, après
avoir averti la police (main courante) ou la gendarmerie (procès
verbal de renseignement judiciaire). Enfin, on doit la conseiller
au mieux de ses intérêts.
Il faut bien reconnaître que les médecins et les sages-femmes
n’ont habituellement pas le temps d’approfondir la situation au
cours d’une consultation chargée. Pour pallier cette difficulté,
quelques mesures peuvent être mises en œuvre. Dans les ser-
vices publics, le chef de service peut désigner une personne
“référente” qui pourrait prendre en charge ces femmes, comme
le sont déjà, de plus en plus souvent, les toxicomanes, les jeunes
désirant accoucher sous X, les marginales... Ce peut être l’assis-
tante sociale, un médecin, une sage-femme ou une infirmière.
Ces observations seraient à l’évidence à inclure dans les “staffs
de parentalité” mis en place dans certains services parisiens.
Dans le privé, le gynécologue ou l’obstétricien devraient dispo-
ser de fiches claires et pratiques leur indiquant ce qu’il convient
de faire ainsi que les adresses et numéros de téléphone des asso-
ciations vers lesquelles ils pourront orienter la patiente.
Le rôle du médecin peut être déterminant pour prévenir un drame.
L’analyse rétrospective de dossiers d’homicide, en particulier, a
révélé que l’accident aurait pu être évité si on avait tenu compte des
signes d’alerte. Qu’on le veuille ou non, malgré la constante réfé-
rence aux droits de l’homme, notre société n’évolue pas vers le res-
pect d’autrui et les cas de violences conjugales risquent de se multi-
plier. Les gynécologues-obstétriciens ont un rôle social éminent à
jouer et les actions en faveur des femmes maltraitées s’inscrivent
dans le droit fil de celles que menait Pinard en d’autres temps. ■
ÉDITORIAL
Alerte aux violences conjugales
●R. Henrion*
* Académie nationale de médecine, 16, rue Bonaparte, 75006 Paris.
S
1
/
1
100%