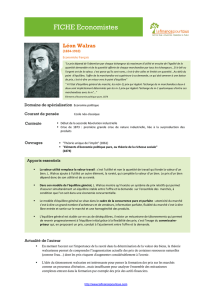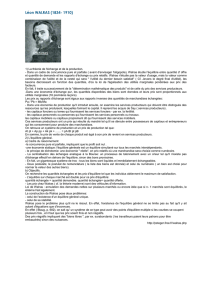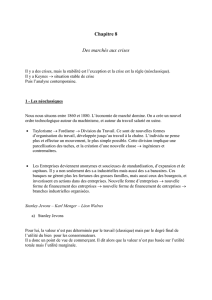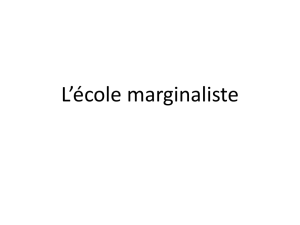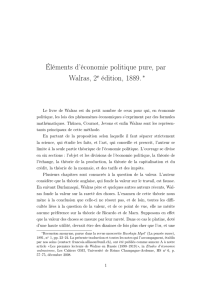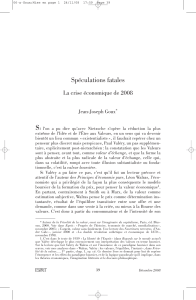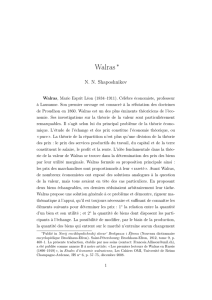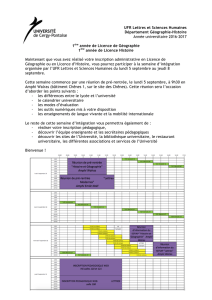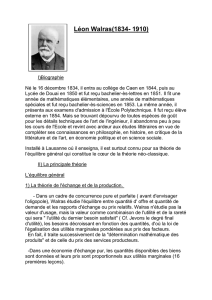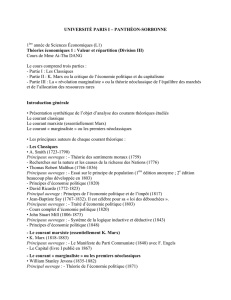CAHIERS D`ÉPISTÉMOLOGIE

CAHIERS
D'ÉPISTÉMOLOGIE
Publication du Groupe de Recherche en Épistémologie Comparée
Directeur: Robert Nadeau
Département de philosophie, Université du Québec à Montréal
La solidarité chez Walras, entre droit naturel de l’État
et marché républicain
Vincent Bourdeau
Cahier nº 2005-04 327e numéro
http://www.philo.uqam.ca

Cette publication, la trois cent vingt-septième de la série, a été rendue possible grâce à la contribution
financière du FQRSC (Fonds québécois de recherche sur la société et la culture).
Aucune partie de cette publication ne peut être conservée dans un système de recherche documentaire,
traduite ou reproduite sous quelque forme que ce soit - imprimé, procédé photomécanique, microfilm,
microfiche ou tout autre moyen - sans la permission écrite de l’éditeur. Tous droits réservés pour tous pays./
All rights reserved. No part of this publication covered by the copyrights hereon may be reproduced or used
in any form or by any means - graphic, electronic or mechanical - without the prior written permission of the
publisher.
Dépôt légal – 1er trimestre 2005
Bibliothèque Nationale du Québec
Bibliothèque Nationale du Canada
ISSN 0228-7080
ISBN: 2-89449-127-1
© 2005 Vincent Bourdeau

LA SOLIDARITE CHEZ WALRAS,
ENTRE DROIT NATUREL DE L’ETAT ET MARCHE REPUBLICAIN
VINCENT BOURDEAU
[vbourdeau@sympatico.ca]
Étude préparée pour le séminaire de recherche du GREC du vendredi 4 mars 2005 (Département
de philosophie, Université du Québec à Montréal).


5
Introduction
Le programme des historiens du républicanisme, comme celui des philosophes politiques contemporains soucieux de
reconstruire l’argumentaire républicain, s’est focalisé sur le rejet de l’irréductibilité des concepts de liberté et
d’égalité1. Pour la tradition républicaine, en effet, l’articulation d’une liberté commune à une liberté individuelle est
largement thématisée sans qu’elle n’apparaisse comme une contradiction2. Cette articulation a pris historiquement
plusieurs formes.
Dans les discours politiques de Machiavel à la renaissance, mais aussi encore dans les pamphlets diffusés par les
partisans de la Country Party Ideology à la fin du XVIIe siècle, l’attachement du citoyen à la cité trouve son origine
dans le rapport propriétaire qu’il entretient à l’égard de cette dernière : patriotisme et propriété privée du sol
définissent la figure du citoyen qui apparaît dès lors comme un citoyen-propriétaire capable de prendre les armes
pour défendre la cité, c’est-à-dire aussi ses terres. L’idéal républicain classique est donc d’une certaine manière
élitiste, attaché aux seuls cas des propriétaires-citoyens . Face à l’émergence des sociétés commerciales, à partir de
la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle, et aux revendications démocratiques, lors de la Révolution
française de 1789 notamment, le républicanisme s’est trouvé confronté à la nécessité de refondre les arguments qui
lui avaient permis jusqu’alors de mobiliser une frange non négligeable des élites (propriétaires fonciers) mais aussi
tout un ensemble de travailleurs indépendants. Au tournant du XIXe siècle, la figure du travailleur doit être incluse
dans l’univers du citoyen3.
Les historiens de la pensée économique ont rarement, sinon jamais, rapproché les écrits walrasiens de cette tradition
républicaine. Pourtant bien des traits de l’économie politique de Léon Walras sont redevables des questions
soulevées par le courant républicain, en particulier après le renouvellement de l’argumentaire républicain au
1 Les critiques portent en particulier sur le texte d’Isaïah Berlin, Éloge de la liberté, Paris, Calmann-Lévy,
1988 (traduction de Two Concepts of Liberty, 1958).
2 Cf. J. Pocock, Le moment machiavélien, P.U.F., 1985 (1975) ; Q. Skinner, Les fondements de la pensée
politique moderne, Albin Michel, 2001 (1979) ; – , La liberté avant le libéralisme, Seuil, 2001 (1998) ;
Ph. Pettit, Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, Gallimard, 2004 (1997) ; J.-F.
Spitz, La liberté politique. Essai de généalogie conceptuelle, P.U.F., 1995.
3 Sur le rapport entre l’économie politique et le républicanisme, et la nécessité de penser après 1789 les
conditions « industrielles » de la bonne république, voir : R. Whatmore, Republicanism and the French
Revolution. An Intellectual History of J.-B. Say’s Political Economy, O.U.P., 2000 ; sur la question de
l’ « inclusion » (ou de l’égalitarisme républicain tel qu’il se pose dans des formulations modernes) voir
Ph. Pettit, Républicanisme, op. cit., en particulier, p. 148 : « Le présupposé inclusiviste posant que chacun
doit être pris en compte et que personne ne doit avoir plus de poids que les autres […] incarne d’ores et
déjà une sorte d’engagement égalitaire : il signifie que la cité se doit de traiter les individus comme des
êtres égaux ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%