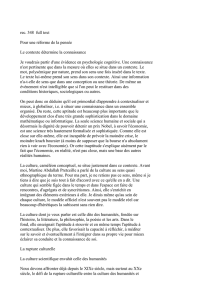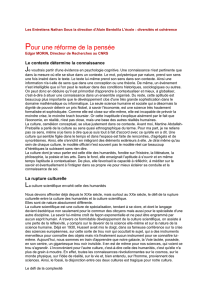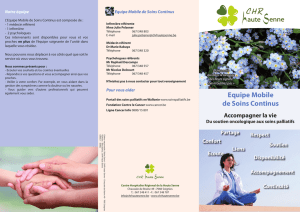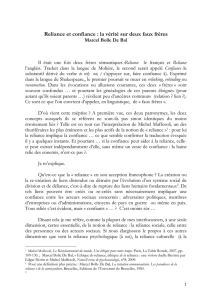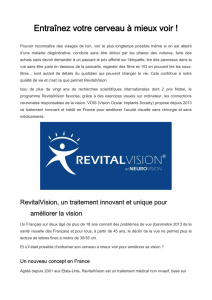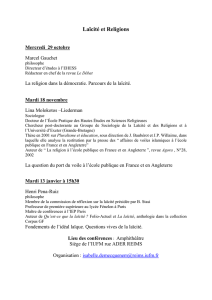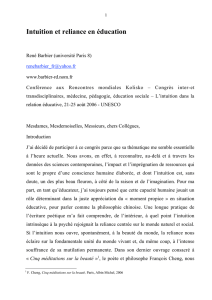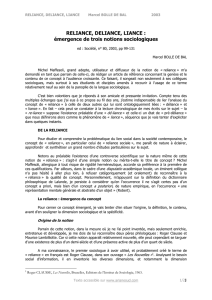Pour une réforme de la pensée

Pour une réforme de la pensée
Edgar Morin
Le contexte détermine la connaissance
Je voudrais partir d'une évidence en psychologie cognitive. Une connaissance n'est pertinente que dans la
mesure où elles se situe dans un contexte. Le mot, polysémique par nature, prend son sens une fois inséré dans
le texte. Le texte luimême prend son sens dans son contexte. Ainsi une information n'atelle de sens que dans
une conception ou une théorie. De même un événement n'est intelligible que si l'on peut le restituer dans des
conditions historiques, sociologiques ou autres.
On peut donc en déduire qu'il est primordial d'apprendre à contextualiser et mieux, à globaliser, i.e. à situer une
connaissance dans un ensemble organisé. Du reste, cette aptitude est beaucoup plus importante que le
développement clos d'une très grande sophistication dans le domaine mathématique ou informatique. La seule
science humaine et sociale qui a désormais la dignité de pouvoir détenir un prix Nobel, à savoir l'économie, est
une science très hautement formalisée et sophistiquée. Comme elle est close sur ellemême, elle est incapable de
prévoir la moindre crise, le moindre krach boursier (à moins de supposer que la bourse n'a absolument rien à
voir avec l'économie). Or cette inaptitude s'explique aisément par le fait que l'économie, en réalité, n'est pas
close, mais une base des autres réalités humaines.
La culture, caméléon conceptuel, se situe justement dans ce contexte. Avant moi, Martine Abdallah Pretceille a
parlé de la culture au sens quasi ethnographique du terme. Pour ma part, je ne retiens pas ce sens, même si je
tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle en a dit. Une culture qui semble figée dans le temps et
dans l'espace est faite de rencontres, d'agrégats et de syncrétismes. Ainsi, elle s'enrichit en intégrant des
éléments extérieurs à elle. Je dirais même qu'au sein de chaque culture, le modèle officiel n'est souvent pas le
modèle réel car beaucoup d'hérétiques la subissent sans rien dire.
La culture dont je veux parler est celle dite des humanités, fondée sur l'histoire, la littérature, la philosophie, la
poésie et les arts. Dans le fond, elle enseignait l'aptitude à stouvrir et en même temps l'aptitude à contextualiser.
De plus, elle favorisait la capacité à réfléchir, à méditer sur le savoir et éventuellement à l'intégrer dans sa propre
vie pour mieux éclairer sa conduite et la connaissance de soi.
La rupture culturelle
La culture scientifique envahit celle des humanités
Nous devons affronter déjà depuis le XIXe siècle, mais surtout au XXe siècle, le défi de la rupture culturelle
entre la culture des humanités et la culture scientifique. Elles sont de nature absolument différente.
La culture scientifique est une culture de spécialisation, tendant à se clore, et dont le langage devient ésotérique
non seulement pour le commun des citoyens mais aussi pour le spécialiste d'une autre discipline. Le savoir lui
même croît de façon exponentielle et ne peut être engrammé par aucun esprit humain. A travers ce formidable
développement de la culture scientifique, on assiste à une perte de la réflexivité, y compris sur le devenir de la
science elle-même et sur la nature de la science humaine. Déjà en 1930, Husserl avait mis le doigt, dans sa
fameuse conférence sur la crise des sciences européennes, sur cette sorte de trou du noir qui occultait le sujet,
qui a des instruments merveilleux pour connaître des objets mais n'a finalement aucun instrument pour se
connaître luimême. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre que notre galaxie, la Voie lactée, possède,
en son centre, un gigantesque trou noir invisible. Il en est de même pour nos sciences, qui voient ce trou
s'agrandir. L'inconvénient pour l'autre culture, i.e. celle des humanités, c'est qu'elle n'a plus de grain à moudre.
En effet, toutes les connaissances révolutionnantes sur le cosmos, sur le monde physique, sur l'idée de réalité,
sur la vie et, bien entendu, sur l'homme, proviennent des sciences. Ainsi, le fossé, la disjonction entre ces deux
cultures est tragique pour notre culture.
Le défi de la complexité
A ce fossé s'ajoute un deuxième défi, celui de la complexité, qu'ont rencontré les sciences au XXe siècle. A la
fin de ce siècle, il était entendu dans le monde scientifique que les sciences reposaient sur trois piliers de
certitude :
Le premier pilier était l'ordre, la régularité, la constance et surtout le déterminisme absolu. Laplace imaginait
qu'un démon, doté de sens et d'un esprit supérieur, pouvait non seulement connaître tout événement du passé
mais surtout ceux du futur.
Le deuxième pilier était la séparabilité. Je prends un objet et un corps. Pour le connaître, il suffit de l'isoler
conceptuellement ou expérimentalement en l'extrayant de son milieu d'origine pour le transformer dans un
milieu artificiel.
Le troisième pilier était la valeur de preuve absolue fournie par l'induction et la déduction, et les trois principes

aristotéliciens qui établissaient l'univocité de l'identité et le rejet de la contradiction.
Or ces trois piliers sont aujourd'hui en état de désintégration, non pas parce que le désordre a remplacé l'ordre
mais parce qu'on s'est rendu compte que là où l'ordre régnait en maître, dans le monde physique, il existait en
réalité un jeu dialogique. J'entends par là un jeu à la fois complémentaire et antagoniste, entre l'ordre et le
désordre. Ce constat était valable non seulement pour la physique mais aussi pour l'histoire de la Terre et
l'histoire de la Vie. Par exemple, vous savez que 96% des espèces vivantes ont disparu lors d'un cataclysme au
début de l'ère secondaire et quelques autres aussi à cause du météorite qui a provoqué l'extinction des
dinosaures à la fin du secondaire. L'évolution se situe donc dans un jeu heurté qui continue l'histoire humaine.
De même, en ce qui concerne la séparation des objets, on avait oublié que les objets étaient liés les uns aux
autres au sein d'une organisation. A partir de ce moment, il se crée un système, dont l'originalité première est de
créer des qualités appelées émergences. Elles apparaissent dans le cadre de cette organisation, mais elles
n'existent pas dans les parties conçues isolément. On a alors compris que la vie n'était pas faite d'une substance
spécifique mais constituée des mêmes substances physicochimiques que le reste de l'univers. La vie est issue de
molécules ou de macromolécules qui n'ont séparément aucune des propriétés de la vie, la reproduction,
l'autoreproduction ou le mouvement. Les propriétés vivantes n'existent donc pas un niveau isolé des molécules,
elles n'émergent que grâce à une autoorganisation complexe.
C'est pourquoi du reste un certain nombre de sciences sont devenues sytémiques, comme les sciences de la
Terre, l'écologie ou la cosmologie. Ces sciences ont permis d'articuler entre elles les connaissances des
disciplines différenciées. Par exemple l'écologue utilise les connaissances des botanistes, des zoologistes, des
microbiologistes et des géophysiciens.
Cependant, il n'a pas besoin de maîtriser toutes ces sciences. Sa connaissance propre consiste en l'étude des
réorganisations, des règlements et régulations des systèmes. On constate donc, aujourd'hui, qu'un certain
nombre de sciences se remembrent en mettant à jour le problème de la reliance. Plus largement, tout ce qui est
séparé dans notre univers est en même temps inséparable.
Par ailleurs, les travaux de Popper ont montré les limites de la valeur absolue de l'induction. De plus, la
déduction, ellemême, peut avoir des dérapages. Il suffit de se souvenir du fameux paradoxe du Crétois qui
prétend que tous les Crétois sont des menteurs, ou bien tous les théorèmes d'indécidabilité dont le plus célèbre
est celui de Gödel.
Ainsi, les trois piliers qui formaient le corps de certitudes sont ébranlés. Pour aggraver la situation, la physique
et la macrophysique étaient parvenues dans les années 20 à une sorte de paradoxe profond. Le même élément,
i.e. la particule, pouvait se comporter de façon contradictoire, selon l'expérience, tantôt comme une onde tantôt
comme un corpuscule. A travers ce paradoxe étonnant, nous retrouvons aussi le paradoxe de l'individu et de
l'espèce. Si vous voyez des individus, vous ne voyez pas l'espèce qui incarne la continuité. Mais si vous cessez
de voir des individus et que vous regardez un très vaste espace de temps, il n'y a plus d'individus, vous ne
voyez que des espèces. Ainsi, pour la société, certains sociologues pensent que l'individu n'existe pas. Ils n'en
voient pas car, selon eux, les individus ne sont que des marionnettes et des pantins de la société, seule réalité.
En revanche, pour d'autres sociologues, la société n'existe pas puisqu'ils ne voient, eux, que des individus.
On comprend par ces exemples que le défi de la complexité réside dans le double défi de la " reliance " et de
l'incertitude. Il faut relier ce qui était considéré comme séparé. En même temps, il faut apprendre à faire jouer les
certitudes avec l'incertitude. La connaissance est en effet une navigation dans un océan d'incertitudes parsemé
d'archipels de certitudes. Certes, notre logique nous est indispensable pour vérifier et contrôler, mais la pensée,
finalement, opère des transgressions à cette logique. La rationalité ne se réduit pas à la logique, elle l'utilise
comme un instrument. La science a donc reconnu officieusement ce défi de la complexité qui pénètre,
aujourd'hui, dans la connaissance scientifique, mais être encore reconnu officiellement.
Le défi de la complexité s'intensifie dans le monde contemporain puisque, justement, nous sommes dans une
époque dite de mondialisation, que j'appelle l'ère planétaire. Cela signifie que tous les problèmes fondamentaux
qui se posent dans un cadre français ou européen dépassent ce cadre car ils relèvent, à leur façon, des processus
mondiaux. Les problèmes mondiaux agissent sur des processus locaux qui rétroagissent à leur tour sur des
processus mondiaux. Répondre à ce défi en contextualisant à l'échelle mondiale, voire en globalisant, est devenu
absolument vital, même si cela paraît très difficile.
Il faut aussi pouvoir penser dans l'incertitude car nul ne peut prévoir ce que sera demain ou aprèsdemain. De
plus, nous avons perdu la promesse d'un progrès infailliblement prédit par les lois de l'histoire ou du
développement logique de la science et de la raison. Nous sommes donc dans une situation où nous prenons
conscience tragiquement des besoins de reliance et solidarité et de la nécessité de travailler dans l'incertitude.
Parallèlement, il se développe dans tous les domaines techniques et spécialisés des connaissances
compartimentées. Nous voyons également dans le monde des mentalités et des pratiques fragmentaires, repliées
sur ellesmêmes, sur la religion, sur l'ethnie ou sur la nation. On se focalise sur un seul fragmente de l'humanité
dont on fait pourtant partie. Alors, d'un côté, nous avons l'intelligence technocratique, aveugle, incapable de
reconnaître la souffrance et le bonheur humain, ce qui cause bien des gaspillages, des ruines et des malheurs et,

de l'autre, nous avons la myopie hagar de du repli sur soimême.
La riposte à cette rupture
La reliance au coeur de la réforme de pensée
La riposte ne peut venir que d'une réforme de la pensée, i.e. d'une réforme qui instituerait le principe de reliance,
en rapprochant ce qui jusqu'à présent était conçu de façon disjointe et parfois répulsive.
Prenons par exemple la difficulté de concevoir le problème de la relation entre le tout et la partie. Pascal, déjà,
avait dit que toutes les choses était liées les unes aux autres, il était impossible de connaitre les parties sans
connaitre les tout et de connaitre le tout sans connaitre les parties. Il montrait ainsi que la connaissance était une
navette permanente du tout aux parties, en échappant à l'alternative stupide qui oppose les connaissances
particulières non reliées entre elles à la connaissance globale, creuse et vague. Malheureusement, plus vous avez
des connaissances spécialisées et limitées, plus vous avez aussi des idées globales absolument stupides sur la
politique, l'amour ou la vie. Pour remédier à cet engrenage, Pascal nous avait donc donné un programme de
travail.
De son côté, Leibniz nous disait que la vraie unité maintenait et sauvait la multiplicité. Or, chaque fois qu'on
parle d'unité, on homogénéise en gommant les différences. Réciproquement, à chaque fois qu'on parle des
différences, on catalogue. Par conséquent, on est incapable d'en voir l'unité.
Les trois principes du réapprentissage par la reliance
Le problème de la reliance est un problème de réapprentissage de la pensée qui implique l'entrée en action de
trois principes :
Le premier principe est celui de la boucle récursive ou autoproductive qui rompt avec la causalité linéaire. Cette
boucle implique un processus où les effets et les produits sont nécessaires à leur production et à leur propre
causation Nous sommes d'ailleurs les effets et les produits d'un processus de reproduction. Mais nous en
sommes aussi les producteurs, sinon le processus ne pourrait continuer. En outre, une société est le produit des
interactions entre les individus qui la composent. De cette société émergent des qualités comme le langage ou la
culture qui rétroagissent sur les produits, produisent ainsi des individus humains. Par là même, nous cessons
d'être seulement des primates grâce à la culture. La causalité représente désormais une spirale, elle n'est plus
linéaire.
Le deuxième principe est celui de la dialogique qui est un peu différente de la dialectique. Il faut, dans certains
cas, mettre ensemble des principes, des idées et des notions qui semblent s'opposer les uns aux autres. Héraclite
avait magnifiquement dit, il y a plus de 2500 ans : " vivre de mort, mourir de vie ". Cette idée, absolument
paradoxale sur le plan du concept, s'éclaire aujourd'hui. On sait qu'en chaque être vivant, les molécules se
dégradent, que les cellules produisent de nouvelles molécules, que les cellules meurent et sont remplacées par
l'organisme, que le sang propulsé par les battements du coeur détoxifie les cellules. Sans arrêt, un processus de
rajeunissement s'opère à travers la mort de nos constituants. Nous pouvons donc, très rationnellement,
expliciter cette formulation paradoxale. Dans ce contexte le principe dialogique est nécessaire pour affronter des
réalités profondes qui, justement, unissent des vérités apparemment contradictoires. Pascal disait que le
contraire d'une vérité n'est pas une erreur; c'est une vérité contraire. De façon plus sophistiquée, Niels Bohr
disait que le contraire d'une vérité profonde n'est pas une erreur mais une autre vérité profonde. En revanche, le
contraire d'une vérité superficielle est une erreur imbécile.
J'ai appelé hologramique le troisième principe, en référence au point de l'holograrnme qui contient presque la
totalité de l'information de la figure représentée. Non seulement la partie est dans le tout mais le tout est dans la
partie. De même, la totalité de notre patrimoine génétique est contenue à l'intérieur de chaque cellule du corps.
La société, en tant que tout, est présente aussi à l'intérieur de nousmêmes car nous avons son langage et sa
culture. Là aussi, c'est une vision qui brise les anciens schémas simplifiantes.
La réforme de pensée est paradigmatique
La réforme de la structure de pensée est de nature paradigmatique, i.e. elle concerne les principes fondamentaux
qui doivent gouverner tous nos discours et nos théories. Disons que, jusqu'à présent, le paradigme qui domine
et qui nous fait obéir en aveugles est un paradigme de disjonction et de réduction. Par exemple, chez l'être
humain, il existe un aspect biologique, incarné par le cerveau, et un aspect culturel, lié à l'esprit. Naturellement,
on sépare ces deux aspects. On étudie le cerveau dans les départements biologiques et l'esprit dans les
départements psychologiques, sans jamais créer des liens. En plus de séparer, on réduit. C'est ainsi que les
sociobiologistes vont essayer de réduire tous les comportements humains à ceux des fourmis ou des primates.
En revanche, un paradigme de complexité est fondé sur la distinction, sur la conjonction et l'implication
mutuelle. Le cerveau implique l'esprit et réciproquement. L'esprit (mente) ne peut émerger qu'à partir d'un
cerveau au sein d'une culture, et le cerveau ne peut être reconnu que par un esprit. De plus, comme nous le
savons, les transformations biochimiques de notre cerveau affectent notre esprit, lequel peut déclencher dans le
cerveau maladies ou guérisons psychosomatiques.

La mission de l'enseignement dans ce contexte
L'apprentissage de la reliance
Aussi la mission première de l'enseignement est d'apprendre à relier d'autant plus que, jusqu'à présent, on
apprend trop à séparer. Il faut en même temps apprendre à problématiser.
Je pense par exemple à la laïcité. Trop souvent, on croit que la forme historiquement féconde que la laïcité a
prise en France au début du siècle est la forme originelle de la laïcité. Il faut reconnaître que cette forme de
laïcité s'est développëe dans des conditions historiques spécifiques. L'Église catholique avait la mainmise sur
l'enseignement. En réalité la laïcité remonte à l'âge de la Rennaissance. C'est alors qu'on a ressuscité
l'interrogation sur la nature, sur l'homme, sur la vie, sur Dieu. Cette problématisation a pris un autre cours à
l'époque des Lumières. Aujourd'hui, la laïcité doit réinterroger ce qui fut sa croyance au début du siècle, la
science, la technique, le progrès. Cela ne signifie pas qu'il faille rejeter la science ou la technique; il faut
simplement en reconnaître les ambivalences et les formes aveugles, dominatrices, qu'elles engendrent.
Je crois qu'à ce momentlà relier et problématiser vont de pair. Si j'étais enseignant, j'essaierais de relier les
questions à partir de l'être humain, en le montrant sous ses aspects biologiques, psychologiques, sociaux, etc.
Ainsi, je pourrais accéder aux disciplines, tout en maintenant le lien humain, et en dégager l'unité complexe de
l'homme.
Je pense à ce que disait mon ami l'astrophysicien Michel Cassé. Au cours d'un banquet, un oenologue distingué
lui avait demandé ce qu'un astrophysicien voyait dans son verre de bordeaux. Il a répondu : " je vois la
naissance de 1'univers puisque je vois les particules qui se sont formées dans les premières secondes. Je vois
le soleil antérieur au notre puisque les atomes de carbone se sont formés à l'intérieur de la forge de ce soleil
qui a explosé. Puis le carbone est arrivé dans cette sorte de poubelle cosmique qui a été à l'origine de la Terre.
Je vois aussi la formation des macromolécules. Je vois la naissance de la vie, le développement du monde
végétal, la domestication de la vigne dans les pays méditerranéens. Je vois le développement de la technique
moderne qui permet aujourd'hui de contrôler de façon électronique la température de fermentation dans les
caves. Je vois toute l histoire cosmique et humaine dans ce verre de vin ". I1 voyait, en somme, un verre de
bordeaux sublime.
Sans avoir de penser à tout cela, chaque fois que vous buvez un verre de vin, il faut pouvoir relier. Il faut
reconnaître notre place dans l'univers. Or nous sommes devenus relativement étrangers à cet univers. Nous
sommes différents des animaux par la conscience, la culture et notre volonté de connaître. Nous voulons aussi
essayer de construire une société un peu moins unhumaine fondée sur des rapports un peu moins ignobles.
L'apprentissage de la cohérence à travers la complexité
Je dirai que c'est la cohérence de la pensée complexe qui contient la diversité et permet de la comprendre.
J'adhère à ce qui peut être dit sur la diversité des psychologies, des héritages culturels. Cependant, la diversité
doit être pensée en se fondant sur la cohérence et la compréhension. Je pense que cette mission, apprendre à
relier, à problématiser, est un retour à une mission fondamentale dont j'ai déjà parlé. J'ajoute que c'est une tâche
désormais vitale car il y va de la possibilité de régénerer la culture par la reliance des deux cultures séparées,
celle de la science et celle des humanités.
Cette reliance nous permet à la fois de contextualiser correctement, de réfléchir et d'essayer d'intégrer notre
savoir dans la vie. Bien entendu, cela ne donne pas la recette infaillible à tout problème. Nous sommes bel et
bien dans l'incertitude. Cependant, il existe des ripostes et des stratégies contre l'incertitude. Comme nous ne
sommes pas sûrs de réussir, nous faisons un pari comme Pascal qui avait très bien compris que l'existence de
Dieu n'était pas prouvable, ni logiquement ni empiriquement. Nous aussi, laïcs (au sens de la Rennaissance),
devons parier sur nos croyances en la fraternité et en la liberté.
L'apprentissage de l'amour d'autrui
Pour clore, je vais vous rappeler l'épisode de Panurge et des grêlons que me rappelait récemment une amie
enseignante. Des grêlons tombent sur le pauvre Panurge et chahutent. Quand les grêlons tombent à terre, il voit
qu'il commencent à se liquéfier. Il se rend alors compte que ce sont des paroles gelées. Je dirai qu'il ne s'agit pas
de dégeler les paroles de l'enseignement; il faut plutôt les réchauffer. Comme Platon le disait, il y a bien
longtemps : pour enseigner il faut de l'éros. L'éros n'est pas seulement le désir de connaître et de transmettre, ou
bien seulement le plaisir d'enseigner, de communiquer ou de donner; c'est aussi l'amour de ce que l'on dit et de
ce que l'on pense vrai. L'amour, voilà qui introduit la profession pédagogique, la véritable mission de
l'éducateur.
(Texte paru dans les Entretiens Nathan des 25 et 26 novembre 1995 ; aux Editions Nathan 1996)
1
/
4
100%