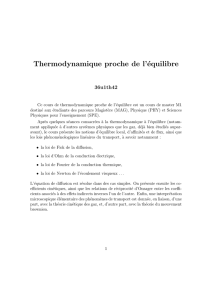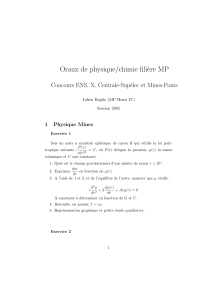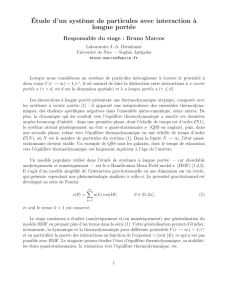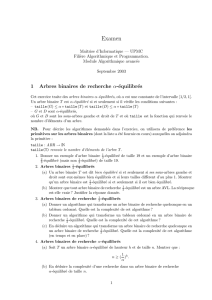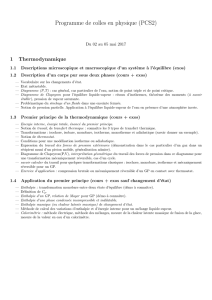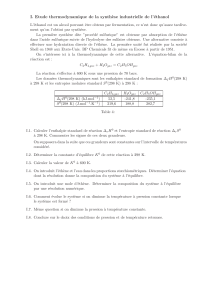L`équilibre macro

L’´equilibre Macro-Economique
Jean-Pierre Damon,
octobre 1985.
La position de d´epart des th´eoriciens est la situation d’´equilibre qui permet `a la totalit´e de la pro-
duction d’ˆetre soit consomm´ee, soit utilis´ee comme investissement et, `a ce niveau suppos´e d’´equilibre,
correspond une hypoth`ese de plein emploi de la main-d’oeuvre et des machines.
L’analyse macro-´economique s’attache alors `a d´eterminer les condi tions qui r´ealisent les niveaux
´equilibr´es de la production d’une part, de la consommation et des investissements d’autre part. A ces
niveaux, mesur´es en quantit´es, il convient d’ajouter le niveau de la masse mon´etaire en circulation qui
conditionne le niveau g´en´eral des prix.
Cette m´ethode d’analyse repose sur un certain nombre d’hypoth`eses :
– au niveau macro-´economique, on ne distingue pas les diff´erentes sortes de biens fabriqu´es; toute
production donne lieu `a un produit unique, utilis´e indiff´eremment pour la consommation et l’inves-
tissement;
– la d´etermination des quantit´es produites est ind´ependante du niveau des prix, lequel est suppos´e
d´ependre de la quantit´e de monnaie en circulation (th´eorie quantitative de la monnaie);
– il est fait abstraction de l’environnement international, tant en ce qui concerne les ´echanges de
marchandises que la valeur de la monnaie nationale.
On distingue ainsi quatre grandes fonctions dont l’ajustement correspond `a la situation d’´equilibre
macro-´economique : production, consommation, investissement et liquidit´e.
Mais la stabilit´e et la d´efinition de cet ´equilibre diff`erent selon deux grands courants de pens´ee : les
N´eo-Classiques d’une part, les post-Keynesiens d’autre part.
1 L’´equilibre n´eo-classique
Cette ´ecole d’´economistes d´ecoupe les activit´es ´economiques en autant de march´es o`u s’´egalisent une
offre et une demande sp´ecifiques.
1.1 Le niveau de l’emploi
Face `a une offre de travail constitu´ee de l’ensemble des travailleurs qui souhaitent s’embaucher, existe
une demande de travail qui est le fait des chefs d’entreprise. La fonction d’offre est d´etermin´ee par le niveau
du salaire r´eel, chaque travailleur ´etant suppos´e faire un choix entre son embauche et les satisfactions
qu’il pourra retirer du salaire qui lui sera vers´e. Plus le salaire r´eel est ´elev´e, plus l’offre de travail sera
grande. Ainsi, l’offre de travail est une fonction croissante du taux de salaire r´eel.
La demande de travail ´emanant des chefs d’entreprise r´esulte d’un calcul ´economique mettant en
rapport le coˆut du travail, c’est-`a-dire le salaire pay´e, et le produit de ce mˆeme travail pour l’entreprise.
La valeur de ce produit d´epend des conditions techniques de production, la productivit´e du travail, et du
prix de vente de ce produit sur le march´e des produits.
P. 1

Jean-Pierre DAMON L’´
EQUILIBRE MACRO-ECONOMIQUE
Si on suppose donn´ees les conditions techniques, c’est-`a-dire le mat´eriel et l’outillage, la productivit´e
physique du travail est aussi donn´ee. Seule peut varier la productivit´e en valeur, c’est-`a-dire le coˆut du
travail pour l’entreprise, le salaire. Plus le rapport entre ce salaire et le prix de vente du produit est
´elev´e, moins les entreprises ont int´erˆet `a embaucher des travailleurs. Or, ce rapport, au niveau macro-
´economique, n’est autre chose que le salaire r´eel, rapport entre le salaire nominal et le niveau g´en´eral
des prix. En cons´equence, la demande de travail est aussi une fonction du taux de salaire r´eel, mais une
fonction d´ecroissante.
OD
Emploi N
N0
salaire r´eel w
p
w
p0
Fig. 1 – Le niveau de l’emploi
Sur le march´e du travail, tout est suppos´e se passer comme si l’on avait affaire `a la rencontre de deux
courbes repr´esentant chacune la continuit´e des offreurs et demandeurs de travail. Il existe alors un point
d’intersection et un seul qui permet l’embauche d’un certain nombre de travailleurs N0`a un certain taux
de salaire r´eel (w/p)0: cf. fig 1.
Ce niveau d’emploi, ainsi d´etermin´e sur le march´e du travail, est consid´er´e par la th´eorie comme un
niveau de plein-emploi. Ceci tient au fait que si d’autres travailleurs non embauch´es souhaitaient l’ˆetre, ils
sont suppos´es r´eclamer un salaire sup´erieur au salaire d’´equilibre. Par le jeu de la concurrence, suppos´ee
pure et parfaite, un accroissement des demandeurs d’emploi doit faire baisser le niveau du salaire r´eclam´e
ou, en termes graphiques, d´ecaler vers le bas la courbe d’offre de travail : l’intersection avec la courbe de
demande s’effectuerait alors `a un niveau de salaire inf´erieur et `a un niveau d’emploi sup´erieur.
1.2 Le niveau de la production
Le niveau de l’emploi ayant ainsi ´et´e d´etermin´ee le niveau de la production se d´eduit automatiquement.
En effet, le produit r´esulte de la combinaison du travail et des machines. A un moment donn´e, les
machines constituent une quantit´e donn´ee. Leur rendement d´epend seulement du nombre de travailleurs
qui leur sont affect´es. Ce rendement peut ˆetre croissant si, `a un accroissement de l’emploi, correspond un
accroissement plus fort du produit, constant si les deux accroissements relatifs sont ´egaux ou d´ecroissant si
la liaison est inverse. Cette caract´eristique du rendement d´etermine la forme de la fonction de production.
´
Economiquement, la situation la meilleure pour le chef d’entreprise est celle o`u tout accroissement de
l’emploi entraˆınerait un accroissement de production inf´erieur au profit retir´e sur cet accroissement. Ce
raisonnement `a la limite ou `a la marge, est `a la base de ce qu’on appelle le calcul marginal. La situation
limite d’embauche pour une entreprise est ainsi celle o`u le produit marginal en valeur du travail ´egalise
le coˆut marginal du travail, c’est-`a-dire fait disparaˆıtre tout profit sur cette unit´e marginale.
Au niveau macro-´economique, on consid`ere en g´en´eral que l’ensemble des entreprises ont une fonction
de production croissante, mais dont le taux de croissance diminue constamment au fur et `a mesure que
l’emploi augmente. Cette fonction correspond `a la courbe Yde notre fig. 2. C’est en rapportant le volume
1 L’´
EQUILIBRE N ´
EO-CLASSIQUE P. 2

Jean-Pierre DAMON L’´
EQUILIBRE MACRO-ECONOMIQUE
Y
Emploi
Produit
N0
Y0
Fig. 2 – Le niveau de la production
d’emploi pr´ealablement d´etermin´e sur cette courbe qu’on d´etermine alors le niveau de la production en
volume Y0, niveau de plein emploi puisqu’il correspond au plein emploi de la main-d’oeuvre.
1.3 Le march´e des biens et services
Comme le raisonnement pr´esuppose l’existence d’un ´equilibre macro-´economique, cette production
trouve automatiquement un d´ebouch´e soit sous forme de consommation, soit sous forme d’investissement.
Ceci correspond, en fait, `a une hypoth`ese suppl´ementaire selon laquelle les revenus distribu´es lors de la
production permettent l’achat de cette mˆeme production et ne donnent pas lieu `a th´esaurisation. Cette
hypoth`ese se traduit par l’existence de deux march´es nouveaux : celui des biens de consommation et celui
des biens d’investissement.
Sur chacun de ces deux march´es existent une offre repr´esent´ee par les biens produits et une demande
sous la forme des revenus distribu´es lors de la production. L’´egalisation de ces offres et de ces demandes
est toujours possible si l’on suppose que les prix sont totalement flexibles : ceci est vrai dans l’hypoth`ese
de concurrence parfaite o`u aucun vendeur ni aucun acheteur n’est susceptible d’influer `a lui seul sur le
prix du march´es qui est seulement subi par chacun. Pr´ecisons seulement que, sur le march´e des biens
d’investissement, la demande correspond `a l’´epargne, c’est-`a-dire la part non consomm´ee des revenus :
sur ce march´e, le prix est, en r´ealit´e, le taux d’int´erˆet auquel les ´epargnants ont droit pour prˆeter aux
entreprises les moyens d’investir.
1.4 Le niveau g´en´eral des prix
Si l’on peut ainsi supposer que sur les diff´erents march´es de biens, les variations de prix permettent
d’´equilibrer les offres et les demandes il n’en reste pas moins que pour l’ensemble de l’´economie, doit ˆetre
d´etermin´e un niveau g´en´eral des prix. Celui-ci a ´et´e suppos´e ind´ependant des conditions de production et
d8´echange. Selon la th´eorie quantitative de la monnaie, il doit ˆetre d´etermin´e par la quantit´e de monnaie
en circulation.
Comme la th´esaurisation est exclue de l’analyse, la quantit´e de monnaie en circulation est suppos´ee
´equilibrer tr`es exactement la production disponible. Le prix de cette production globale, ou niveau g´en´eral
des prix, s’obtient donc en rapportant le montant de la production (Y0sur la fig. 3) `a la masse mon´etaire
figur´ee par la courbe M. Cette courbe est construite de telle fa¸con que le produit des coordonn´ees de
chaque point donne le mˆeme r´esultat : pY =M
Les prix r´eels, tels qu’ils s’´etablissent sur les march´es de biens et services sp´ecifiques sont suppos´es se
r´epartir de part et d’autre du niveau g´en´eral, celui-ci constituant une moyenne de prix.
1 L’´
EQUILIBRE N ´
EO-CLASSIQUE P. 3

Jean-Pierre DAMON L’´
EQUILIBRE MACRO-ECONOMIQUE
M
p0
Y0
Prix
Produit
Fig. 3 – Le niveau g´en´eral des prix
Rappelons que le produit Y0correspond `a une situation de plein-emploi. D`es lors, toute augmentation
de la masse mon´etaire en circulation (par cr´eation de monnaie ou par acc´el´eration de la vitesse de
circulation) ne peut se traduire que par une hausse du niveau g´en´eral des prix. Tout se passe alors comme
si la courbe M´etait d´eplac´ee vers la droite.
1.5 Le taux de salaire
La clˆoture du mod`ele d’´equilibre n´eo-classique est r´ealis´e lorsque le taux de salaire est d´etermin´e. Or,
le taux de salaire r´eel (w/p)0a ´et´e pr´ealablement d´etermin´e sur le march´e du travail. Comme le niveau
g´en´eral des prix (p0) est maintenant connu, le niveau du salaire nominal (w0) se d´eduit automatiquement.
p0
w0
w
p0
Prix
Salaire
Fig. 4 – Le taux de salaire
Ainsi, sur la fig. 4, la droite (w/p)0est le lieu des points o`u le taux de salaire r´eel est celui d´etermin´e
pr´ealablement. En rapportant sur cette droite le niveau g´en´eral des prix (p0), on d´etermine le salaire
nominal (w0).
Finalement, l’analyse n´eo-classique met en lumi`ere l’interd´ependance des diff´erents march´es `a partir
du march´e du travail. Le niveau de l’emploi ´etant d´etermin´e, on en d´eduit le niveau de la production,
le niveau g´en´eral des prix et le taux de salaire. L’´economie est pr´esent´ee comme un tout homog`ene. Si
l’on ajoute que le niveau de l’emploi est celui du plein emploi, on voit que la position d’´equilibre macro-
1 L’´
EQUILIBRE N ´
EO-CLASSIQUE P. 4

Jean-Pierre DAMON L’´
EQUILIBRE MACRO-ECONOMIQUE
´economique correspond `a une position optimale. On peut alors en d´eduire des principes politiques : il
s’agit de permettre `a toutes les relations de jouer parfaitement, c’est-`a-dire assurer la flexibilit´e totale
des prix, des salaires et des taux d’int´erˆet.
2 L’´equilibre post-Keynesien
Keynes et ses successeurs se sont attach´es `a expliciter le comportement des ´echangistes sur les diff´erents
march´es. L’interd´ependance des march´es est pr´esent´ee par eux comme une succession d’´equilibres instan-
tan´es.
2.1 L’´equilibre sur le march´e des produits
Pour les Keynesiens, la demande de biens de consommation est d´etermin´ee Par le niveau du revenu
distribu´e (application de la propension `a consommer). Le probl`eme du prix d’´equilibre sur le march´e
des biens de consommation est alors remplac´e par le probl`eme de la transformation du produit r´eel (on
quantit´es) en revenu (produit en valeur). Or, `a un moment donn´e (en statique de courte p´eriode), le prix
peut ˆetre consid´er´e comme une donn´ee, donc fixe. Dans ces conditions, l’´egalisation entre l’offre et la
demande de biens de consommation est automatiquement r´ealis´ee.
IS
Y0
i0
Revenu
Taux d’int´erˆet
Fig. 5 – L’´equilibre sur le march´e des produits
Il en va tout autrement sur le march´e des biens d’investissement. L’´equilibre sur ce march´e repose
sur l’´egalisation entre l’´epargne et l’investissement. Or, ces deux variables sont ind´ependantes : l’´epargne
d´epend du niveau du revenu (propension `a ´epargner) et l’investissement d´epend du taux d’int´erˆet (par le
jeu de l’efficacit´e marginale du capital). Supposer, d`es lors, un ajustement entre l’´epargne et l’investisse-
ment, c’est poser une relation entre le niveau de revenu et le taux d’int´erˆet. Cette relation (fonction IS)
est une fonction d´ecroissante du revenu par rapport au taux d’int´erˆet (cf. fig. 5). Tout point de la courbe
correspond `a un ´equilibre sur le march´e des biens d’´equipement. Si la propension `a investir augmente,
cela signifie que, pour un taux d’int´erˆet inchang´e, le volume d’investissement est plus important, le revenu
s’accroˆıt d’autant : dans ce cas, la courbe se d´eplace vers le haut.
2.2 L’´equilibre mon´etaire
L’´egalisation entre l’offre et la demande de monnaie est une seconde condition de r´ealisation de
l’´equilibre macro-´economique. Or, pour les Keynesiens, la demande de monnaie d´epend de deux variables :
le niveau de revenu (par la jeu de la pr´ef´erence pour la liquidit´e) et la taux d’int´erˆet. D`es lors, quelque soit
2 L’´
EQUILIBRE POST-KEYNESIEN P. 5
 6
6
 7
7
1
/
7
100%