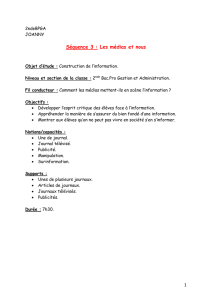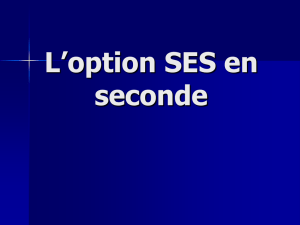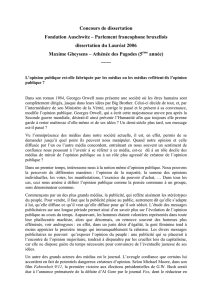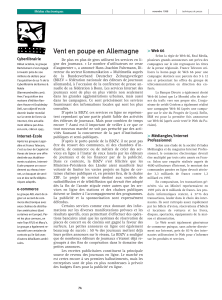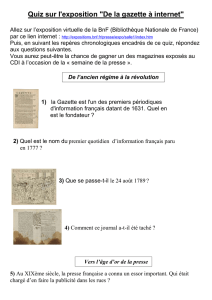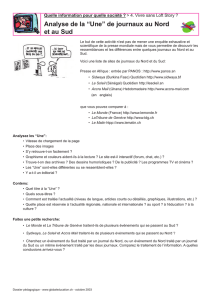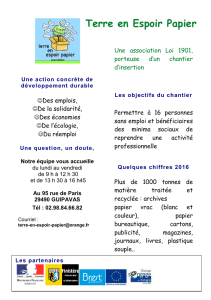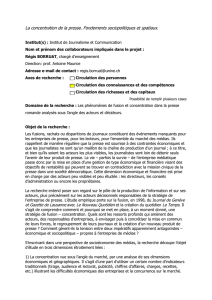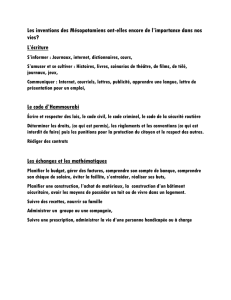Images des enfants et des jeunes véhiculées dans les médias

1
Images des enfants et des jeunes
véhiculées dans les médias
audiovisuels (télévision, publicité,
Internet)
Analyse CODE
Avril 2012
Qu’entend-on derrière le terme « média » ? Il peut se définir comme un « procédé
permettant la distribution, la diffusion ou la communication d’œuvres, de documents ou de
messages sonores ou audiovisuels (presse, cinéma, affiche, radiodiffusion, télédiffusion,
vidéographie, télédistribution, télématique, télécommunication) »
1
. Nous comprenons donc
ici le terme « média » au sens large, en tant que moyen de transmission (cela touche donc à
la fois la publicité, Internet,…).
Evaluer l’impact du rôle des médias sur la formation et les transformations des images
véhiculées à propos de l’enfant
2
(ce que l’on appelle les représentations collectives de
l’enfant) représente un travail conséquent
3
. En effet, il faut tout d’abord dégager les images
construites par les médias. Il faut ensuite s’atteler à définir les contours des représentations
collectives. Enfin, il faut comparer les deux, tout en tenant compte des différentes variables
(en dehors des médias) qui peuvent interférées dans la mise en place et dans l’évolution des
images véhiculées
4
.
Les images véhiculées par certains médias ont plus d’impact en raison de leur plus grande
« fréquentation ». Dès lors, une des questions qui se pose est notamment celle de savoir si
les médias qui évoquent le plus les jeunes sont forcément ceux fréquentés par eux ? Ou
encore quels médias les jeunes utilisent le plus ? « Sans surprise, Internet et la télévision
emportent les suffrages : six jeunes sur dix les utilisent ‘souvent’, et les autres disent les
utiliser parfois. La concurrence est donc rude pour les autres médias. A peine plus de trois
jeunes sur dix s’informeraient en lisant ‘souvent’ des journaux ou des magazines ; six sur dix
les lisant ‘parfois’ et un sur dix n’en lisant jamais. La radio est quant à elle en queue de
peloton : deux jeunes sur dix l’écoutent souvent pour s’informer, un peu moins de la moitié
1
www.larousse.fr
2
Pour rappel, un enfant est toute personne de 0 à 18 ans.
3
L’idée est d’analyser la façon dont les médias se représentent les enfants et non d’étudier les enfants et les
médias eux-mêmes.
4
M. VANOOST, Rôle des médias sur les représentations collectives et spécifiquement sur la perception de la
jeunesse. L’exemple de la RTBF et de RTL, Etude réalisée dans le cadre du colloque « L’image des jeunes dans
les médias » organisé par le Parlement de la Communauté française, 23 février 2011, p. 3. Voyez aussi
l’Observatoire du récit médiatique, www.cclouvain.be/orm

2
d’entre eux le font ‘parfois’ et un tiers d’entre eux déclarent ne jamais s’informer en
écoutant la radio »
5
.
Dans le cadre d’une réflexion sur les droits de l’enfant et les médias
6
entamée par une
analyse sur les réseaux sociaux, la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) a
tenu à consacrer une analyse sur les images de l’enfant et des jeunes dans les médias
7
.
Nous y analyserons la question des images véhiculées de manière générale. Nous
aborderons ensuite la question plus précisément par le biais des journaux télévisés,
d’Internet et de la publicité.
1. Quelle(s) représentation(s) ?
Avant d’analyser les représentations des enfants et des jeunes dans les médias, la question
se pose de savoir ce qu’il faut entendre derrière le terme « représentation » ?
Les représentations sociales sont des phénomènes complexes, toujours activés et agissant
dans la vie sociale. Elles sont composées d'éléments divers qui ont longtemps été étudiés de
façon isolée : attitudes, opinions, croyances, valeurs, idéologies, etc.
8
Denise Jodelet propose une seconde définition des représentations sociales : «la
représentation sociale est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée,
ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un
ensemble social ». Cette forme de connaissance, parce qu'elle se distingue de la
connaissance scientifique, est parfois appelée « savoir de sens commun » ou « savoir naïf »
9
.
Les médias
10
diffusent différentes images ou représentations de l’enfant. L’on peut retrouver
une approche paternaliste (sorte de bienveillance autoritaire), protectionniste,
émancipatrice (libératrice) ou encore libérale (l’enfant est l’égal de l’adulte).
Ces dernières années, les ONG observent une détérioration de l’image des jeunes véhiculée
par les médias
11
. L’exemple le plus frappant à ce sujet reste celui de la délinquance
juvénile
12
. Ce qui n’est pas sans conséquence.
5
Média Animation ASBL, Les jeunes, leur diversité et les médias, http://www.media-animation.be/Les-jeunes-
leur-diversite-et-les.html
6
Voyez l’analyse de la CODE, Internet et les jeunes. Le cas particulier de Facebook disponible sur
www.lacode.be
7
En raison des disparités de fréquentation des médias, nous noterons l’importance d’approcher la question des
représentations par différents médias.
8
Voyez à ce sujet, W. DOISE, A. PALMONARI (sld.), L’étude des représentations sociales, Lausanne, Delachaux et
Niestlé, 1986.
9
D. JODELET, Les représentations sociales, Paris, PUF, 1993.
10
Entendu au sens large, comme moyen de transmission d’informations.

3
Les psychologues sociaux
13
montrent que, bien souvent, les gens, et donc les médias entre
autres, exagèrent voire inventent la fréquence des relations qui existent entre deux
événements ; par exemple, le fait que tous les feux de la circulation soient rouges lorsque
l’on est pressé
14
ou encore, l’appartenance à tel groupe ethnique ou à telle catégorie d’âge
et le fait de commettre un comportement délictueux.
Cette tendance, qui est considérée comme une théorie naïve somme toute bien humaine,
est appelée « corrélation illusoire ».
Les théories naïves ont notamment pour conséquence que non seulement nous avons tous,
sans nous en rendre compte, une tendance naturelle à l’explication, mais surtout, nous
sommes généralement enclins à préférer les explications qui confirment nos croyances… Ce
qui, là aussi, n’est pas sans inconvénient. Ce phénomène participe en effet au renforcement
et à l’entretien de nos stéréotypes
15
, ces images toutes faites dans lesquelles nous
enfermons les groupes et leurs membres : « C’est parce que c’est une femme qu’elle conduit
mal », etc.
Ces théories fausses se construisent et se propagent à partir du milieu dans lequel nous
évoluons. Ainsi, les médias notamment participent activement à la création de ces théories
naïves. Celles-ci sont autant de vérités soi-disant observables qui, en retour, permettent de
justifier nos comportements et nos attitudes : « Comme les jeunes sont de plus en plus
violents, il faut nous en protéger. Nous n’avons d’autres choix que l’enfermement ».
Bien que naïves, ces théories sont tellement enracinées dans notre culture et nos esprits
qu’elles revêtent un statut quasi scientifique aux yeux de Monsieur et Madame Tout-le-
monde. Elles leur font dire « Il n’y a pas de fumée sans feu » ou encore, dans une certaine
mesure, « On peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres » (sous-entendant : « Ne nous
cachez pas la vérité, que l’on connaît trop bien… »).
En particulier, « les médias peuvent se révéler particulièrement dangereux dans la création
et le renforcement des stéréotypes. L’impression actuelle et généralisée que violence et
11
L’INCC (Institut National de Criminalistique et de Criminologie) met en avant que les statistiques ne
confirment pas ce point de vue (CODE, Rapport alternatif des ONG sur l’application de la Convention
internationale relative aux droits de l’enfant par la Belgique, Bruxelles, 2010, disponible sur www.lacode.be).
12
Voyez à ce sujet l’analyse CODE L’enfermement des mineurs délinquants : état des lieux, juin 2011, disponible
sur le site de la CODE : www.lacode.be
13
Sur le thème des représentations sociales, voyez notamment S. Ciccotti, 150 petites expériences de
psychologie (pour mieux comprendre nos semblables), Paris, Dunod, 2004, S. Fiske, Psychologie sociale,
Bruxelles, De Boeck, 2008 et C. Bonardi et N. Roussiau, Les représentations sociales, Dunod, les topos, 1999.
14
Ce principe se retrouve en partie dans la « Loi de Murphy » qui énonce que si quelque chose peut aller de
travers, le phénomène se produira.
15
Plus exactement, les stéréotypes sont des croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles
d’un groupe de personnes (voyez notamment S. Fiske, op. cit.). C’est la réputation dont les groupes font partie.

4
criminalité juvéniles sont à la hausse, ou même hors de contrôle, en est un bon exemple. (…)
Les stéréotypes négatifs n’affectent pas seulement la vision que les adultes ont de la
jeunesse, mais la manière dont les jeunes se perçoivent eux-mêmes. La conviction que le
reste du monde ne vous comprend pas et ne vous respecte pas n’encourage pas l’estime de
soi »
16
.
2. La présence des jeunes dans les médias traditionnels : le cas des
journaux télévisés belges francophones
Marie Vanoost, de l’Observatoire du récit médiatique (UCL), a réalisé une étude sur le Rôle
des médias sur les représentations collectives et spécifiquement sur la perception de la
jeunesse. L’exemple de la RTBF et de RTL
17
. Plus précisément, cette chercheuse a effectué
une observation durant le mois de novembre 2010
18
des journaux télévisés de ces deux
chaînes. Ils sont, en effet, les rendez-vous de l’information les plus suivis du public et donc
les plus susceptibles d’influencer les représentations collectives. Pour diverses raisons
méthodologiques, la catégorie d’âge a été celle des 12-25 ans
19
.
Reprenons maintenant quelques principaux résultats de cette étude.
En ce qui concerne les journaux télévisés que les jeunes regardent de manière générale,
ceux de RTL arrivent en tête et sont cités pour un peu plus d’un jeune sur deux. Cependant,
ceux de la RTBF les talonnent de très près. « Un peu moins de la moitié des jeunes qui citent
l’une de ces deux chaînes, excluent l’autre. En tout, les JT belges sont visionnés par les trois
quarts des jeunes interrogés
20
, sans que l’on puisse établir une différence notable entre ceux
qui pratiquent une langue étrangère et les autres. (…) L’audience des jeunes de Belgique
francophone envers les chaînes françaises est importante. Les jeunes semblent conscients
du fait qu’ils ne constituent pas forcément le public cible principal de ces émissions »
21
.
16
Réseau Educations-médias, www.education-medias.ca
17
M. VANOOST, op. cit.
18
Selon l’auteure, la durée d’un mois semble suffisante pour dégager des tendances d’un mois qui ne présente
pas d’actualité particulière impliquant des jeunes. Notons cependant que le 20 novembre est une date qui
touche directement les enfants puisqu’il s’agit du jour dédié aux droits de l’enfant vu l’anniversaire de la
Convention relative aux droits de l’enfant ce 20 novembre.
19
L’auteure précise au préalable qu’il est impossible de certifier avec exactitude l’âge des personnes qui
apparaissent ou sont cités dans les journaux télévisés. Il a donc fallu trouver des indices pour trouver ces jeunes
(12 à 25 ans dans cette étude). Cette étude ne se base que sur des personnes dont on a pu s’assurer de leur
âge grâce au fait que : leur âge est mentionné, les personnes qui jouissent d’une certaine célébrité dont la date
de naissance est connue, les jeunes identifiés comme élèves dans l’enseignement secondaire ou étudiants dans
l’enseignement supérieur (à l’exception des assistants en médecine et des doctorants dont l’âge dépasse
souvent les limites de la catégorie analysée), les personnes qui sont qualifiées de mineures quand l’image ou le
commentaire implique qu’ils ont plus de 12 ans et enfin les jeunes dont le physique montre que sans doute
possible, ils ont plus de 12 ans et moins de 25 ans.
20
Afin de réaliser cette enquête, un questionnaire a été soumis à plus de 400 élèves de l’enseignement
secondaire.
21
Média Animation ASBL, op. cit.

5
Concernant la représentation des jeunes dans les journaux télévisés (au cœur de la présente
analyse), on remarque que la tranche des 12-25 ans « apparaît, à première vue, légèrement
sous-représentée [par rapport à la population dans son ensemble] dans les journaux
télévisés belges francophones »
22
si l’on tient compte uniquement des situations dont on
peut quasiment être sûr de leur âge. Si l’on comptabilise les personnes qui ont l’air de faire
partie de la tranche 12-25 ans, cela relativise quelque peu la sous-représentation des jeunes
dans les journaux télévisés. En bref, au quotidien, les chaînes étudiées traitent
proportionnellement assez peu de la population des jeunes.
Plus précisément, les journaux télévisés font très peu intervenir les jeunes dans les matières
politique, économique et sociale. En ce qui concerne les sujets culturels, on remarque une
petite différence entre les deux chaînes; la RTBF mobilisant un peu plus les jeunes que RTL.
La plupart des sujets sportifs avec ou sur des jeunes mentionnent ou font intervenir des
jeunes sportifs belges. Pour les faits divers, on ne trouve de sujets avec ou sur des jeunes
appartenant à cette catégorie que sur RTL. La catégorie où l’on retrouve le plus de jeunes est
celle concernant les sujets de société et les affaires judiciaires et policières. Cette
importance peut s’expliquer par la grande place que ces catégories prennent dans
l’information plus largement.
De plus, il est intéressant de signaler que dans la plupart des cas, les jeunes sont directement
liés au sujet traité. Ils sont les principaux protagonistes du problème ou de la situation sans
lesquels le sujet n’existerait pas. Il est par contre peu courant de les voir apparaître comme
« simple » citoyen, dans le rôle de personnes « interchangeables », ou dans des sujets où
plusieurs individus sont impliqués, mais où le journaliste choisit de faire intervenir des
jeunes. C’est donc essentiellement l’actualité en tant que telle qui influence la présence des
jeunes dans les journaux télévisés, plus qu’une volonté de la part des chaînes télévisées
23
.
A ce sujet, il est intéressant de mentionner une étude de Média Animation qui aborde
notamment la question des centres d’intérêt des jeunes. « Globalement, les jeunes se
passionnent pour des sujets ‘jeunes’, essentiellement liés à l’univers du divertissement : la
musique, le sport, les nouveautés culturelles, etc. Ces thèmes et la communication avec les
amis sont les moteurs de leurs usages médiatiques. Aux côtés de la présence massive des
loisirs, les jeunes ne répugnent pas à s’intéresser à des sujets plus sérieux pour lesquels ils
s’ouvrent volontiers à l’interaction avec le monde adulte, sans doute perçu comme peuplé
d’experts potentiels (les parents et les enseignants) »
24
.
22
M. VANOOST, op. cit., p. 4.
23
Ibid., p. 6.
24
Média Animation ASBL, Les jeunes, leur diversité et les médias, décembre 2010, URL : http://www.media-
animation.be/Les-jeunes-leur-diversite-et-les.html,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%