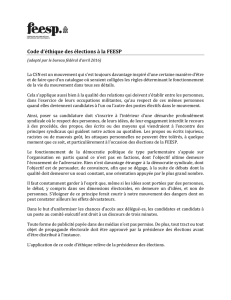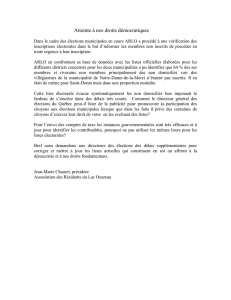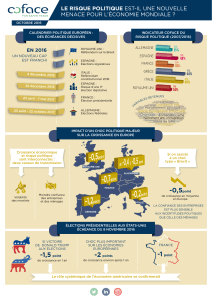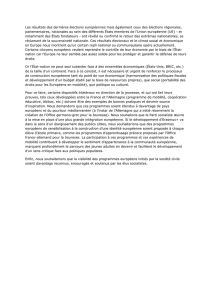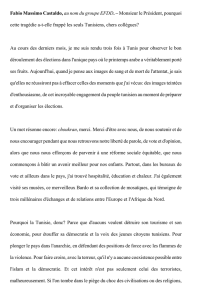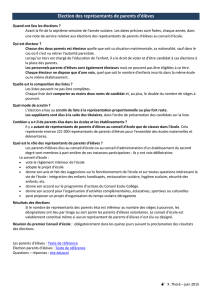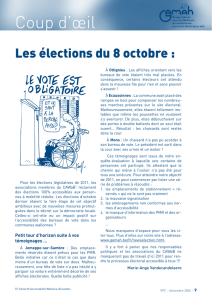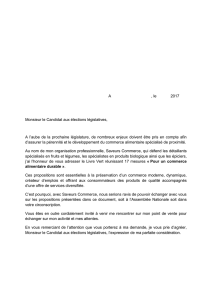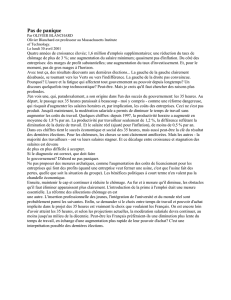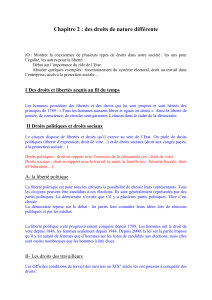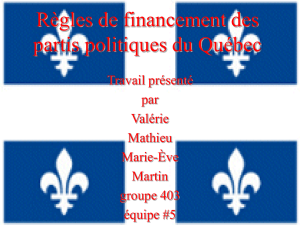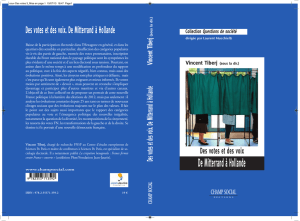télécharger l`appel à contributions

1
Appel à contributions pour le colloque : « Légitimité et élections en Afrique francophone »
Ce colloque, organisé par la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar, se déroulera les 16 et 17 mars 2017. Les collègues qui souhaitent y participer, en fonction de l’argumentaire
ci-dessous, sont priés d’adresser un résumé de leur projet, d’une dizaine de lignes, à Mamadou Badji, cabinet du
doyen, Faculté des sciences juridiques et politiques, Université Cheikh Anta Diop, BP 5005, Dakar Fann, Sénégal
Argumentaire
Les élections rythment de façon de plus en plus décisive la vie politique en Afrique. Les médias internationaux
ne s’y trompent pas. Longtemps, ils ont porté sur ces procédures de vote, qu’il s’agisse de désigner le chef de
l’Etat, les députés ou les responsables locaux, un regard plutôt dubitatif. Sans doute sous-estimaient-ils
l’importance de ces grandes manifestations à prétention démocratique, importance dont témoignaient, malgré tout
et même dans les années 1970 et 1980, la vivacité les campagnes destinées à convaincre les citoyens et le nombre
des candidats qui se mobilisaient pour briguer leurs suffrages. L’on n’aurait pas déployé tant d’efforts s’il n’y
avait eu aucun enjeu. D’un autre point de vue, il est vrai que les pressions compromettaient la sincérité de
l’expression des choix populaires, que certaines manœuvres lors des dépouillements rendaient peu crédibles les
résultats finalement affichés et qu’en toute hypothèse, la possibilité d’obtenir ainsi une alternance politique
paraissait tout à fait exclue.
Le médiocre respect des procédures destinées à garantir l’honnêteté des consultations électorales, la tendance
de tout groupe politique à chercher à se maintenir au pouvoir, le caractère autoritaire de certains régimes, ne
constituent pas les seules explications de ces faiblesses au regard des institutions démocratiques. Il faut aussi
constater, en Afrique comme dans le reste du monde, l’existence d’une période d’apprentissage durant laquelle
les populations doivent s’approprier ce droit qui leur est reconnu de désigner leurs dirigeants, de prendre
conscience des prérogatives qui leur sont accordées et d’en mesurer les exigences. Tous les peuples de la planète
sont passés par plusieurs étapes préparatoires avant de s’approprier ces procédures à la signification parfois
complexe. L’on ne saurait s’étonner qu’il ait dû en aller ainsi en Afrique également, comme une sorte
d’apprentissage de la démocratie. Au surplus l’héritage colonial et les élections organisées après la seconde guerre
mondiale, avec le système du double collège et les pressions exercées par une administration étrangère et une
armée d’occupation n’avaient certes pas constitué une bonne initiation à la démocratie.
La situation a bien changé. Avec la transition démocratique des années 1990, l’on est passé d’un système de
parti unique à un multipartisme parfois exagéré par la multiplicité des structures créées mais sur le caractère
opératoire duquel l’on peut s’interroger. La multiplicité des formations politiques n’éparpillent-elles pas
l’expression de la souveraineté populaire au lieu de l’encadrer et de faciliter son expression ? Là aussi, il faut sans
doute laisser du temps au temps. En tous cas, elles garantissent la pluralité des opinions, même si l’existence de
certains groupements font davantage figure de plateforme sur laquelle s’appuient les ambitions de leur leader que
de formation aux valeurs idéologiques bien et durablement affirmées. Contribuent également à la recherche d’une
plus grande sincérité des votes la proclamation de nombreuses libertés publiques qui s’expriment dans d’opulentes
déclarations qui ouvrent désormais toutes les Constitutions, avec une profusion de droits dont il n’est pas interdit
de se demander s’ils n’ont pas parfois un caractère programmatique qui en atténue la portée obligatoire et exigible.
En tous cas, la traditionnelle liberté de la presse tend à s’élargir aux nouveaux médias, généralement par la création
d’autorités collégiales chargées de vérifier l’égal accès de tous aux techniques modernes d’informations et de
communication.
Figurent également diverses prérogatives reconnues à l’opposition, y compris une vocation à bénéficier des
subventions de l’Etat, réparties entre les partis qui la composent en fonction de la représentativité de chacun. De
ce dernier point de vue, il convient de s’interroger sur la façon dont se traduisent dans la réalité, les promesses
prodiguées par la loi fondamentale et comment s’effectue la distribution de la manne publique, au profit de qui et
en fonction de quels critères. La véhémente et répétée affirmation de la liberté du vote est, dans les faits, garantie
par la multiplication des structures chargées de vérifier le bon déroulement des opérations électorales. Il s’agit
d’abord de comités, de commissions ou d’agences mises en place au niveau national : ils sont souvent le théâtre
de vives discussions entre les représentants des candidats, de fortes critiques de la part des autorités
gouvernementales, parfois de suppression brutale et de remplacement rapide qui convainquent qu’il ne s’agit pas
d’institutions de pure façade et que, même s’ils ne sont pas tous absolument irréprochables, leur intervention est
généralement effective et souvent utile.
S’y ajoute l’irruption d’observateurs électoraux plus ou moins sollicités, souvent d’origine étrangère, dont il
n’est pas interdit de se demander dans quelle mesure ils n’offensent pas la souveraineté nationale et le principe de
non intervention dans les affaires intérieures des Etats mais auxquels les grands médias mondiaux et les
organisations internationales accordent une forte crédibilité. Il faut enfin mentionner les initiatives de la société

2
civile qui témoignent de la volonté des citoyens de prendre en main leurs propres affaires. Pour autant qu’on leur
en donne les moyens, les ONG spécialisées sont capables, à l’occasion d’une élection importante, de déployer un
vaste dispositif, avec des observateurs dans tout le pays, un système d’alerte en temps réel des incidents survenus,
une autorité collégiale et indépendante chargée d’en apprécier la gravité et de se prononcer sur l’utilité ou non
d’alerter les grands médias. Ces ONG font école et ont su rédiger des vade mecum et des listes de bonnes pratiques
expliquant à leurs homologues les procédures à mettre en œuvre et les précautions à prendre en matière de
vérification de la bonne conduite des élections. Le fait que les comptes rendus émanant de toutes ces structures
fassent l’objet d’une large diffusion au lendemain de chaque scrutin et, avec des nuances subtiles dans la
distribution des compliments et des réserves, soient un peu traités comme l’indiscutable jugement de l’opinion
publique mondiale sur la légitimité de tel ou tel élu, pose problème par rapport à l’autorité des instances nationales
en charge de se prononcer sur ces questions. A noter que la pluralité de ces dernières et des instances chargées de
proclamer les résultats (Commission nationale, Cour constitutionnelle…) peut compromettre leur autorité et
parfois même déboucher sur des décisions contradictoires.
Le juriste ne peut évidemment se désintéresser de questions dont certains considèrent qu’elles relèvent du
détail ou de la pure technique mais qui ont leur importance concrète. Il en va ainsi des systèmes électoraux. Il
serait sans doute un peu vain de reprendre des controverses éculées et européano-centrées portant d’une part sur
le système majoritaire censé favoriser le bipartisme et proposer un choix clair aux électeurs, d’autre part sur la
proportionnelle considérée comme permettant une représentation plus fidèlement plurale de la diversité des
opinions de la population. Il sera en revanche intéressant de s’interroger sur l’adéquation de ces systèmes au
contexte africain, avec leurs multiples variantes dans les modes de calcul, par exemple sur la réponse que peut
fournir le vote majoritaire à la tendance des populations à personnaliser leurs choix, ou à l’inverse sur la solution
que peut apporter la proportionnelle à la tentation de privilégier des candidats et des programme localistes, en
proposant au contraire des listes nationales. De ce dernier point de vue, celui du danger des votes au service d’un
territoire et de ses intérêts étroitement entendus, les Constitutions sont péremptoires, interdisant les partis
régionalistes ou ethniques. L’on est tout à fait dans la tendance perceptible dès les premiers jours de
l’indépendance, au service de la construction de l’Etat nation, malgré les absurdités du découpage colonial qui
trancha arbitrairement pour rattacher une même ethnie à deux ou trois pays différents. Les Constitutions prohibent
également les partis religieux et l’on n’a aucune peine à comprendre les causes d’une telle interdiction, liée à
l’intégrisme musulman, mais difficile à appliquer dans la mesure où il faut respecter le principe de la liberté
religieuse et puisqu’une fois un parti contrôlé et autorisé, il est facile de faire émerger la promotion du Coran ou
de tout autre valeur religieuse présentés comme idéal suprême…
Les politologues doivent également se voir reconnaître une place de choix parmi les participants à ce colloque,
comme il se doit dans une Faculté des sciences juridiques et politiques et comme y incite un thème centré sur les
élections. Aucun des problèmes déjà évoqués, portant sur l’histoire compliquée des élections à l’époque coloniale,
aux lendemains des indépendances ou lors des dictatures prétoriennes, pas plus que les questions liées à la
transition démocratique des années 1990, mêlant multipartisme et affirmation de la liberté des votes, ne sauraient
échapper à la science politique. Il en va de même des procédures de vérification du bon déroulement des élections,
qu’elles soient nationales ou internationales, publiques ou privées. A côté de ces domaines en quelque sorte de
compétence partagée, il est évidement des recherches qui appartiennent de façon prioritaire, sinon exclusive, aux
politologues et d’abord concernant la conduite des élections, l’émergence des candidatures et leur signification,
le déroulement des campagnes électorales avec l’organisations de vastes débats et un patient travail de terrain,
avec des questions de financement rarement mises à jour, avec des mouvements de l’opinion que les sondages
tentent de suivre avec peine, avec un déroulement des votes marquées par des irrégularités symétriques, avec une
proclamation des résultats et des contestations dont le bien-fondé est difficile à vérifier.
Au-delà des événements parfois surprenants qui marquent les élections en Afrique subsaharienne et que la
presse rapporte sans trop de souci de la réalité, est surtout difficile de se faire une idée exacte de ces procédures
destinées à permettre l’expression de la volonté nationale. Les journalistes nationaux et étrangers s’emploient à
expliquer des résultats qu’ils n’ont pas toujours su prévoir. L’interprétation n’est pas aisée d’autant que l’on sait
bien qu’aux motivations idéologiques, aux solidarités ethniques aux calculs d’intérêt, aux jugements sur celui qui
paraît le mieux à même de conduire la nation s’ajoutent des procédures qui, dans certaines zones rurales, sont
davantage destinées à exprimer le consensus sous l’autorité des chefs traditionnels plus qu’à encourager la
diversité des points de vue. Il n’est pas toujours facile d’expliquer la victoire de l’un sur l’autre, bien davantage
de la prévoir. Du moins, lorsque les résultats sont acceptés, lorsque la défaite du candidat sortant ne fait pas l’objet
de contestation, ces alternances politiques réussies, comme le Sénégal en a connu plusieurs, constituent des
témoignages de l’installation d’une démocratie apaisée, ce dont il faut se réjouir.
A noter enfin que, dans la ligne des colloques précédents, celui-ci est naturellement ouvert à la
pluridisciplinarité : historiens, sociologues, philosophes y demeurent les bienvenus et ils disposent avec un sujet
comme celui des rapports compliqués entre les élections et la légitimité, d’un thème qui devrait les séduire. On ne
connaît, dans l’histoire, aucune base plus indiscutable du pouvoir politique que la volonté populaire. Reste à
déterminer, du point de vue des grands principes comme des réalités du terrain, les modalités les plus à même de

3
garantir non seulement la plus exacte mais également la meilleure formulation de cette volonté. Les citoyens se
prononcent en fonction des questions qui leur sont posées et il est mille façons d’orienter les réponses en fonction
de ce que l’on souhaite. Il serait naïf de prêter à la volonté nationale la capacité d’effectuer toujours et partout le
meilleur choix, le plus rationnel et le plus convaincant. Il n’est aucune discipline relevant des sciences humaines
et sociales qui ne soit fondée à disserter sur une énigme comme celle du lien entre élections et légitimité. Toutes
y seront accueillies.
Sous-thèmes :
1) Les détournements des procédures électorales à l’époque coloniale et sous les dictatures prétoriennes
2) Le retour au multipartisme et aux libertés d’opinion avec la transition démocratique
3) Le rôle des leaders d’opinions et des mouvements politiques dans les campagnes électorales
4) L’organisation des campagnes électorales et les réseaux de soutien des candidats
5) Les ambiguïtés de l’intervention des structures en charge de vérifier le bon déroulement des
opérations électorales
6) La proclamation des résultats, leur acceptation ou leur refus et l’alternance politique comme critère
de la démocratie
7) Les modes traditionnels de l’expression de la volonté populaire en Afrique
8) La répartition des votes comme reflet des diversités au sein de la population
9) Les fondements de la démocratie
1
/
3
100%