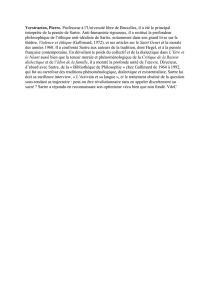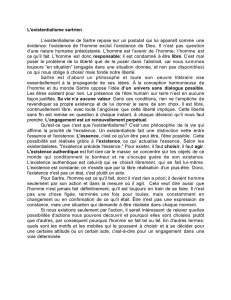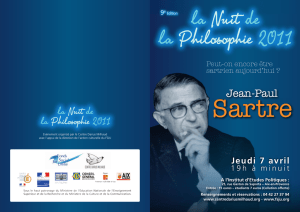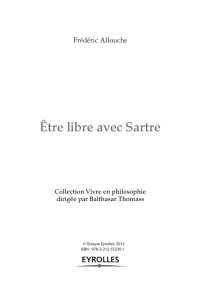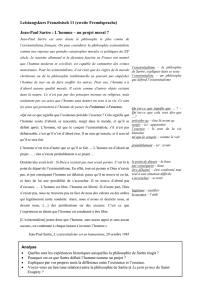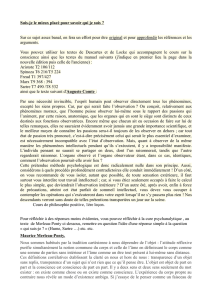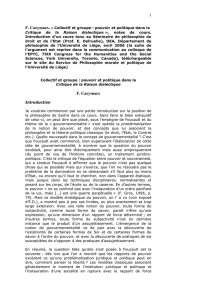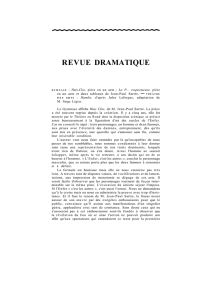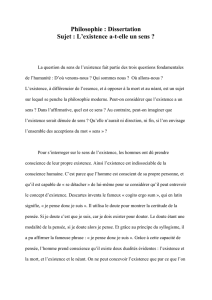Hommage à Jean-Paul Sartre

113
Hommage
(en Comminges)
à Jean-Paul Sartre
Georges Zachariou,
Paul Seff,
Alain Gerard,
Nicole Gauthey
Les animateurs du GREP-Midi-Pyrénées avaient proposé cet hommage à la Médiathèque de
Toulouse le 29 mai 2010 dans le cadre des « Lectures Croisées ». Cet hommage a été repris
à Saint-Gaudens le 20 novembre pour l’antenne GREP-Comminges. Trois des intervenants
ont présenté leur exposé toulousain :
Paul Seff :
Alain Gérard :
Nicole Gauthey :
(on peut retrouver l’intégralité des exposés et du débat dans les pages 269 à 340 de l’ouvrage
, édité en septembre 2010.)
Et Georges Zachariou a présenté un nouvel exposé :
On trouvera ici le texte de cet exposé, et la transcription du débat général qui a terminé cette
soirée.

114
Jean-Paul Sartre et l’amour
Sartre-Beauvoir : définition du couple
révolutionnaire
Georges Zachariou
Le 29 mai 2010 nous rendions hommage à J-P Sartre à la médiathèque de Toulouse. J’avais
assuré la partie biographie en plaçant « Sartre dans son siècle ». Aujourd’hui, devant le pu-
blic commingeois, j’aimerai aborder un Sartre plus intime, toujours en cohérence avec sa
philosophie : comme une manière d’être existentielle.
Sartre homme public
Si pour les lettres françaises la grande gure du XVIIIe siècle est Voltaire et celle du XIXe
Victor Hugo, Jean-Paul Sartre émerge probablement comme la personnalité littéraire et in-
tellectuelle la plus marquante du XXe siècle. Romancier, dramaturge, philosophe, auteur
d’essais et d’ouvrages critiques, militant politique engagé, Jean-Paul Sartre est un point par
rapport auquel on se situe.
Penseur de la liberté comme de son envers l’aliénation, de l’engagement et de la responsa-
bilité, il refuse l’idée d’une passivité originaire en l’homme qui déterminerait ses actions ; il
s’efforce de montrer comment l’homme en toute circonstance choisit son rapport au monde
au sein d’un libre projet : l’homme est sans excuse. Il est l’un des principaux initiateurs d’une
pensée philosophique : l’existentialisme. Il en a développé les fondements dans
(1943). L’Être est la projection de la conscience de l’homme car l’Être se manifeste à
travers le pour-soi de l’existence de l’homme, c’est-à-dire sa volonté. Le Néant, c’est l’en-
soi de l’essence des choses. Les choses sont enfermées dans leur essence, dans leur « en-
soi », alors que l’homme, par sa volonté, doit développer un « pour-soi » qui lui assure son
devenir. Sans volonté, l’homme tombe donc dans l’absurde de l’en-soi, « le sans raison »,
le non-sens.
Modèle de l’écrivain engagé, Sartre est le philosophe du choix, celui que doit faire
l’homme face à ses responsabilités, affirmant ainsi sa liberté. Sartre n’était pas un de ces
penseurs retranchés dans sa tour d’ivoire, c’était un « guetteur éveillé » avide de liberté et
de justice.
Il s’engage, prend position sur les événements politiques les plus contemporains,
quitte à embrasser les errances d’un monde en pleine évolution. Ainsi prétendre que Sartre
aurait eu tort contre Aron est sans doute vain, la contingence de l’histoire impose que l’on
regarde une pensée dans son temps. Oui, Aron avait raison, il défendait le libéralisme éco-
nomique qui finit par triompher (nous évitant probablement les errances du collectivisme).
Mais oh combien Sartre avait raison de le combattre courageusement (sans avoir jamais
adhéré au PCF), quant on voit l’état de notre société actuelle devenue néo-libérale avec
son cortège d’injustice, de misère et d’immoralité… Cela vaut également pour les contro-
verses Camus-Sartre qui s’affrontèrent durant le contexte de la guerre d’Algérie (1), etc. En
replaçant Sartre dans les combats politiques de son temps, en le « contextualisant »

115
nous pouvons alors comprendre que cet universitaire, intellectuel bourgeois d’éducation
occidentale engagé du côté de l’Est déclenche le moment clé des évolutions modernes, tant
politiques que culturelles. Avec Simone de Beauvoir, son influence sur nos modes de vie
intime (amour, couple…) fut également considérable. Devant l’abondance de ces visions
contradictoires, l’interrogation demeure : qui était Sartre ? Quelle enfance, quelle vie amou-
reuse a-t-il menée ?
Sartre intime
Son enfance et sa jeunesse
J-P Sartre a été éduqué en privé par son grand-père, grand bourgeois alsacien de la famille
des Schweitzer. Il n’intégrera l’école publique qu’à l’age de 10 ans. Il est considéré comme
étant laid, maladroit, s’habillant et s’amusant d’une manière différente des autres enfants de
son âge. La prise de conscience de sa laideur et de sa différence lui est douloureuse, le jeune
Sartre se réfugie alors dans les jeux imaginaires. En intégrant le lycée Henry IV il noue une
forte amitié avec Paul Nizan. Cependant, et sans doute pour compenser ses particularités,
il se révèle être d’une grande drôlerie, un bon vivant jusqu’à l’excès. Il mène joyeuse sco-
larité ; ainsi pour ses qualités de boute-en-train ses copains lui décernent le titre de « SO »
c’est-à-dire de satyre ofciel, il excelle dans la facétie et la blague. Au lycée Louis le Grand,
toujours avec Nizan, il reprend son rôle d’amuseur, jouant blagues et petites scènes entre les
cours où éclatent son ironie et son dégoût pour les vies conventionnelles. Reçus tous les deux
(17-18 ans) à l’École Normale Supérieure, ils restent de redoutables chahuteurs. Un peu plus
tard une de ses pièces antimilitaristes fait scandale et provoque la démission du directeur de
l’ENS. Sa notoriété s’afrme (il est ovationné à chacune de ses entrées au réfectoire) et se
forge une forte personnalité. Il marque déjà un goût prononcé pour la provocation et le com-
bat contre l’autorité morale établie. Il a cependant une capacité de travail inouïe. Il écrit déjà
des nouvelles et romans, il lit énormément, il écrit des chansons, des poèmes, s’intéresse au
cinéma etc. tout en réussissant ses concours.
Il échouera cependant à l’agrégation de philosophie (« ma copie était trop originale » aurait-
il déclaré, blessé dans son orgueil) pour être reçu premier l’année suivante en compagnie
de Simone de Beauvoir reçue deuxième. Il noue de nombreuses amitiés : Raymond Aron,
Merleau-Ponty, et bien sûr la belle et séduisante Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir
Elle est née le 9 janvier 1908 à Paris. Philosophe, romancière, épistolière, essayiste, son
œuvre et son inuence sont immenses. Sa philosophie, bien que très proche, ne saurait être
confondue avec celle de Sartre, elle se différencie de son compagnon dans la mesure où elle
aborde le caractère concret des problèmes, préférant une réexion directe ininterrompue
sur le vécu. Très engagée politiquement, elle voyage énormément et c’est avec des considé-
rations toujours proches de l’existentialisme qu’elle deviendra la plus grande théoricienne
du féminisme moderne. Elle participera au mouvement de libération des femmes dans les
années 70. Dans le «
» paru en 1949 elle afrme : « on ne naît pas femme
on le devient », c’est la construction des individualités qui impose des rôles différents aux
personnes des deux sexes. Le genre, cet essai de retentissement mondial scandalise la haute
société mais sera soutenu par C. Lévy-Strauss et deviendra le socle du mouvement féministe
moderne. En 1954, son roman
remporte le prix Goncourt. En 1958 paraît
suivi de
À travers cette fresque autobiographique, elle propose un exemple d’émancipation féminine

116
et poursuit son étude sur le comportement et la responsabilité des hommes au sein de la
société. Surnommée le Castor (beaver en anglais), elle rencontre Sartre à l’E N S. En 1980,
Jean-Paul Sartre décède. Simone de Beauvoir est particulièrement affectée par cette perte,
qu’elle considère avec fatalisme. Elle s’éteint le 14 avril 1986 à l’âge de 78 ans et reposera
au cimetière Montparnasse à Paris aux côtés de son compagnon.
L’existentialisme de Saint Germain des Prés
Intellectuel et gure de proue d’une génération avide d’action et de jouissance, la vie de
Sartre est autant rythmée par les soirées existentielles animées de Saint Germain des Prés
et la valse rieuse des amours contingentes que par les discussions politiques et les débats
philosophiques enammés.
Au début des années 60, je fréquentais avec quelques copains les hauts lieux de la rive
gauche parisienne : le café Flore, les Deux Magots, le Tabou… Le jazz, les chansons à
texte, Juliette Gréco, Anne-Marie Cazalis, Léo Ferré… et surtout la proximité de «
» nous enchantaient. Nous étions toujours surpris et admiratifs : « le
vieux » buvait et fumait sec, il ne prenait pas soin de sa santé, de ce corps qu’il méprisait,
et puis il était toujours accompagné de jolies femmes. Certes nous reconnaissions son esprit
supérieur mais que diable il n’avait rien d’un Adonis ! On peut s’interroger comme le fait
Géraldi Leroy sur les raisons qui lui ont assuré de si constants et si atteurs succès et ce
pratiquement jusqu’à la n de sa vie.
Notre jeunesse se déclarait existentialiste. Sartre en était très affecté et regrettait que sa phi-
losophie fût détournée de son sens et présentée comme un phénomène de mode scandaleuse.
Sartre et Beauvoir : le Pacte
En 1929, ils étaient jeunes, 21 et 23 ans, surdiplômés, surdoués, tous deux de famille et
d’éducation bourgeoise, sûrs d’eux-mêmes, aveuglés par leur désir d’accomplir leur œuvre
d’écrivain. Ils s’aiment, leur relation est sexuelle, personnelle, sentimentale, intellectuelle,
ils ne peuvent se séparer. Assis tous deux sur un banc du jardin du Louvre, Sartre propose le
fameux « pacte » renouvelable tous les deux ans, qui devait dénir leur relation future. Cette
relation repose sur la distinction entre « amour nécessaire » et « amours contingentes », elle
devait concilier chez les deux partenaires la double exigence de la délité et de la liberté.
Sartre propose : « il convient que nous vivions à côté de notre amour nécessaire des amours
contingentes ». Les amours contingentes sont une façon de connaître le monde. Elles peu-
vent être de vraies passions, y compris sexuelles, mais ne doivent jamais effacer l’amour
nécessaire, fait d’estime, de tendresse et de conance réciproques absolues. Pour éviter les
souffrances de la jalousie, ils se raconteront tout. Exempte de secrets, leur relation se basera
sur une transparence totale. Ils ne se conformeront pas à la vie maritale et ne vivront pas sous
le même toit, pour eux cette cohabitation serait indigne de leur statut d’aristocrate intellec-
tuel. Par ce pacte ils rejettent l’institution en bloc, et avec elle la morale bourgeoise dont ils
sont issus. La belle S. de Beauvoir accepte, l’intelligence de Sartre, le premier homme de sa
vie, la fascine. Ils proclament « Nous allons réinventer le couple ». Michel Contat (2) a dit un
jour : « La légende Sartre- de Beauvoir a changé nos mœurs ». C’est exact, ajoute Michel-
Antoine Burnier : « J-P Sartre et S. de Beauvoir ont été les Héloïse et Abélard laïcs des temps
modernes, même si leur vrai vie n’a que partiellement correspondu à leur légende »

117
Pour ce qui suit je m’inspire largement d’un entretien accordé par Michel-Antoine Burnier
à la revue «
». Les amours contingentes se sont parfois croisées, Beauvoir a eu une
liaison avec Fernando Gerassi, le peintre espagnol, tandis que Sartre sortait avec la femme
de Gerassi.
Plus déterminante a été l’histoire du Castor avec Jacques-Laurent Bost, un ancien élève de
Sartre : un vrai amour profond, physique. Cette relation est restée clandestine, parce que Bost
avait engagé avec Olga Kosackiewicz des liens qu’il ne voulait pas rompre. Olga avait elle-
même partagé simultanément la vie de Sartre et de Beauvoir. Sartre laminé par la capricieuse
Olga se console dans les bras de sa sœur Wanda (lire
de S. de Beauvoir). Il y a aussi
la période où Beauvoir est professeur, certaines de ses élèves tombent amoureuses d’elle et
réciproquement. Dans ses mémoires, elle cachera tout de ses amours lesbiens, notamment
quand ses amantes deviennent les maîtresses de Sartre. Il y aura aussi la jeune Bianca Lam-
blin (3), cousine de G. Perec. En 1945, quand Sartre va aux USA, il est à deux doigts d’épou-
ser Dolorès Vanetti et de rompre le « pacte », mais Dolores voulait l’exclusivité. Sartre la
lui refuse. Tout cela n’allait pas sans souffrance, ainsi l’amour que va bientôt vivre Simone
de Beauvoir avec son bel américain Nelson Algren sera dément, jusqu’au simulacre de ma-
riage. Ils entretiendront une correspondance passionnée de plus de dix-neuf ans. Dans les
années 50 elle aura avec Claude Lanzmann une histoire sentimentale très physique, plus
tard elle écrira « Je ne l’avais plus vu depuis x temps, nos corps se retrouvèrent dans la
joie ». En même temps la sœur de Claude Lanzmann, Evelyne Rey, d’une beauté stupéante
(comédienne dans Huis clos) couchait avec Sartre. Amours miroir en symétrie, avec une n
dramatique (je vous invite à lire
de Lanzmann). En fait les rapports
physiques entre Sartre et Beauvoir se sont arrêtés depuis la n des années trente, ça ne collait
pas vraiment entre eux. Même s’il est très physique, c’est un mauvais coïteur. Un homme
aux érections terribles, mais qui n’éjacule que très difcilement et sans grand plaisir. Lui-
même se présentera comme plutôt « un masturbateur de femmes qu’un coïteur ». Il veut bien
admettre que la femme s’abandonne, mais lui jamais. Il se retient toujours. Pas question de
perdre conscience : il est pure conscience et la conscience ne doit pas s’obscurcir. Sartre à
la belle époque, a eu jusqu’à sept maîtresses simultanées. C’est la donnée principale, il en a
vitalement besoin. Il est méticuleusement organisé, il s’assigne 8 heures d’écriture par jour.
Il est très généreux en général (je l’ai vu laisser des pourboires hors de toutes proportion pour
les garçons de café). Il est considéré comme un véritable ambassadeur intellectuel et même
politique, il effectue 9 voyages en URSS, il y rencontrera des maîtresses passionnées, il aura
des ennuis avec le KGB… Beauvoir complice l’aidera à s’en sortir.
Je m’arrête là, la liste est encore longue et il ne faudrait pas verser dans un certain voyeu-
risme. Ne l’oublions pas tout cela se passait pour l’essentiel avant 1968.
Ils sont partiellement prisonniers d’une logique qui n’est pas sans perversité voire sadisme,
surtout à l’encontre de S. de Beauvoir, sa compagne nécessaire : à la moindre réexion l’in-
sulte suprême aurait fusé : « vous n’êtes donc qu’une bourgeoise ? ». Non seulement cet
homme était un papillonneur indèle et un séducteur total, qui draguait tout ce qu’il voyait,
mais en plus il fondait ça philosophiquement. Leur correspondance pourtant expurgée par
Beauvoir est révélatrice. Elle revendique sa place de privilégiée auprès de Sartre et pose la
question : « Comment le tiers s’accommode-t-il de notre arrangement ? » Son amant Nelson
Algren, furieux du déballage de sa propre histoire (dans la
) déclarera :
« les proxénètes sont plus honnêtes que les philosophes ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%