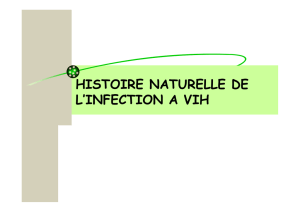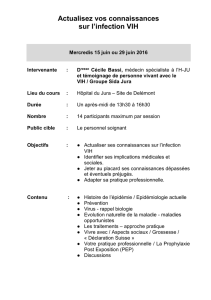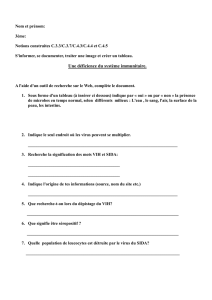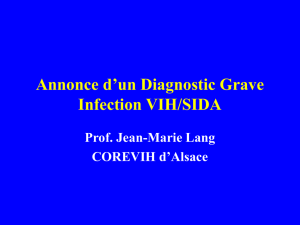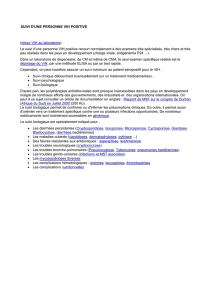La poursuite des droits: Études de cas sur le traitement

COLLECTION MEILLEURES PRATIQUES DE L‘ONUSIDA
La poursuite des droits :
Études de cas sur le traitement judiciaire
des droits fondamentaux des personnes vivant
avec le VIH

Photo de couverture : Réseau juridique canadien/réalisé par Luke Nicholson et Mélanie Paul-Hus
Étude publiée conjointement par le Réseau juridique canadien VIH/SIDA
et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA)
Version originale anglaise, UNAIDS/06.01E, mars 2006 :
Courting Rights: Case Studies in Litigating the Human Rights of People Living with HIV
Traduction – ONUSIDA
de la part de l’ONUSIDA aucune prise de position
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou
zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs
frontières ou limites.
La mention de firmes et de produits commerciaux
n’implique pas que ces fi rmes et produits commerciaux
sont agréés ou recommandés par l’ONUSIDA, de
préférence à d’autres. Sauf erreur ou omission, une
majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom déposé.
L’ONUSIDA ne garantit pas que l’information contenue
dans la présente publication est complète et correcte et
ne pourra être tenu pour responsable des dommages
éventuels résultant de son utilisation.
ONUSIDA – 20 avenue Appia – 1211 Genève 27 – Suisse
Téléphone : (+41) 22 791 36 66 – Fax : (+41) 22 791 41 87
Courrier électronique : [email protected]g – Internet : http://www.unaids.org
© Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/SIDA (ONUSIDA) 2006.
Tous droits de reproduction réservés. Les publications
produites par l’ONUSIDA peuvent être obtenues auprès
du Centre d’information de l’ONUSIDA. Les demandes
d’autorisation de reproduction ou de traduction des
publications de l’ONUSIDA – qu’elles concernent la
vente ou une distribution non commerciale – doivent
être adressées au Centre d’Information à l’adresse
ci-dessous ou par fax, au numéro +41 22 791 4187 ou par
courriel : [email protected].
Les appellations employées dans cette publication et
la présentation des données qui y fi gurent n’impliquent
ONUSIDA/06.01F (version française, septembre 2006)
Catalogage à la source: Bibliothèque de l’OMS:
La poursuite des droits : études de cas sur le traitement judiciaire des droits fondamentaux des
personnes vivant avec le VIH.
(ONUSIDA collection meilleures pratiques)
« Étude publiée conjointement par le Réseau juridique canadien VIH/SIDA et le
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA). »
« ONUSIDA/06.01F ».
1.SIDA – législation. 2.Infection à VIH – législation. 3.Droits homme – législation. 4.Health
services accessibility – législation. 5.Étude de cas. I.ONUSIDA. II.Organisation mondiale de
la Santé. III.Réseau juridique canadien VIH/SIDA. IV.Série.
ISBN 92 9 173489 6 (Classifi cation NLM : WC 503.7)

La poursuite des droits :
Études de cas sur le traitement
judiciaire des droits fondamentaux
des personnes vivant avec le VIH
COLLECTION MEILLEURES PRATIQUES DE L‘ONUSIDA

Remerciements
Cette étude a été réalisée et rédigée par Richard Elliott, Joanne Csete, Richard Pearshouse et Glenn
Betteridge du Réseau juridique canadien VIH/SIDA, avec l’aide éditoriale de Susan Timberlake,
conseiller de l’ONUSIDA pour les droits de la personne. Richard Elliott a revu l’ensemble du
document. Parfois, certains résumés ou commentaires de certaines études sont des adaptations
d’éléments déjà publiés par le Réseau juridique ; les sources originales sont alors citées. Les auteurs
tiennent à remercier leurs collègues dans plusieurs pays qui leur ont communiqué des éclairages ou
documentations complémentaires sur des arrêts et décisions d’un certain nombre d’instances. Des
remerciements particuliers sont également adressés à Ian Malkin, German Rincon Perfetti, Debbie
Mankovitz, Michaela Clayton, Karyn Kaplan, David Szablowski, Liesl Gerntholtz et Katie Gibson
pour leur contribution aux recherches.
Le fi nancement de ce projet a été fourni par l’ONUSIDA.
Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs et ne traduisent pas nécessairement
les positions ou politiques de l’ONUSIDA.
Remarque : Sauf indication contraire, toutes les traductions de textes originaux rédigés dans des
langues autres que l’anglais sont celles des auteurs et ne doivent donc pas être considérées comme
des traductions offi cielles.

Table des matières
I. Discrimination liée au VIH 9
Canada (Procureur général) c. Thwaites, [1994] 3 CF 38 (Cour fédérale
du Canada – Section de première instance, 1994) 10
XX v. Gun Club Corporation et al., Cour constitutionnelle, jugement
nº SU-256/96 (1996) 13
M.X. c. Z.Y., AIR 1997 Bom 406 (Haute cour de justice, 1997) 18
M. X c. Hôpital Z, (1998) 8 SCC 296, modifi é 2002 SCCL.COM 701 (appel
civil No. 4641 de 1998), Cour suprême de l’Inde (1998 & 2002) 21
A, C & autres c. Union indienne & autres, Haute cour de Bombay [Mumbai],
Demande d’assignation No. 1322 de 1999 21
JRB et al. c. Ministère de la Défense, affaire No. 14000, Cour suprême
de justice du Venezuela (division politique et administrative) (1998) 27
Haindongo Nghidipohamba Nanditume c. Ministère de la Défense,
affaire No. LC 24/98, Labour Court (tribunal du travail) de Namibie (2000) 31
Hoffmann c. South African Airways, Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud,
Affaire CCT 17/00 (2000) ; 2001 (1) SA 1 (CC) ; 2000 (11) BCLR 1235 (CC) 35
XX c. Ministère de la Défense nationale (Académie militaire Général José
María Córdova), affaire No. T-707205, troisième chambre d’appel de la Cour
constitutionnelle (2003) 39
Karen Perreira c. école Buccleuch Montessori Pre-School and Primary (Pty) Ltd
et al., Haute cour d’Afrique du Sud, affaire No. 4377/02 (2003) 42
Diau c. Botswana Building Society (BBS), affaire No IC 50/2003, Industrial Court
(tribunal des affaires de l’industrie) du Botswana (2003) 45
II. Accès aux traitements liés au VIH 49
Alonso Muñoz Ceballos c. Instituto de Seguros Sociales, Cour constitutionnelle
de Colombie, jugement No. T-484-92 (1992) 50
Luis Guillermo Murillo Rodríguez et al. c. Caja Costarricense de Seguro Social,
Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, décision No. 6096-97
(1997) 54
William García Alvarez c. Caja Costarricense de Seguro Social, Chambre
constitutionnelle de la Cour suprême de justice, décision No. 5934-97 (1997) 54
D c. Royaume-Uni, Cour européenne des droits de l’homme, affaire No.
146/1996/767/964 (1997) 58
Cruz del Valle Bermudez et al. c. Ministère de la Santé et de l’action sociale
(Ministerio de Sanidad y Asistencia Social), Cour Suprême du Venezuela (chambre
politique et administrative), décision No. 916, Court File No. 15.789 (1999) 64
Jorge Odir Miranda Cortez et al. c. Salvador, Commission interaméricaine
des droits de l’homme, compte-rendu No. 29/01, affaire 12.249 (2001) 69
Pharmaceutical Manufacturers’ Association et 41 autres c. Président de l’Afrique
du Sud et 9 autres, Haute cour d’Afrique du Sud, division de la province du
Transvaal, affaire No. 4183/98 (2001) 72
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
1
/
136
100%