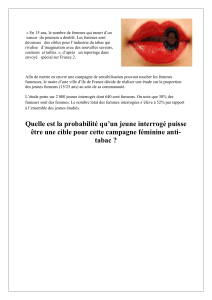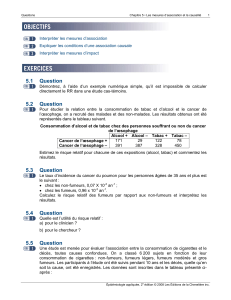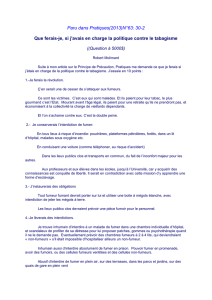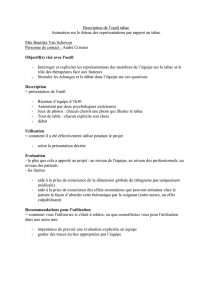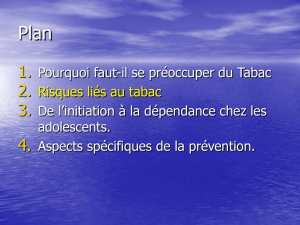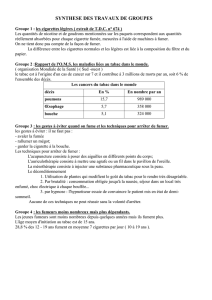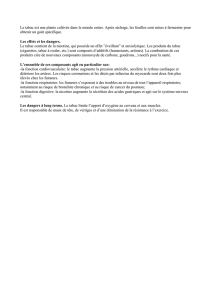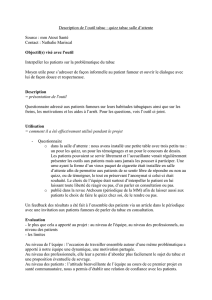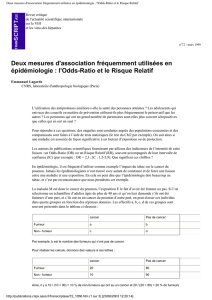5.1 Question Réponse

Questions et réponses Chapitre 5 • Les mesures d’association et la causalité 1
Épidémiologie appliquée, 2e édition © 2008 Les Éditions de la Chenelière inc.
Interpréter les mesures d’association
Expliquer les conditions d’une association causale
Interpréter les mesures d’impact
5.1 Question
Démontrez, à l’aide d’un exemple numérique simple, qu’il est impossible de calculer
directement le RR dans une étude cas-témoins.
Réponse
Un exemple de réponse pourrait être le cas suivant : le risque étudié est celui du
mésothéliome pleural, une tumeur de la plèvre liée à l’exposition à l’amiante. On mène une
étude de cohortes rétrospective dans une usine de transformation de l’amiante et deux
études cas-témoins (A et B) dans des milieux semblables. Les résultats figurent dans les
trois tableaux suivants, où E + signifie « exposé à l’amiante » ; E -, « non exposé » ; M +,
« mésothéliome » ; et M -, « absence de mésothéliome ».
Étude de cohortes rétrospective : risque de mésothéliome
pleural lié à l’exposition à l’amiante
E + E – Total
M + 9110
M – 491 499 990
Total 500 500 1000
RR = 9.
Étude cas-témoins A : risque de mésothéliome
pleural lié à l’exposition à l’amiante
E + E – Total
M + 98 2 100
M – 84 16 100
Total 182 18 200
RR = 4,8.
RC = 9,3.
Étude cas-témoins B : risque de mésothéliome
pleural lié à l’exposition à l’amiante
E + E – Total
M + 98 2 100
M – 336 64 400
Total 434 66 500
RR = 7,5.
RC = 9,3.
On remarque aisément que le rapport de cotes calculé dans les études cas-témoins
estime assez correctement le RR trouvé dans l’étude de cohortes parce que la prévalence
de cette maladie est relativement faible pour les exposés et pour les non-exposés.
Par contre, si l’on veut calculer un RR dans les études cas-témoins, le résultat est
fantaisiste et dépend des choix effectués par le chercheur quant au nombre de cas et de

Questions et réponses Chapitre 5 • Les mesures d’association et la causalité 2
Épidémiologie appliquée, 2e édition © 2008 Les Éditions de la Chenelière inc.
témoins à inclure dans son étude. Dans cet exemple, la seule différence entre les deux
études cas-témoins est que la seconde étude compte quatre fois plus de témoins que la
première. Le RC ne change pas, alors que le RR augmente de 60 %.
5.2 Question
Pour étudier la relation entre la consommation de tabac et d’alcool et le cancer de
l’œsophage, on a recruté des malades et des non-malades. Les résultats obtenus ont été
représentés dans le tableau suivant.
Consommation d’alcool et de tabac chez des personnes souffrant ou non du cancer
de l’œsophage
Alcool + Alcool – Tabac + Tabac –
Cancer de l’œsophage + 171 29 122 78
Cancer de l’œsophage – 391 387 328 450
Estimez le risque relatif pour chacune de ces expositions (alcool, tabac) et commentez les
résultats.
Réponse
Nous sommes ici dans le contexte d’une étude cas-témoins. Le risque relatif doit être
estimé au moyen du rapport de cotes. Pour l’alcool, le RC est de 5,84 ; pour le tabac, il est
de 2,15. Le risque d’être atteint d’un cancer de l’œsophage pour une personne qui
consomme de l’alcool est 5,84 fois plus élevé que pour une personne qui n’en consomme
pas. Le risque d’être atteint d’un cancer de l’œsophage pour un fumeur est 2,15 fois plus
élevé que pour une personne qui ne fume pas.
5.3 Question
Le taux d’incidence du cancer du poumon pour les personnes âgées de 35 ans et plus est
le suivant :
• chez les non-fumeurs, 0,07 X 10-3 an-1 ;
• chez les fumeurs, 0,96 x 10-3 an-1.
Calculez le risque relatif des fumeurs par rapport aux non-fumeurs et interprétez les
résultats.
Réponse
Le RR = 0,96/0,07, soit 13,7. Les fumeurs de 35 ans et plus présentent un risque 13,7 fois
plus élevé d’être atteint d'un cancer du poumon que les non-fumeurs.
5.4 Question
Quelle est l’utilité du risque relatif :
a) pour le clinicien ?
b) pour le chercheur ?
Réponse
a) Le risque relatif indique au clinicien l’accroissement du risque que court un patient qui
est exposé à un certain facteur comparativement à celui que court un patient qui n’est
pas exposé à ce facteur.
b) Pour le chercheur, le risque relatif mesure la force d’une association et peut suggérer
un lien causal.

Questions et réponses Chapitre 5 • Les mesures d’association et la causalité 3
Épidémiologie appliquée, 2e édition © 2008 Les Éditions de la Chenelière inc.
5.5 Question
Une étude est menée pour évaluer l’association entre la consommation de cigarettes et le
décès, toutes causes confondues. On a classé 6 200 sujets en fonction de leur
consommation de cigarettes : non-fumeurs, fumeurs légers, fumeurs modérés et gros
fumeurs. Les participants à l’étude ont été suivis pendant 10 ans et les décès, quelle qu’en
soit la cause, ont été enregistrés. Les données sont inscrites dans le tableau présenté ci-
après :
Décès toutes causes confondues en fonction de la consommation de cigarettes
Consommation
de cigarettes Condition à la fin de l’étude
Mort Vivant Total
Aucune 350 3 000 3 350
Légère 400 1 600 2 000
Modérée 200 350 550
Forte 150 150 300
Total 1 100 5 100 6 200
a) De quel type d’étude s’agit-il ?
b) Estimez le risque de décès toutes causes confondues pour les gros fumeurs dans cette
population.
c) Calculez le risque relatif de décès pour un gros fumeur comparativement à un fumeur
léger. Interprétez. Le RR vous fournit-il des indications quant au risque de décès
présenté par les gros fumeurs ?
d) Calculez le risque relatif de décès pour un gros fumeur comparativement à un non-
fumeur. Interprétez.
e) Calculez le risque relatif de décès pour un fumeur modéré comparativement à un
fumeur léger. Interprétez.
f) Calculez le risque attribuable (RA) entre un gros fumeur et un non-fumeur. Interprétez.
Réponse
a) Il s’agit d’une étude à visée étiologique de cohortes non expérimentale. Les sujets sont
répartis en quatre cohortes sur la base de l’exposition et ils sont suivis dans le temps.
b) Il s’agit de l’incidence cumulée de décès chez les gros fumeurs pendant la période de
10 ans, soit 150/300 = 0,5.
c) Le risque pour les fumeurs légers est de 400/2000, soit 0,2. Le RR est donc de 0,5/0,2,
soit 2,5. Le RR seul ne fournit aucune indication sur le risque encouru par l’un ou l’autre
groupe. Il indique seulement que le risque de décès est 2,5 fois plus élevé pour les gros
fumeurs que pour les fumeurs légers sur une période de 10 ans.
d) Le risque pour les non-fumeurs est de 350/3350, soit 0,104. Le RR est de 0,5/0,104,
soit 4,8. Le risque de décès est 4,8 fois plus élevé pour un gros fumeur que pour un
non-fumeur sur une période de 10 ans.
e) Le risque pour les fumeurs modérés est de 200/550, soit 0,364. Le RR est de 0,364/0,2,
soit 1,8. Le risque de décès est 1,8 fois plus élevé pour les fumeurs modérés que pour
les fumeurs légers sur une période de 10 ans.
f) Le RA = 150/300 - 350/3350, soit 0,4. Sur une période de 10 ans, 40 % des décès chez
les gros fumeurs sont probablement dus à la cigarette.

Questions et réponses Chapitre 5 • Les mesures d’association et la causalité 4
Épidémiologie appliquée, 2e édition © 2008 Les Éditions de la Chenelière inc.
5.6 Question
Dans votre région, une usine produit un plastique spécial très recherché. Elle emploie, bon
an mal an, environ 300 ouvriers. Depuis votre installation dans la région il y a un an, vous
avez dû adresser à un spécialiste deux travailleurs qui présentaient une tumeur osseuse.
Dans un cours sur l’appareil locomoteur, à la faculté, vous aviez appris qu’il s’agissait là
d’une maladie rare au Québec.
Intrigué, vous communiquez avec la direction de l’épidémiologie du ministère de la Santé.
On vous confirme qu’il s’agit effectivement d’une maladie rare, dont l’incidence est stable
depuis de nombreuses années. Elle est de l’ordre de 25 x 10-7 an-1 dans la population
active.
Vous obtenez de la direction de l’usine la permission de fouiller les dossiers médicaux de
ses employés. Vous constatez que 12 travailleurs ont dû quitter leur poste à cause d’un
cancer des os depuis 10 ans.
a) Vous ne savez pas encore s’il s’agit de la maladie que vous avez décelée, mais en
supposant que ce soit le cas, quelle mesure d’association entre le fait de travailler dans
cette usine et l’apparition de cette maladie peut être calculée ?
b) Effectuez le calcul et énoncez les postulats que vous devez poser pour que votre
mesure soit valide.
c) Quelle conduite adoptez-vous à la suite de votre découverte ?
Réponse
a) Tous les éléments nécessaires au calcul du risque relatif à la population (RRP, ou SMR
dans la littérature courante) sont présents.
b) Si l’on suppose (ce sont là nos postulats) que l’incidence dans la population active est
stable depuis 10 ans et que la population des travailleurs est également stable, le calcul
des cas attendus (A) sera le suivant :
0,0000025 an-1 X 10 ans x 300 ouvriers,
soit 0,0075 ouvriers.
Le RRP sera : 12 ouvriers/0,0075 ouvriers, soit 1 600.
c) Les ouvriers de cette usine auraient donc 1 600 fois plus de chances d’être atteints de
cette maladie que le reste de la population active du Québec. Cette découverte est
certainement assez importante pour que nous alertions la Régie régionale de la santé,
qui mènera sans doute, en premier lieu, une première étude plus approfondie pour
confirmer ce fait, et, en second lieu, une autre étude pour en trouver la cause. Elle
mettra finalement en place les mesures nécessaires pour corriger la situation.
5.7 Question
Dans le cadre d’une étude cas-témoins sur le lien entre les problèmes de développement
de l’embryon et l’exposition prénatale aux radiations, on a examiné les dossiers
hospitaliers de 2 000 enfants pour qui un diagnostic de troubles du développement a été
posé, et ceux de 8 000 autres enfants témoins. Pour l’ensemble des enfants, on a
interrogé les mères pour savoir si elles avaient été exposées à des radiations à la suite
d’un accident nucléaire durant leur grossesse. Un même nombre d’enfants des deux
groupes, soit 1 600, étaient nés de mères irradiées.
a) Reconstituez le tableau de contingence représentant les données qui permettent le
calcul des mesures d’association.
b) Quel est le risque de troubles du développement chez les enfants exposés aux
radiations in utero ?
A. 0,05.
B. 0,5.

Questions et réponses Chapitre 5 • Les mesures d’association et la causalité 5
Épidémiologie appliquée, 2e édition © 2008 Les Éditions de la Chenelière inc.
C. 0,2.
D. 0,8.
E. Il ne peut être calculé à partir des données.
c) Quel est le rapport de cotes d’un trouble du développement associé à l’exposition aux
radiations in utero ?
A. 16.
B. 8,5.
C. 4.
D. 0,8.
E. Il ne peut être calculé à partir des données.
d) Quel résultat obtient-on quand on calcule le risque relatif d’un trouble du
développement associé à l’exposition aux radiations in utero ?
A. 16.
B. 8,5.
C. 4.
D. 0,8.
E. Il ne peut être calculé à partir des données.
e) Quelle est la prévalence des troubles du développement ?
A. 68 %.
B. 32 %.
C. 20 %.
D. 80 %.
E. Elle ne peut être calculée à partir des données.
Réponse
a) Le tableau de contingence représentant les données qui permettent le calcul des
mesures d’association pourrait se lire comme suit.
Mère irradiée + Mère irradiée – Total
Troubles du développement + 1 600 400 2 000
Troubles du développement – 1 600 6 400 8 000
Total 3 200 6 800 10 000
b) La réponse est E. Dans une étude cas-témoins, on ne peut pas calculer directement les
risques.
c) La réponse est A. Le rapport de cotes entre les exposés et les non-exposés estime
généralement assez bien le risque relatif. Dans ce cas, le RC = (1 600)(6 400)/(400)(1 600),
soit 16.
d) La réponse est E. Dans une étude cas-témoins, on ne peut calculer directement le RR
(voir l’exercice 5.2). Le RC estime le RR.
e) La réponse est E. Dans une étude cas-témoins, le choix arbitraire du nombre de cas et
de témoins ne donne aucune indication sur la prévalence du problème de santé dans la
population.
5.8 Question
Vous lisez une publicité pharmaceutique qui vante les mérites de l’Hypolipidémol dans la
réduction significative de la cholestérolémie. Lors d’une étude qui a mesuré la
concentration de l’Hypolipidémol en fonction de la cholestérolémie, on a trouvé un
coefficient de corrélation linéaire de « ... ? ». Malheureusement, votre chien a mordillé
votre courrier et vous ne pouvez lire correctement le coefficient. Celui-ci est le plus
vraisemblablement égal à :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%