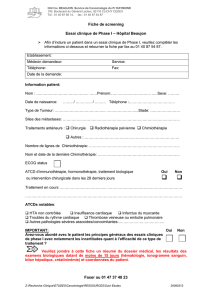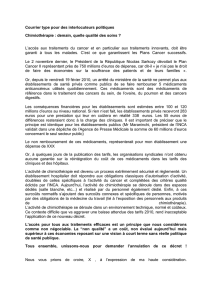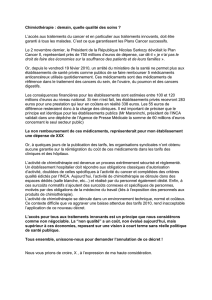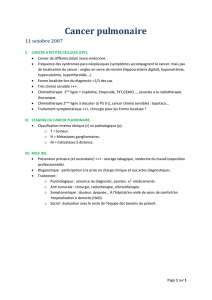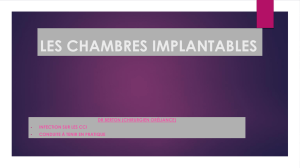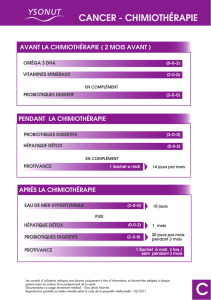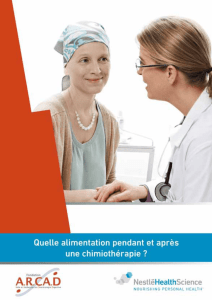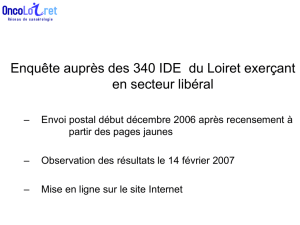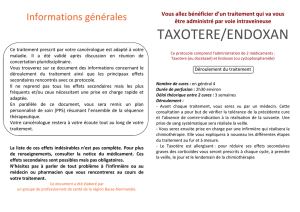Étude des représentations sociales de la chimiothérapie : une voie d

ARTICLE ORIGINAL
Étude des représentations sociales de la chimiothérapie :
une voie d’analyse des relations entre patients
et médecins oncologues
Study of chemotherapy social representations:
a way to analyse relations between patients and oncologists
Patrice C
ANNONE
1
Lionel D
ANY
2
E
´ric D
UDOIT
1
Florence D
UFFAUD
3
Sébastien S
ALAS
3
Roger F
AVRE
4
1
Psychologue clinicien,
service d’oncologie médicale,
CHU Timone, 264 rue Saint-Pierre,
13385 Marseille Cedex 05
2
Laboratoire de psychologie sociale,
Université de Provence,
13100 Aix-en-Provence
E-mail : [email protected]
3
Praticien hospitalier,
service d’oncologie médicale,
CHU Timone,
264 rue Saint-Pierre,
13385 Marseille Cedex 05
4
Chef de service de l’unité d’oncologie
médicale, CHU Timone,
264 rue Saint-Pierre,
13385 Marseille Cedex 05
Article reçu le 23 juin 2003,
accepté le 7 novembre 2003
Résumé. Cette recherche a pour objet d’étude les représentations sociales via la
chimiothérapie sur une population de médecins oncologues et de patients cancéreux
en cure de chimiothérapie. Notre méthodologie se situe au sein des méthodes
quantitatives avec l’utilisation, pour l’analyse des données, du logiciel statistique
SPSS pour les Anovas, de EVOQ et Alceste pour l’analyse pragmatique du discours.
Le recueil de données s’est effectué à partir de l’élaboration d’un questionnaire
constitué d’items et d’associations de mots. Nous nous sommes intéressés à la
chimiothérapie qui apparaît comme un objet social susceptible de générer un
processus représentationnel par lequel découle toute une série de stratégies adapta-
tives cognitivo-comportementales et émotionnelles. La chimiothérapie en tant que
telle pousse à l’adaptation du sujet cancéreux et reste un médiateur à la relation
médecin-patient. Puisque les représentations sont des « guides d’actions », l’exis-
tence d’une représentation propre aux médecins et aux patients nous donne à voir,
par un décalage sémantique et affectif, une médecine technicienne qui, dans le futur,
devrait tendre vers un existentialisme. ▲
Mots clés : chimiothérapie, représentation sociale, relation médecin-malade
Abstract. This reasearch aims to study social representations throughout chimiotherapy, out
of a population composed of doctors specialized in Oncology on one hand, and patients dealing
with cancer during their chimiotherapy on the other hand. Our methodology is situated among
quantitative methods using SPSS for Anovas to analyze statistics datas, EVOQ and Alceste
for the pragmatic analysis of the discourse. The datas were collected from a questionnaire
including items and words associations. We were interested in chimiotherapy which appears as
a social object likely to generate a representative process from which emerges a serie of adaptative
strategies belonging to both cognitivo-behaviourism and emotionnal spheres. Chimiotherapy
leads to an adaptation of the patient and remains a mediator in the doctor-patient’s relation.
As far as representations are “action guides”, the existence of a representation specific to patients
and doctors, allowes us to point out, through a semantic and emotionnal gap a technical
medicine which is, in the future, likely to tend to existentialism. ▲
Key words: chemotherapy, social representation, patient-doctor encounter
L’ étude des attitudes et représentations vis-à-vis du
cancer a fait l’objet de nombreuses recherches et
permis la construction d’outils de mesure, notam-
ment de la qualité de vie ou de la satisfaction des patients [1,
2]. Cependant, on peut constater dans la littérature que la
chimiothérapie reste un sujet d’étude psychosocial peu ex-
ploré.
La rencontre avec la maladie cancéreuse passe toujours par
l’annonce du diagnostic. Celle-ci constitue une première
rupture identitaire qui fait effraction pour le patient, le
confrontant sans préavis à la question existentielle de la mort
[3, 4] et de son devenir. La chimiothérapie, quant à elle,
répond par sa signature au diagnostic établi. On a pu observer
par exemple que les patients atteints d’un cancer attribuent
un caractère de gravité plus important à leur maladie
lorsqu’une chimiothérapie leur est proposée [5]. La chimio-
thérapie occupe bien une place particulière dans l’histoire de
la maladie cancéreuse [6] car elle s’énonce dans un même
Tirés à part : P. Cannone
E-mail : [email protected]
Bull Cancer 2004 ; 91 (3) : 279-84
© John Libbey Eurotext
279

temps à la suite du diagnostic et implique à son tour une
seconde adaptation psychologique par sa symbolique, son
mode de contact (spécificités des soins) et ses effets secondai-
res. Mais au-delà de cette place particulière pour le patient, la
chimiothérapie occupe également une place à part dans
« l’imaginaire social » avec ses effets secondaires, et tout
particulièrement l’alopécie qui a participé et participe encore
de nos jours à l’élaboration du stigmate [7] de la maladie
cancéreuse. La perception d’un « objet » tel que la chimio-
thérapie va donc s’opérer à travers un filtre interprétatif à la
fois individuel et collectif.
Notre pratique clinique, en oncologie médicale, nous montre
que la chimiothérapie est un média à la relation médecin-
patient ; elle apparaît souvent comme « l’objet » autour du-
quel se met en place et se réalise la communication entre le
médecin et le patient. La chimiothérapie prend cette place
d’interface [8, 9], de support à des modalités de communica-
tion des médecins et d’adaptation des patients [10, 11].
Comme le soulignent Quesnel et al. [12], le « traitement »
représente un concept clé dans l’analyse de la relation entre
médecins et patients.
On sait par ailleurs que les difficultés rencontrées lors des
interactions entre médecins et patients peuvent être attri-
buées à la diversité des attitudes [13] et représentations que
chacun peut élaborer à propos de la maladie [14] ou du
traitement. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés à
l’étude des représentations sociales de la chimiothérapie,
avec pour objectif de mettre à jour certains des « mécanismes
sous-jacents » aux communications entre patients et méde-
cins pour une alliance thérapeutique.
Cette recherche s’inscrit dans le cadre conceptuel des repré-
sentations sociales. Par représentations sociales, nous enten-
dons l’ensemble organisé des connaissances, des croyances,
des opinions, des images et des attitudes partagées par un
groupe à l’égard d’un objet social donné. Les représentations
sociales ont deux composantes : une composante cognitive
et une composante sociale [15]. Celles-ci vont rendre compte
à la fois du rapport que l’individu entretient avec « l’objet
représenté » (histoire personnelle, expérience, vécu), mais
aussi de l’inscription de ce rapport dans un contexte social
(appartenance à des groupes sociaux). Comme le souligne
Amério [16], les « problèmes humains » tels que la santé ont
toujours un côté individuel (c’est l’individu qui les subit et qui
doit y faire face) et un côté social (implication des groupes et
de la vie collective). Ce cadre conceptuel va donc nous
permettre de mettre à jour les régulations sociocontextuelles
des relations entre médecins et patients [17].
De plus, toute représentation sociale peut être considérée
comme une modalité de connaissance liée aux comporte-
ments des individus [18] mais qui permet également la com-
munication entre ces derniers [19]. En effet, les représenta-
tions sociales, du fait de leur inscription dans un système plus
général de signification et de compréhension de l’environne-
ment social, vont jouer un rôle important dans les interactions
sociales [20].
Dès lors, à travers l’étude des représentations sociales, il sera
possible non seulement d’identifier les processus médiateurs
qui régulent le rapport aux objets de notre environnement
(dans le cas présent la chimiothérapie) mais aussi d’appré-
hender leurs dynamiques à l’interface de l’individuel et du
collectif.
Objectifs
Les objectifs de cette recherche sont multiples :
– mettre à jour le champ représentationnel (signification et
image) de la chimiothérapie ;
– étudier les régulations de ces champs représentationnels en
fonction des statuts des individus (patients cancéreux sous
chimiothérapie versus médecins oncologues) ;
– explorer les perceptions attribuées aux effets secondaires de
la chimiothérapie en fonction du statut des individus (méde-
cins versus patients) ;
– proposer des pistes de réflexion sur les enjeux communica-
tionnels et identitaires qui s’opèrent dans la réalité sociale
complexe que représente l’interaction médecins-patients
dans le cadre particulier de la prise en charge par chimiothé-
rapie.
Résultats
Représentation de la chimiothérapie
L’analyse des associations libres par le logiciel Evoc 2000
©
met en évidence que le terme cancer est le plus saillant dans
chacune des deux sous-populations (tableau 1). Le terme
guérison, quant à lui, est très saillant chez les patients mais
absent des évocations des médecins.
Le terme traitement bénéficie d’un statut différent chez les
médecins (13/21, soit 62 %, l’énoncent) et chez les patients
(9/40, soit 22,5 %). Pour les patients, ce terme est évoqué
dans un système de soins général alors que les médecins
mettent l’accent sur l’effet « toxique ».
Cette première analyse permet de mettre en évidence une
construction représentationnelle différenciée de la chimio-
thérapie. Si celle-ci apparaît comme un moyen de guérir le
cancer pour les patients, elle n’est qu’un moyen de le traiter
pour les médecins.
L’analyse du corpus d’associations libres à l’aide du logiciel
Alceste
©
permet de mettre en évidence sept univers différents
de reconstruction de l’objet chimiothérapie, associés aux
statuts des personnes interrogées (tableau 2). Le profil de
chaque classe est déterminé par l’ensemble des termes et
variables (ici le statut : médecins versus patients) les plus
significativement présents dans ces classes. Pour les patients,
l’objet « chimiothérapie » est reconstruit à travers quatre
dimensions. La première dimension concerne les effets
Tableau 1. Représentations de la chimiothérapie selon le statut
(patients versus médecins)
Termes Patients (n = 40) Médecins (n = 21)
Les plus saillants Cancer (19)
Guérison (18) Cancer (16)
Traitement (13)
Relativement
saillants Maladie (12)
Chimique (10)
Traitement (9)
Perfusion (6)
Toxique (5)
Peu saillants Fatigue (6)
Thérapie (6)
Espoir (4)
Perte cheveux (4)
Souffrance (4)
...
Alopécie (4)
Effets secondaires (4)
Anticancéreux (3)
Nausée (3)
Curatif (2)
Médicament (2)
Radiothérapie (2)
...
P. Cannone et al.
Bull Cancer 2004 ; 91 (3) : 279-84
280

secondaires (classe 1), qui regroupent à la fois la perte de
cheveux et le « ressenti physique » face à la cure (appétit,
fatigue), et une autre dimension davantage « anxiogène »
(classe 4) avec la mort et la souffrance qui côtoient l’espoir.
Les deux autres dimensions concernent à la fois l’aspect
médicalisé de la chimiothérapie (classe 5) avec des termes
tels que protocole et thérapie, qui inscrivent la chimiothéra-
pie dans un cadre d’exercice défini, et les conséquences
attendues du traitement (classe 6), avec des termes comme
soins et guérison.
Pour les médecins, la chimiothérapie est reconstruite à travers
trois dimensions. Dans une première dimension, on retrouve
des termes comme effets secondaires,contraintes et décès qui
marquent le contexte de réalisation de la cure de chimiothé-
rapie avec ses conséquences et ses incertitudes. Une autre
dimension concerne les effets secondaires (classe 3) avec des
termes tels que alopécie et nausées. Enfin, la troisième dimen-
sion renvoie davantage à la pratique médicale, avec des
termes qui expriment à la fois les propriétés de la chimiothé-
rapie (toxique,médicament,curatif,palliatif) et son mode
d’administration (perfusion) (classe 7).
Cette analyse met en évidence le fait que les patients ont une
représentation de la chimiothérapie marquée par une dimen-
sion émotionnelle, qui se situe dans « l’éprouvé » ; trois
classes de discours sur quatre vont dans ce sens et une classe
de discours évoque la thérapeutique avec un discours
« pseudo-médical ». Les médecins, quant à eux, privilégient
un discours centré sur la pratique médicale. En d’autres
termes, lorsque l’un parle du vécu de la maladie (le patient),
l’autre se focalise davantage sur la pathologie (le médecin).
L’analyse des attitudes nous montre que certaines font l’objet
d’une adhésion commune pour les médecins et les patients.
C’est le cas pour l’aspect toxique de la chimiothérapie, le fait
qu’elle réponde à un protocole particulier, qu’elle doive être
prise au sérieux, qu’elle soit associée à de nombreux examens
ou encore que les effets secondaires soient désagréables
(tableau 3). L’association des effets de la chimiothérapie n’est
pas, pour les patients et les médecins, liée à la seule hospita-
lisation.
Trois attitudes font l’objet d’une différence significative entre
patients et médecins. Les patients sont plus nombreux à
estimer que la chimiothérapie sert à guérir le cancer (87,5 %
versus 66,5 % des médecins ; p = 0,028). Ils sont aussi plus
nombreux à estimer que les résultats (bons ou mauvais) sont
expliqués (80 % versus 47,5 % des médecins ; p = 0,017).
Enfin, les patients estiment davantage que les médecins que,
au cours d’une cure de chimiothérapie, on puisse préférer
être seul (45 % versus 9,5 % des médecins ; p = 0,036) ; ils
sont également plus nombreux à estimer que la chimiothéra-
pie est synonyme de solitude (37,5 % contre 19 % pour les
médecins), mais cette différence n’est pas significative.
Ces résultats illustrent la place particulière qu’occupent les
attentes, le vécu face à la chimiothérapie et l’information des
patients et des médecins. Les caractéristiques « endogènes »
de la chimiothérapie ne produisent pas quant à elles de
différence entre médecins et patients (toxicité, stratégie thé-
rapeutique, effets secondaires).
Effets secondaires perçus
Les effets secondaires liés à la chimiothérapie sont appréhen-
dés de manière différenciée en fonction du statut du répon-
dant (patient versus médecin, tableau 4). Pour les patients, la
fatigue, les nausées et la constipation sont citées préférentiel-
lement comme effets secondaires de la chimiothérapie, c’est-
à-dire des symptômes « non visibles ». Pour les médecins, les
effets secondaires cités de manière privilégiée renvoient au
« visible » comme l’alopécie, les vomissements ou les muci-
tes. Si l’asthénie est citée par les médecins, elle n’occupe
qu’une place relative dans les effets cités.
L’analyse par le logiciel Alceste
©
met en évidence cinq clas-
ses de discours dont quatre sont marquées par des associa-
tions produites par les patients contre une seulement par les
médecins (tableau 5). Les patients évoquent la perte (perte
d’appétit, perte des cheveux) pour la classe 1, les nausées
(mal au cœur) pour la classe 2, une souffrance psychique
Tableau 2. Classes de discours issues de l’analyse Alceste
©
avec pour mot inducteur Chimiothérapie (n = 61)
Classes de discours 1(14,29 %) 2(14,29 %) 3(12,5 %) 4(12,5 %) 5(10,71 %) 6(19,64 %) 7(16,07 %)
Variables associées Patient
Chi 2 = 10,37 Médecin
Chi 2 = 5,83 Médecin
Chi 2 = 17,42 Patient
Chi 2 = 8,89 Patient
Chi 2 = 7,47 Patient
Chi 2 = 15,21 Médecin
Chi 2 = 38,6
Termes associés Appétit
Cheveux
Fatigue
Hôpital
Perte
Contraint
Décès
Effet
Radiothérapie
Secondaire
Long
Nausée
Alopécie
Perfusion
Espoir
Guérison
Mort
Souffrance
Protocole
Thérapie
Tumeur
Guérison
Maladie
Progrès
Soins
Curatif
Cancer
Toxique
Palliatif
Perfusion
Tableau 3. Positionnement des patients et des médecins face aux
attitudes liées à la chimiothérapie. Les scores correspondent aux
taux d’acceptation de la proposition (accord avec la proposition)
Attitudes Patients
(n=40) Médecins
(n = 21)
La chimiothérapie sert à guérir le cancer 87,5 % 66,5 %*
La chimiothérapie est un mélange
de produits toxiques 70,0 % 71,5 %
La chimiothérapie c’est la mise
en œuvre d’un protocole particulier 92,5 % 90,0 %
La chimiothérapie est un traitement
qui doit être pris au sérieux 100 % 100 %
La chimiothérapie est souvent associée
à de nombreux examens 75,0 % 81,0 %
Les résultats de la chimiothérapie (bon
ou mauvais) sont toujours expliqués 80,0 % 47,5 %*
La chimiothérapie est synonyme
de solitude 37,5 % 19,0 %
Les effets secondaires de
la chimiothérapie sont désagréables 72,5 % 86,0 %
Les effets de la chimiothérapie ne durent
que le temps de l’hospitalisation 25,0 % 9,5 %
Lorsque l’on suit une cure de
chimiothérapie on préfère être seul 45,0 % 9,5 %*
* Différences significatives à p < 0,05.
Étude des représentations sociales de la chimiothérapie
Bull Cancer 2004 ; 91 (3) : 279-84 281

(manque de sommeil, dépressif, douleur) pour la classe 3, la
fatigue et la constipation pour la classe 5. Les médecins, pour
la classe 4, évoquent l’alopécie, l’asthénie, l’anémie, l’apla-
sie... de façon consensuelle.
Ce résultat met à jour la multidimensionnalité des percep-
tions associées aux effets secondaires chez les patients face à
un discours homogène, « unique », chez les médecins,
quelle que soit la durée de leur expérience en oncologie
médicale.
Discussion
Quelles que soient les diverses méthodologies d’analyse rete-
nues, on peut constater des variations qui ont valeur d’ins-
tance d’organisation [21] de la représentation de la chimio-
thérapie chez les patients et les médecins que nous avons
interrogés. La place « essentielle » qu’occupe la guérison
dans la représentation des patients en est un bon exemple. Les
enjeux autour de la guérison sont révélateurs, pour les pa-
tients, de la volonté de vouloir se battre contre la maladie
[22]. Volonté qui s’ancre, dans le cas présent, sur l’efficacité
du traitement. Toutefois, ce résultat peut aussi trouver sens
dans une surestimation des bénéfices attribués au traitement
de la part des patients [5] ou d’une réserve vis-à-vis de ces
mêmes bénéfices par les médecins. En effet, comme le souli-
gne Imbault-Huard [23], la guérison représente, pour le sa-
voir médical, une zone d’ombre et d’incertitude ; la pratique
médicale se focalise davantage sur les traitements, les cures et
les remèdes. C’est bien de cela dont il s’agit à la lecture de nos
résultats, quand l’un (le patient) perçoit l’objet comme une
« finalité », l’autre (le médecin) le perçoit comme un
« moyen ».
Il existe une asymétrie en termes d’information entre patients
et médecins au bénéfice de ces derniers [24]. Au regard de
nos résultats, cette sous-information (ou du moins sa percep-
tion) trouve écho chez les médecins de notre échantillon.
Doit-on y voir le reflet d’une réalité (mise en évidence par les
médecins) ou le signe d’un questionnement face au niveau
d’appropriation de l’information par les patients [25] ? On
sait par ailleurs qu’il existe une différence entre l’information
reçue par les patients et les représentations que ces derniers
vont construire au regard de la réalité de la maladie, des
traitements et de leurs propres situations [5]. Si la recherche
d’une meilleure communication (le « comment communi-
quer ») entre médecins et patients, qui a fait l’objet de recher-
ches et d’exposés [26, 27], est et doit rester un axe de
réflexion important, n’en demeurent pas moins la question du
« quoi communiquer » et celle de l’appropriation de l’infor-
mation par le patient. Cette question est d’autant plus pré-
gnante pour le médecin qui reste confronté à la question de la
« vérité » et aux droits à l’information des patients. Cela le
pousse à rester prudent dans ses paroles mais aussi à tenir
compte du sujet unique qui se tient devant lui.
Comme nous le montre l’ensemble de ces résultats, la cons-
truction représentationnelle d’un objet comme la chimiothé-
rapie est tributaire de l’implication des individus face à cet
objet. Nous avons mis à jour l’influence exercée par les statuts
et rôles de chacun au regard de cet objet et déterminé ainsi la
saillance particulière de certaines dimensions de la représen-
tation. Ces dimensions (la question de la solitude des patients,
du discours unique des médecins et de l’information reçue et
transmise...) joueront un rôle important dans l’interaction
thérapeutique et dans l’échange d’informations.
Conclusion
Cette recherche exploratoire nous montre les points d’ancra-
ges et d’asymétries de la représentation de la chimiothérapie
pour les patients et médecins oncologues. Les similitudes
observées sont à l’origine d’un mode de communication
commun dans la relation médecin-patient qui se centre par-
ticulièrement sur l’aspect technique de la pratique médicale.
Les décalages, quant à eux, sont les signes des attentes et
objectifs de chacun dans leurs rôles respectifs.
L’intérêt lié à la connaissance de ces représentations, pour le
médecin, est l’accès aux grilles de lectures que le patient
applique à la situation.
Cette recherche aurait gagné en clarté si nous avions intégré
comme variable dépendante la thérapeutique proposée au
patient. En effet, il serait intéressant de savoir la différence de
représentation de la chimiothérapie suivant l’annonce du
Tableau 4. Effets secondaires perçus selon le statut (patients versus
médecins)
Termes Patients (n = 40) Médecins (n = 21)
Les plus saillants Fatigue (27)
Nausée (16) Alopécie (11)
Nausée (14)
Vomissement (11)
Relativement saillants Constipation (9) Asthénie (8)
Mucite (7)
Peu saillants Aphtes (4)
Aucun (1)
Bouche sèche (1)
Brûlure (1)
Champignon (1)
Crachat (1)
Diarrhée (1)
Fièvre (1)
...
Anxiété (1)
Aplasie (3)
Digestive (1)
Fatigue (3)
Fièvre (2)
Hématologique (1)
Leucopénie (1)
...
Tableau 5. Classes de discours issues de l’analyse Alceste
©
avec pour mot inducteur Effets secondaires (n = 61)
Classes de discours 1(11,54 %) 2(11,54 %) 3(9,62 %) 4(40,38 %) 5(26,92 %)
Variables associées Patient
Chi 2 = 9,19 Patient
Chi 2 = 9,19 Patient
Chi 2 = 7,49 Médecin
Chi 2 = 88,05 Patient
Chi 2 = 17,59
Termes associés Perte cheveux
Perte appétit
Stérilité
Nausée
Mal au cœur Sommeil perturbé
Dépressif
Douleur
Fatigue
Alopécie
Mucite
Asthénie
Vomissement
Anémie
Aplasie
Constipation
Aphte
Diarrhée
P. Cannone et al.
Bull Cancer 2004 ; 91 (3) : 279-84
282

diagnostic et de la thérapie proposée par le médecin. Une
nouvelle recherche est d’ailleurs engagée pour répondre à
cette question. ▼
Matériel et méthodes
Les résultats sont issus d’une recherche exploratoire effectuée
dans le cadre du service d’oncologie médicale du CHU de la
Timone Adultes à Marseille. Celle-ci a été conduite, par question-
naire auto-administré, auprès d’un échantillon de 61 personnes,
comprenant 40 patients en cure de chimiothérapie dans le service
d’oncologie et 21 médecins oncologues (praticiens hospitaliers,
assistants, attachés, internes) exerçant dans ce même service.
Cette recherche a été réalisée de janvier à juin 2002.
La population de patients étudiée est constituée de 50 % de
femmes et 50 % d’hommes ; la médiane d’âge est de 51 ans avec
des extrêmes de 18 ans et 75 ans. La chimiothérapie est palliative
(50 %), adjuvante (35 %) et néoadjuvante (15 %).
Le questionnaire proposé aux patients et médecins de ce service
comportait trois parties distinctes :
– un recueil d’associations libres
1
à partir des termes « chimiothé-
rapie » et « effets secondaires » ;
– un recueil d’attitudes vis-à-vis de la chimiothérapie ;
– un recueil d’informations complémentaires (sexe, âge).
Les données issues des associations libres ont fait l’objet d’une
double analyse à l’aide du logiciel Evoc 2000
©
et du logiciel
d’analyse de données textuelles Alceste
©
.
Le logiciel Evoc 2000
©
[28] permet de mettre en évidence, sur la
base d’une analyse lexicographique, le contenu d’une représen-
tation. Les termes évoqués par les individus seront dès lors plus ou
moins saillants en fonction de l’ordre et de la fréquence d’évoca-
tion des mots. Par conséquent, les termes les plus saillants seront
potentiellement les éléments les « plus importants » de la repré-
sentation.
Le logiciel Alceste
©
permet l’analyse de données textuelles. L’hy-
pothèse générale développée dans ce logiciel consiste à considé-
rer les lois de distribution du vocabulaire dans les énoncés d’un
corpus comme une trace linguistique d’un travail cognitif de
reconstruction d’un objet par un individu. Alceste
©
regroupe les
énoncés (dans le cas présent les mots évoqués) en classes d’énon-
cés ou classes de discours par proximité du vocabulaire (occur-
rence et co-occurrence). Le coefficient d’association d’un énoncé
ou d’une variable (statut du répondant) à une classe est calculé à
partir d’un Chi2 d’association [29, 30].
Les questions relatives aux attitudes vis-à-vis de la chimiothérapie
sont issues d’une pré-enquête par entretiens non directifs
2
auprès
de 15 patients et 10 médecins. L’analyse de contenu réalisée sur
ces 25 entretiens nous a permis de dégager les thématiques récur-
rentes dans le discours des interviewés et d’élaborer les questions
d’attitudes. Pour chacune des attitudes (10 au total), la personne
interrogée devait indiquer sur une échelle de type Lyckert [31] en
quatre points son degré d’accord avec la proposition, les modali-
tés de réponses allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait
d’accord ». La passation du questionnaire était d’environ 20 mi-
nutes ; celle-ci avait lieu dans la chambre d’hôpital pour le
malade et dans les unités respectives d’exercice pour chaque
médecin oncologue.
Les analyses statistiques (test du Chi2) concernant les attitudes
exprimées ont été effectuées avec le logiciel d’analyse statistique
SPSS
©
[32].
Remerciements. Nous tenons à remercier les patients et les
médecins du service d’oncologie médicale du CHU Timone à
Marseille qui ont accepté de participer à cette recherche, la
Fédération hospitalière de France (FHF) pour son soutien financier,
sans qui cette recherche n’aurait pu s’effectuer.
RÉFÉRENCES
1. Burns N. Measuring cancer attitudes. In: Franck-Stromborg M, eds. Ins-
truments for clinical nursing research. San Francisco: Ed Jones and Barttlett,
1992.
2. Lebovits AH, Croen LG, Goetzel RZ. Attitudes towards cancer: develop-
ment of the cancer attitudes questionnaire. Cancer 1984 ; 54 : 1124-9.
3. Little M, Jordens CFC, Paul K, Montgomery K, Philipson B. Liminality: a
major category of the experience of cancer illness. Social Science and Medecine
1998 ; 47 : 1485-94.
4. Muzzin LJ, Anderson NJ, Figueredo AT, Gudelis. So the experience of
cancer. Social Science and Medecine 1994 ; 38 : 1201-8.
5. Charavel M, Bremond A, Mignotte H. E
´tude de la participation des
patients au choix thérapeutique en oncologie. Annales Médico-Psychologiques
2002 ; 160 : 289-302.
6. Strauss A. La trame de la négociation. L’Harmattan : Paris, 1992.
7. Goffman E. Stigmate. Minuit : Paris, 1985.
8. Takayama T, Yamazaki Y, Katsumata N. Relationship between outpa-
tients’ perceptions of physicians’ communication styles and patients’ anxiety
levels in a Japanese oncology setting. Social Science and Medecine 2001 ; 53 :
1335-50.
9. Ford S, Fallowfield L, Lewis S. Doctor-patient interactions in oncology.
Social Science and Medecine 1996 ; 42 : 1511-9.
10. Rotter DL, Hall JA. Doctors talking with patients, patients talking with
doctors. Auburn House: Westport CT, 1992.
11. Stewart MA. What is a successful doctor-patient interview? A study of
interactions and outcomes. Social Science and Medecine 1984 ; 19 : 167-75.
12. Quesnel M, Garnier C, Hall V. Contribution à la théorisation des repré-
sentations sociales dans la compréhension du phénomène de prescription de
médicaments psychotropes. In : Lebrun M, ed. Les représentations sociales : des
méthodes de recherche aux problèmes de société. Ed Logiques : Outremont, 2001.
13. Miller M, Kearney N, Smith K. Measurement of cancer attitudes: a
review. Eur J Oncol Nursing 2000 ;4:233-45.
14. Petrillo G. Influence sociale, communication persuasive et représenta-
tions sociales de la santé et de la maladie. In : Petrillo G, ed. Santé et société.Ed
Delachaux et Niestlé : Neuchâtel, 2000.
15. Abric JC. Specific process of social representations. Papers on Social Repre-
sentations 1996;5:77-81.
16. Amério P. Psychologie sociale et problèmes humains. Psychologie et Société
2001 ; 4 : 25-56.
17. Morin M, Apostolidis T. Contexte social et santé. In : Fisher GN, ed.
Traité de psychologie de la santé. Dunod : Paris, 2002.
18. Abric JC. Pratiques sociales et représentations. Presses Universitaires de
France : Paris, 1994.
19. Moscovici S. La nouvelle pensée magique. Bull Psychol 1992 ; XLV :
301-24.
20. Moliner P. Images et représentations sociales. Presses Universitaires de Gre-
noble : Grenoble, 1999.
21. Moliner P, Rateau P, Cohen-Scali V. Les représentations sociales : pratiques des
études de terrain. Presses universitaires de Rennes : Rennes, 2002.
22. Byrne A, Ellershaw J, Holcombe C, Salmon P. Patients’ experience of
cancer: evidence of the role of “fighting” in collusive clinical communication.
Patient Education and Counseling 2002 ; 48 : 1-21.
23. Imbault-Huard MJ. La guérison : victoire et défaite du médecin. In :
Khayat D, Spire A, eds. Guérir. Ed Ellipses : Paris, 1999.
24. Gafni A, Charles C, Whelan T. The physician-patient encounter: the
physician as a perfect agent for the patient versus the informed treatment
decision-making model. Social Science and Medecine 1998 ; 47 : 347-54.
1
Il s’agit de produire un certain nombre de mots ou expressions à partir
d’un mot inducteur.
2
La consigne inaugurale visait à cerner les thématiques abordées sponta-
nément par les individus.
Étude des représentations sociales de la chimiothérapie
Bull Cancer 2004 ; 91 (3) : 279-84 283
 6
6
1
/
6
100%