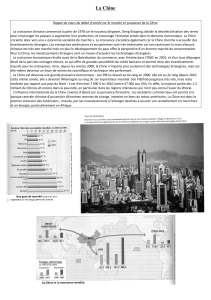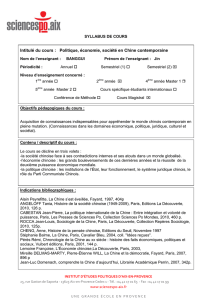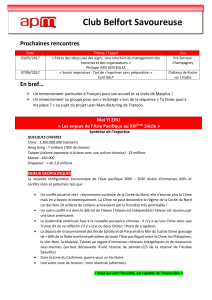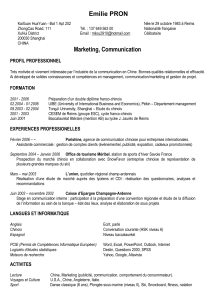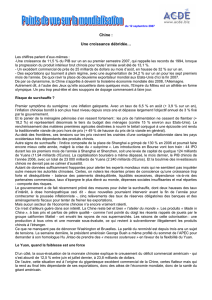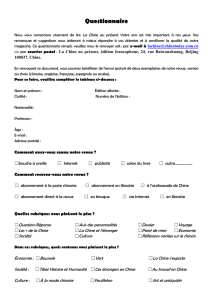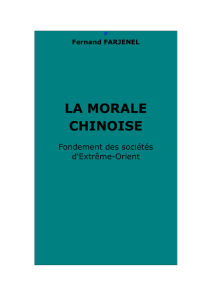Chine : derrière la croissance économique, la crise morale

26
Sociétal
N° 41
3etrimestre
2003
A
Chine : derrière
la croissance économique,
la crise morale
PHILIPPE TRAINAR *
Au voyageur pressé, la Chine présente l’aspect d’un
pays plongé dans les réformes, assurant à sa popu-
lation urbaine des conditions de vie sans cesse amé-
liorées en même temps que des espaces de liberté
élargis. Un régime qui rappelle le bonapartisme,
fort de son armée, prônant la souplesse et l’ordre,
manquant seulement de légitimité politique mais
s’en accommodant. Au voyageur moins pressé, le
tableau n’apparaît pas aussi rose : la réussite éco-
nomique prend la forme d’une fuite en avant, des-
tinée à faire oublier la grave crise morale que
connaît le pays, crise née des répressions sanglantes
du dernier demi-siècle et surtout d’un profond
désarroi spirituel. Le mensonge élevé au rang de
valeur sociale entretient la méfiance, le cynisme,
voire un certain désespoir : on l’a vu à deux reprises
en matière de santé, avec le SIDA et le SRAS. La
jeunesse chinoise qui n’adhère pas à l’économisme
ambiant verse plutôt dans le nihilisme. Une tenta-
tion qui pourrait déboucher sur de graves secousses
politiques.
R E P È R E S E T T E N D A N C E S
ASIE
Les signes d’une crise morale pro-
fonde, et d’autant plus dange-
reuse qu’elle est encore refoulée,
sont maintenant perceptibles en
Chine, alors que le pays apparaît le
plus souvent comme un modèle de
transition réussie.
Des thérapies de choc ont imposé
des ajustements douloureux en Rus-
sie et dans les pays d’Europe cen-
trale, mais la Chine, selon le point
de vue le plus courant, aurait maî-
trisé son processus de développe-
ment en limitant notamment ses
coûts humains. Il y a certainement
du vrai dans ce point de vue et l’ap-
parent optimisme des Chinois, qui,
pour le voyageur, contraste avec le
pessimisme des Slaves, ne fait que
confirmer cette impression.
Comme pour rendre les différences
encore plus frappantes, les entreprises
étrangères se précipitent dans les
grandes villes côtières chinoises où
elles font monter les prix de la main-
* Rédacteur en chef de la Revue
française d’économie.

27
Sociétal
N° 41
3etrimestre
2003
CHINE : DERRIÈRE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE, LA CRISE MORALE
d’œuvre qualifiée, alors qu’elles bou-
dent les pays de l’Est, leur insécurité
et les chicaneries d’administrations
déboussolées par le changement. Bon
nombre de libéraux authentiques,
ceux qui exècrent les révolutions bru-
tales, inévitablement porteuses d’in-
humanités et d’injustices, ne se font
pas prier pour louer l’empirisme du
gouvernement chinois.
Certes, le pouvoir ment, reste arbi-
traire et ne respecte pas les oppo-
sants, qu’à la limite il fait disparaître.
Mais quelle distance parcourue depuis
les monstrueux excès de la campagne
« anti-droite », du « Grand bond en
avant » ou de la révolution culturelle !
Chaque voyage apporte l’impression
d’un élargissement continu de la
sphère des libertés : l’échange est pos-
sible, et fructueux. Comment ne pas
se laisser séduire par ce lot de nou-
veautés ?
L’extrême gauche européenne est
en revanche de plus en plus critique
à l’égard de la Chine, dénonçant la
montée du marché, celle du capita-
lisme sauvage, des inégalités, de la
corruption. Ces critiques ne sont
pas fausses, mais leur crédibilité est
affaiblie parce qu’elles proviennent
des nostalgiques de la révolution
chinoise et de son cortège d’hor-
reurs. Leur manque aussi la prise
en compte des changements posi-
tifs intervenus au cours du quart de
siècle écoulé, notamment l’amélio-
ration des conditions de vie. N’était
leur communisme, on se prendrait
à imaginer les dirigeants chinois en
disciples de Burke, attachés à une
liberté concrète, sans excès, sou-
cieux de ne plus se lancer dans des
politiques aventureuses. On se pren-
drait même à craindre l’impatience
des libéraux et des minorités qui
réclament le respect de leurs droits,
et à leur conseiller la modération .
UN BONAPARTISME
À LA CONQUÊTE
DE LA PROSPÉRITÉ
Ala vérité, c’est au bonapartisme
que l’on devrait comparer le
régime actuel : même souci de
réconciliation, même flexibilité idéo-
logique, même culte de l’ordre,
même dépendance à l’égard du mili-
taire. Et, du coup, on donnerait au
régime l’éternité que le philosophe
Jean-Baptiste Vico concédait aux
monarchies classiques « humaines »
du début du dix-huitième siècle et
que certains, jusqu’à la papauté elle-
même, ont cru retrouver dans le
bonapartisme.
Mais n’est-ce pas là pousser trop loin
le parallélisme entre la Chine com-
muniste d’aujourd’hui et la France
de Bonaparte ? Je ne le
crois pas. On peut même
le pousser un peu plus loin.
L’empire communiste de
la Chine actuelle partage
en effet une autre carac-
téristique avec l’empire
bonapartiste du début du
XIXesiècle : il lui manque
la légitimité politique, qui
ne peut venir que d’un
principe monarchique ou
démocratique – ou être
remplacée par la terreur.
La fuite en avant peut com-
penser ce manque : c’est la guerre
chez Bonaparte ou, ce qui est plus
sympathique, la croissance écono-
mique chez les dirigeants commu-
nistes.
Tout cela étant dit, on retrouve à
chaque fois la même crise morale,
reposant sur les mêmes facteurs :
des gouvernants apparemment
« humains », mais dont chacun sait
qu’ils étaient sur les lieux du crime
lorsque celui-ci s’est produit ; une
société en état d’apesanteur, inca-
pable d’accéder à sa dimension his-
torique en raison de l’amnésie
concernant son passé récent ; des
individus sans généalogie morale,
emportés dans le tourbillon éco-
nomique de la fuite en avant. Avec,
en toile de fond, le nihilisme du
régime, celui de la société et de l’in-
dividu. Et de fait, les discussions que
l’on peut avoir avec l’homme de la
rue finissent toutes sur du nihilisme
et non sur des idées de solutions
politiques et morales applicables à
la situation actuelle. Au fond, les Chi-
nois sont plus nietzschéens que les
occidentaux, ce qui est une décou-
verte surprenante. Comment expli-
quer cette crise morale ?
LA CONFUSION
DES PERSÉCUTÉS
ET DES PERSÉCUTEURS
Il y a tout d’abord un passé crimi-
nel non liquidé, d’autant plus diffi-
cile à oublier que la victime a été à
un degré ou un autre elle-même un
assassin, que le persécuté a été un
persécuteur, et en Chine
plus que dans tout autre
régime révolutionnaire.
L’Etat a été le chef d’or-
chestre de ce crime, qui
a trouvé son point
d’acmé dans la technique
de l’autocritique ou
encore dans les camps
de travaux forcés du Lao
Gaï, peuplés de prison-
niers tibétains. Seul l’Etat
pourrait effacer cette
tragédie qui pèse sur les
générations de la révo-
lution. Mais, comme en son temps
l’empire napoléonien, le régime
communiste actuel ne veut pas
dénouer cette fatalité, par peur de
se retrouver confronté à ces « génies
invisibles de la cité » évoqués par l’his-
torien Guglielmo Ferrero. La révo-
lution les avait libérés, et Deng
Xiaoping, comme autrefois Napo-
léon, a eu beaucoup de mal à les
contenir, puis à les rejeter.
Le régime affirme avoir identifié les
coupables – la « bande des quatre »
– et exorcisé les « génies invisibles »,
tout en sachant que cela n’est pas
totalement vrai, et que la « bande
des quatre » a joué le rôle com-
mode du bouc émissaire. Pour évi-
ter que les fantômes du passé ne
réapparaissent, les autorités ont
donc décidé de fermer et d’inter-
dire à jamais l’accès à cette période :
dès décembre 1988, le bureau de
la propagande avait interdit toute
publication sur la révolution cultu-
Ces gouvernants
apparemment
« humains »,
chacun sait
qu’ils étaient
sur les lieux du
crime lorsque
celui-ci s’est
produit.

28
Sociétal
N° 41
3etrimestre
2003
R E P È R E S E T T E N D A N C E S
relle. L’histoire prend valeur de par-
cours initiatique à sens unique.
Dante ne retourne pas plus en enfer
que les dirigeants chinois ne se
retournent vers les crimes
passés du Parti. La réforme
est le point d’aboutisse-
ment heureux de la révo-
lution, elle l’efface à jamais,
soit qu’elle la dépasse dia-
lectiquement, soit qu’elle
la ravale plus prosaïque-
ment au rang d’absurdité.
Comme le note le critique
littéraire Xu Zidong dans un
essai titré « La mémoire col-
lective en carton pâte », les
romans chinois ont bien
intégré cette version reloo-
kée de la révolution cultu-
relle : leurs héros sortent plus forts
de l’épreuve initiatique, plus heureux
en amour ou promus politiquement.
Curieuse vision de ce cataclysme his-
torique ! Seule la poésie ose évoquer
de façon elliptique la vérité de la révo-
lution, comme le poète Lu Yuan dans
son poème « Luth brisé II » : « Pour-
quoi rompre le silence / Puisque m’ha-
bite la tristesse ?/ Tout comme lorsqu’on
a mal / Nul autre ne peut partager… »
L’ÉCONOMIE
POUR TOUT HORIZON
La crise morale que traverse la
Chine a une autre raison, qui est
la négation de toute dimension spi-
rituelle de l’existence. Collective-
ment, à travers le confucianisme, et
individuellement, à travers le taoïsme,
les Chinois ont eu pendant des mil-
lénaires la certitude, rassurante,
d’être les dépositaires du mandat
céleste et de réaliser l’alliance du ciel
et de la terre. En raison de la forte
unité du spirituel et du temporel dans
la société chinoise, le renversement
de l’empire et la proclamation de la
république ont été vécus comme un
dépouillement spirituel bien plus pro-
fond que celui provoqué par la Révo-
lution française.
L’enthousiasme suscité ensuite par
la révolution communiste peut s’ex-
pliquer par la fusion quasi religieuse
qu’elle a paru restaurer entre l’Etat
et les intellectuels. Mais cette fusion
n’a été qu’une macabre contrefa-
çon, achevée dans la tra-
hison des clercs, leur
avilissement au rang de
commissaires politiques
et de tortionnaires, puis
leur liquidation. L’esprit
chinois en a été purement
et simplement assassiné.
Au sortir de la révolution
culturelle, l’effondrement
du communisme religieux
et l’ouverture progressive
de la société chinoise ont
pu donner l’espoir d’une
renaissance spirituelle. A
l’ombre de l’économisme
étriqué de Deng Xiaoping,
la classe intellectuelle avait réussi
à se reconstituer progressivement
et à regagner une part de liberté.
On connaît la suite : lorsqu’elle a
voulu redonner un sens à la vie col-
lective, la classe intellectuelle a été
écrasée. Les événements de la place
Tien An-men ont consommé la rup-
ture entre l’Etat et les intellectuels,
et l’âme chinoise a été une troi-
sième fois déchirée, aggravant une
crise spirituelle propice à l’éclosion
de toutes les sectes et sociétés
secrètes, des plus anodines
aux plus inquiétantes.
La troisième raison, enfin,
de ce désarroi moral, tient
au caractère unidimen-
sionnel que l’Etat et le parti
cherchent à imprimer au
pays. L’économisme règne
en maître et s’il est imposé
aux Chinois avec plus de
subtilité et de force aujour-
d’hui qu’à l’époque du
« Grand bond en avant »;
il n’en limite pas moins
étroitement l’horizon de
tous. Sortir de la recherche de la
croissance économique et du culte
du marché n’est pas accepté, aucune
expérience spirituelle ou politique
collective n’est vraiment autorisée.
La secte Falungong est violemment
persécutée, l’église catholique n’est
tolérée que rattachée à un Etat inca-
pable de la contrôler, l’expérience
artistique est étroitement surveillée,
l’expression d’un libéralisme poli-
tique est éminemment suspecte…
Comment l’âme chinoise pourrait-
elle retrouver des racines si l’ex-
périmentation spirituelle est à ce
point bridée, voire persécutée ?
Cependant, l’individu a encore la
possibilité de mener une vie spiri-
tuelle et intellectuelle autonome,
mais à condition de le faire de façon
strictement isolée. Si l’on pense aux
années sombres de la révolution et
à celles qui ont suivi les événements
de la place Tien An-men, cette
dimension de la liberté individuelle
est un bien extraordinairement pré-
cieux, dont les Occidentaux auraient
tort de sous-estimer la valeur. Mais
il est clair que cette forme de liberté
n’est pas suffisante pour permettre
de refonder une société authenti-
quement chinoise.
LE MENSONGE COMME
VALEUR SOCIALE
Tous les niveaux de la société
sont touchés par cette crise
morale qui prend des formes mul-
tiples et complexes. Trois d’entre
elles méritent une atten-
tion plus particulière.
Le « mensonge » reste
aujourd’hui encore,
comme aux périodes les
plus sombres de la révolu-
tion, une des pratiques
structurantes de la poli-
tique chinoise. Plus grave
encore, ce mensonge, qui
fait partie de la vie quoti-
dienne, est connu et
reconnu. Il peut même
s’élever au rang de valeur
sociale puisque la vérité
n’est tout simplement pas suppor-
table. « La vérité est morte » pour
reprendre le titre d’une pièce d’Em-
manuel Roblès. De ce fait, comme
les jeunes le confessent, la Chine
moderne ne possède plus de morale
sociale autonome. L’éthique confu-
ASIE
La fusion
opérée par
la révolution
communiste
entre l’Etat
et les
intellectuels
n’a été
qu’une
macabre
contrefaçon.
L’éthique
confucéenne
du respect et
de la
modération a
été foulée
aux pieds et
n’a jamais
été vraiment
remplacée.

29
Sociétal
N° 41
3etrimestre
2003
CHINE : DERRIÈRE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE, LA CRISE MORALE
céenne du respect et de la modé-
ration a été foulée aux pieds et n’a
jamais été vraiment remplacée. Elle
ne subsiste que sous des
formes étriquées : l’impé-
ratif de la croissance éco-
nomique et du rattrapage
la fait tomber dans l’oubli.
Mais les dernières grandes
crises ont montré l e s
conséquences désastreuses
de ce déni de vérité : la cor-
ruption explose partout, y
compris dans les organes
dirigeants de l’Etat, du parti
et des collectivités locales ;
plusieurs millions de pay-
sans ont été contaminés par
le Sida parce que l’Etat n’a
pas voulu reconnaître en
temps utile une défaillance
grave ; plusieurs milliers de
personnes ont été vrai-
semblablement infectées
par le Sras (« pneumonie
atypique ») pour préserver
un secret d’Etat. De plus, la
norme rigide de l’enfant unique,
imposée aux Chinois Hans, risque
de devenir une bombe à retarde-
ment démographique et ethnique
sans précédent dans l’histoire du
pays.
A l’occasion de chacun de ces men-
songes, des individus sont délibé-
rément sacrifiés à la raison d’un Etat
qui refuse catégoriquement de
reconnaître qu’il est faillible, comme
tous les autres Etats du monde.
Etant données la taille de la Chine
et l’ampleur des problèmes qui doi-
vent être arbitrés, cet aveuglement
conscient risque de coûter de plus
en plus cher au pays, au fur et à
mesure que les relations sociales
vont devenir plus denses et plus ten-
dues, du fait du développement éco-
nomique.
DU NIHILISME AU
NATIONALISME
La vérité n’est pas seulement
morte dans les relations sociales,
elle l’est aussi au plus profond de
l’âme chinoise. Ce qui frappe le plus
dans les conversations avec les jeunes
générations ou dans la lecture des
romans récents, c’est l’ab-
sence totale de sens donné
à la vie, que cette absence
s’exprime dans une vision
convenue et stéréotypée
de l’existence ou qu’elle
soit explicitement postu-
lée. La banalité d’une
société exclusivement mar-
chande, le consumérisme
effréné, l’affairisme et la
corruption constituent les
aspects les plus visibles de
ce manque. Le désespoir
des jeunes générations,
l’augmentation du nombre
des suicides, la libération
sexuelle incontrôlée et le
Sida, l’abrutissement dans
la drogue, en constituent
l’autre face, moins immé-
diatement perceptible par
le voyageur.
Le succès de la culture dite
« populaire », qui défend des valeurs
ouvertement anti-intellectuelles et
mafieuses,
à l’instar du romancier à suc-
cès Wang Shuo, illustre bien
les angoisses d’une société
déboussolée. Ni l’Etat ni
le parti ne sont en mesure
d’offrir des références
stables aux individus. La cor-
ruption, qui mine autant les
institutions que les indivi-
dus, est devenue un phéno-
mène totalement endogène
au système, et les autorités
chinoises sont parfaitement
conscientes de leur incapa-
cité à la combattre sérieu-
sement sans se remettre
elles-mêmes en cause.
Face à ce vide individuel et institu-
tionnel, ressurgit un courant natio-
naliste qui ambitionne de redonner
une raison d’espérer à la société chi-
noise. C’est ainsi qu’a paru, au milieu
des années 90, un ouvrage collectif
au titre provocateur, « La Chine peut
dire non », inspiré de l’ouvrage d’ex-
trême droite japonais « Le Japon peut
dire non ». Ce nationalisme, qu’il
prenne la forme d’un retour à
Confucius, d’une idéologie sécuri-
taire ou d’une nouvelle gauche éta-
tiste, ne constitue qu’une autre
forme de fuite en avant. Mais il pour-
rait se révéler dangereux, notam-
ment pour les voisins de la Chine –
on peut évoquer à ce sujet, à titre
de comparaison, les avatars sanglants
du panslavisme en Serbie. C’est pro-
bablement l’échappatoire dont la
Chine a le moins besoin aujourd’hui.
DES VOIES DE SORTIE
DANGEREUSES
Les négociations de l’OMC ont heu-
reusement montré qu’il était pos-
sible, au nom de la raison économique
et politique, de reléguer le nationa-
lisme dans l’arrière-boutique. Mais il
ne faut pas s’y tromper : le risque le
plus dangereux qui guette aujourd’hui
la Chine est bien là, un risque peut-
être plus redoutable que celui de l’af-
fairisme, dont les limites morales et
intellectuelles sont évidentes.
Ainsi, au-delà des appa-
rences d’une transition pro-
gressive, dont il ne faut pas
sous-estimer les aspects
très positifs sur les plans
économiques et humains,
la Chine semble confron-
tée à une profonde crise
morale dont il n’est pas sûr
qu’elle soit elle-même plei-
nement consciente. Cette
crise aux racines et aux
manifestations multiples lui
suggère insidieusement de
dangereuses voies de sor-
tie : des difficultés écono-
miques un peu sévères
ou des scandales répétés
pourraient brutalement dégénérer
en secousses dévastatrices, sous la
pression de tendances autodestruc-
trices ou impérialistes. Les périodes
de changement rapide sont aussi des
périodes de fragilité : toute erreur
d’appréciation politique, même
mineure, peut avoir des conséquences
en chaîne. Les réformes ne doivent
L’envers de
cette société
exclusivement
marchande,
c’est le
désespoir des
jeunes
générations,
l’augmentation
du nombre des
suicides, la
libération
sexuelle
incontrôlée,
le Sida,
la drogue…
Des difficultés
économiques
un peu
sévères ou
des scandales
répétés
pourraient
brutalement
dégénérer en
secousses
dévastatrices.
1
/
4
100%