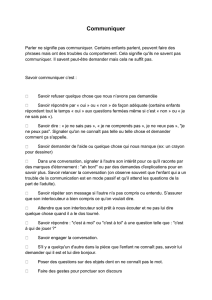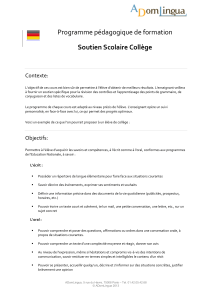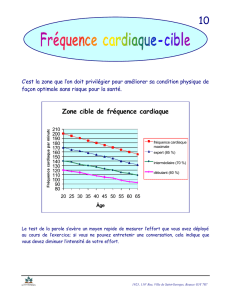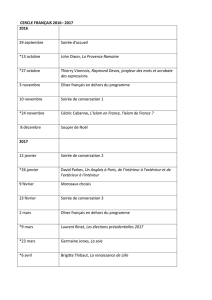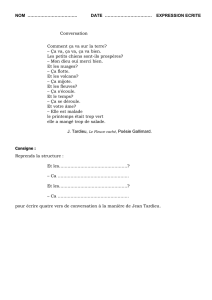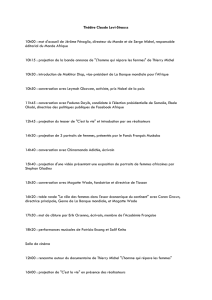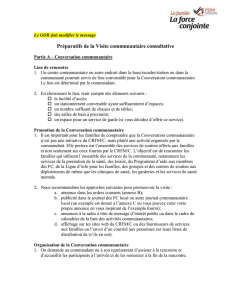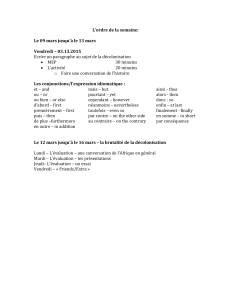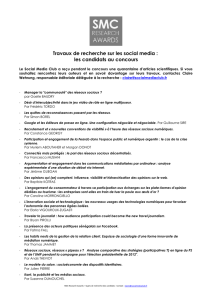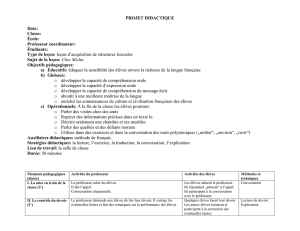La communication revisitée par la conversation

Communication & langages
http://www.necplus.eu/CML
Additional services for Communication &
langages:
Email alerts: Click here
Subscriptions: Click here
Commercial reprints: Click here
Terms of use : Click here
La communication revisitée par la conversation
Valérie Patrin-Leclère
Communication & langages / Volume 2011 / Issue 169 / September 2011, pp 15 - 22
DOI: 10.4074/S0336150011003024, Published online: 10 November 2011
Link to this article: http://www.necplus.eu/abstract_S0336150011003024
How to cite this article:
Valérie Patrin-Leclère (2011). La communication revisitée par la conversation.
Communication & langages, 2011, pp 15-22 doi:10.4074/S0336150011003024
Request Permissions : Click here
Downloaded from http://www.necplus.eu/CML, IP address: 88.99.70.218 on 17 Apr 2017

15
DOSSIER
VALÉRIE PATRIN-LECLÈRE
La communication
revisitée par la
conversation
La communication est à ce point revisitée par la conversation que le
substantif « conversation » agrémente aujourd’hui des pratiques si diverses
qu’on peut se demander ce qu’il désigne vraiment. Récent indice de cette
expansion « conversationnalisante », le fait qu’en juin 2011, le salon du
design à Paris est baptisé « Conversations »1. Les explications fournies par
les organisateurs sont révélatrices du caractère particulièrement accueillant
conféré à cette thématique : « Il n’est rien de plus passionnant que
d’échanger, d’écouter et de se nourrir des apports de l’autre »2 ;«un
objet de design n’est-il pas la traduction exacte d’une conversation entre
un designer, un éditeur, et un industriel ou un commerçant ? »3 ;«il
sera question de notre relation quasi fusionnelle avec les aspirateurs,
lave-linge, réfrigérateurs, cafetières et autres appareils domestiques dont
nous peuplons nos intérieurs »4. Ladite conversation regroupe tout à la fois
les métadiscours croisés des professionnels du design sur leur occupation
commune, les contributions des professionnels parties prenantes d’une
même production et les échanges muets entre les objets du design et leurs
utilisateurs. Le champ conversationnel en devient si vaste qu’il accueille des
1. Designer’s Days, du 16 au 20 juin 2011 : expositions, ateliers créatifs, tables rondes, organisés par une
association d’entreprises et de créateurs.
2. Alain Lardet, président de Designer’s Days, sur le site designersdays.com, édito de l’édition 2011
(consulté le 1er juillet 2011).
3. Ibid.
4. Article de M élina Gazsi, « Design : un parcours sur le thème des Conversations », Le Monde pour
Direct Matin, 16 juin 2011.
communication & langages – n◦ 169 – Septembre 2011

16 La communication revisitée par la conversation
échanges ni verbaux ni même verbalisables ; car aussi bien conçue soit-elle,
une chaise ne saurait parler à celui qui s’en sert.
À l’image du fauteuil éponyme inventé au XVIIe siècle pour faciliter les
confidences (deux p laces assises tête-bêche), la « conversation » apparaît
ici telle une mise en condition, un dispositif caractérisé par l’intention
de favoriser la communication entre les possibles participants. Le terme
désigne donc tout à la fois un imaginaire et une pratique possible sans être
nécessairement avérée, dans la mesure où le dispositif préexiste et surv it à
l’usage qui pourrait en être fait. Le fauteuil « conversation » garde son nom
et sa r aison d’être quelle que soit la pratique à laquelle s’adonnent ceux
qu’il accueille : on peut s’y asseoir sans converser, on peut même ne pas s’y
asseoir, la « conversation » demeure.
Ce dossier analyse et discute la notion de « conversation », très répandue
aujourd’hui parmi les professionnels du marketing. Il a pour objectif de
faire parler cette « conversation » qui prétend parler partout et tout le
temps, de la saisir pour mieux comprendre ce dont cet usage florissant est le
symptôme. La cristallisation dans un terme partagé, quasiment consensuel
chez les professionnels de la communication et du marketing, en France
mais aussi en Europe et en Amérique du Nord, offre l’occasion de capter l es
intentions de ses promoteurs. À cette pér iode où la circulation d’idées se fige
en un terme porte-drapeau, les traits du masque se dessinent, le mouvement
donne à voir en même temps sa forme et son sens – dans les deux sens du
terme, c’est-à-dire tant ce qu’il désig ne que l’intention qui le motive.
Le règne de la « conversation » nous renseigne sur les métamorphoses
de la communication d’entreprise (les pratiques des professionnels des
marques et des médias ainsi que celles des consultants qui les conseillent),
mais aussi sur les (auto)représentations effectives et rêvées de la com-
munication en tant que secteur économique. Substituer « conversation »
à « communication » n’est pas un simple effet de style, même si la
« conversation » est dans la plupart des cas métaphorique : toute situation
de communication dans laquelle le destinataire est susceptible d’interagir
tendant à être recatégorisée comme conversationnelle, les distorsions entre
ce qu’est censée être une « conversation » du point de vue de la linguistique
et des sciences de l’information-communication et ce qui est désigné
comme tel dans le champ de la communication organisationnelle sont
manifestes. Mais là n’est pas l’essentiel dans le projet qui anime ce dossier.
Ce qui nous importe principalement, c’est de comprendre pourquoi ce
terme « conversation » suscite un tel engouement : il s’agit d’interroger à
la fois la nouvelle donne dans les pratiques de communication médiatisée,
les liens de causalité entre adaptation des stratégies de communication
communication & langages – n◦ 169 – Septembre 2011

Introduction 17
des organisations et apparition d’un concept érigé en paradigme, enfin la
perméabilité entre modélisations professionnelles et théorisation à visée
scientifique. Nous cherchons à interpréter cette montée en visibilité de
la « conversation », à la démonter non pas pour la dénoncer mais pour
la discuter. La conversation est une représentation de la communication.
Au-delà des fausses évidences, qu’est-ce que converser veut dire ?
Que la « conversation » soit un faux ami ne signifie pas qu’elle ne
veut rien dire. On ne peut pas nier, en effet, l’existence d’un phénomène
consécutif à l’informatisation des moyens de communication : la possibilité
élargie pour chacun de s’exprimer et de contacter d’autres personnes. Pas
plus qu’on ne doit sous-estimer la nécessité (et la difficulté) dans laquelle
se trouvent les professionnels de la communication d’adapter leurs outils et
stratégies à cette capacité des consommateurs à médiatiser leurs avis. Nous
voulons discuter l’usage proliférant de la « conversation » tout en tenant
pour indéniable que le contexte est spécifique et irréductible à la situation
médiatique préexistante.
Toute la complexité de la notion tient dans le fait qu’elle désigne
des mutations importantes irréfutables... et qu’en les qualifiant elle est
l’instrument d’une mutation autoprédictive. Dire que la communication
se mue en « conversation », c’est prétendre que la communication se
débarrasse du marketing au moment même où son emprise est la
plus aboutie. Car outre le fait que le « marketing conversationnel »
réfère à une nouvelle donne technologique, sociologique et économique,
sa dénomination est la trace d’un maquillage destiné à revaloriser
symboliquement des pratiques à visée marchande.
Se saisir du « marketing conversationnel » amène à dérouler un
écheveau de problématiques fondamentales : célébrer l’avènement de la
« conversation », c’est récuser le modèle reliant u n énonciateur et un
destinataire pour mettre en scène des co-énonciateurs perpétuellement à
égalité dans un échange idéalement symétrique. Dans le même mouvement,
c’est dénoncer les médias au nom de leur principe de communication
« descendant » pour leur opposer des médias « sociaux » ; le média social
serait donc horizontal et le média traditionnel non social. Le « marketing
conversationnel » peut être interprété comme l’indice d’une société en
mal-être, inquiète de son devenir socioculturel et économique. C’est un
discours qui tout à la fois réfute les fondamentaux du marketing (des
marques qui construisent une image et la déclinent dans une perspective
marchande) et en naturalise le bien-fondé. La n otion de « conversation »
ancre la fameuse « demande » : les conversations sont en effet faites en partie
de questions et de réponses, qui prolongent et entérinent l’imaginaire de
communication & langages – n◦ 169 – Septembre 2011

18 La communication revisitée par la conversation
l’offre et de la demande. Or si l’existence de l’offre relève de l’évidence, celle
de la demande est bien plus complexe ; il y a des consommateurs, peut-être
des publics... mais la demande est-elle autre chose qu’une construction
et une justification théor ique ? Que les consommateurs achètent des
produits et des services suffit-il à prouver qu’ils les ont à proprement parler
demandés ? Dans une certaine mesure, présupposer que les marchés sont des
conversations règle le problème... en le supprimant : la demande est une
question posée à une marque-entreprise qui apporte la réponse adéquate.
Revenons à nos bancs tête-bêche, ces fameux objets facilitateurs de
communication. Dans le « marketing conversationnel » comme dans ces
auto-désignés objets de mise en conversation du XVIIe siècle, c’est le
dispositif qui est censé faire la conversation. La mise en condition suffit à
qualifier la situation. Le dispositif serait performatif, la performativité ferait
la performance.
Je t’autorise à converser, donc la situation est une conversation, donc
tu es un « conversateur » qui participe à la nouvelle donne communi-
cationnelle. Le principe est à la fois simple et risqué. Les promoteurs du
« marketing conversationnel » se comportent en apprentis alchimistes.
Ils voudraient faire des médias informatisés l’athanor dans lequel la
noire communication se muerait en or conversationnel, en passant par
le rouge participatif5. Les évangélistes d’Internet sont décidément pleins
de ressources. Les usagers se prendront-ils au jeu durablement... ou en
viendront-ils à reprocher aux nouveaux prédicateurs d’avoir tenté de leur
faire avaler leurs œufs d’or à n’importe quel prix, en profitant de la si
déculpabilisante gratuité, justement parce qu’il n’y a apparemment pas de
prix à payer ?
Ce dossier décortique des discours, des pratiques et des productions.
Il ne délivre pas un point de vue que les six auteurs partageraient de
manière consensuelle. La complexité du sujet se révèle dans leurs éclairages
complémentaires. Deux questionnements sont articulés : l’un, large, porte
sur la montée en force des d iscours sur le « marketing conversationnel ».
L’autre, plus spécifique et enchâssé dans le premier, traite des conséquences
de cette nouvelle situation sur le « contrat de lecture », qui reste très usité
dans les méthodologies d’étude tout en étant plus discutable que jamais.
Ce dossier est une manière de prolonger un article qu’Yves Jeanneret et
Valérie Patrin-Leclère ont consacré en 2004 au « contrat de lecture »6.Cette
5. L’athanor est le fourneau dans lequel les alchimistes transformeraient les métaux en or, en passant
symboliquement et successivement par le noir, le blanc, le rouge.
6. Yves Jeanneret et Valérie Patrin-Leclère, « La métaphore du contrat », Hermès, 38, 2004.
communication & langages – n◦ 169 – Septembre 2011
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%