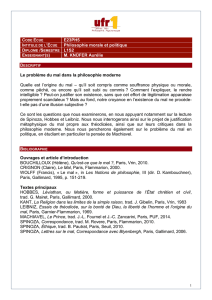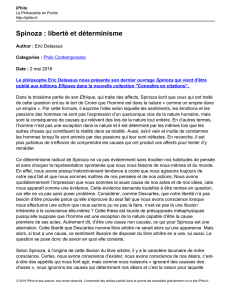Université de Montréal L`idée de liberté politique chez Spinoza par

Université de Montréal
L’idée de liberté politique chez Spinoza
par
Richard Jacob Pierre
Département de philosophie
Faculté des Arts et Sciences
Mémoire présenté à la Faculté des Arts et Sciences
en vue de l’obtention du grade de maitrise
en philosophie, option recherche
Septembre 2014
© Richard Jacob Pierre, 2014

Université de Montréal
Faculté des Arts et Sciences
Ce mémoire intitulé :
L’idée de liberté politique chez Spinoza
Présenté par :
Richard Jacob Pierre
Évalué par un jury composé des personnes suivantes :
Christian Nadeau, directeur de recherche
Daniel Dumouchel, président-rapporteur
Michel Seymour, membre du jury

Résumé
Chez Spinoza, la politique se construit essentiellement sur les bases de l'édifice de la
liberté. En effet, la liberté se vit sous une forme institutionnelle, c'est-à-dire comme le
dit Alain Billecoq, «à travers des lois qui garantissent sa stabilité et sa pérennité»
(Billecoq, p. 132). Cela devrait donc exclure normalement toute éventualité de conflit
entre les pouvoirs politiques et la liberté des individus. D’autant que l’État puise son
fondement dans les droits et libertés qu’il se doit de garantir à ses citoyens. Autrement
dit, on devrait supposer qu’il y a une certaine adéquation du pouvoir de l’État et de la
liberté des individus. Or, ce n’est pas toujours le cas. Car de l’avis de certains, liberté et
pouvoir de commandement ne sont pas tout à fait compatibles. Comment donc rendre
possible une cohabitation de l’État comme organe de contrainte et de régulation, et de
la liberté des individus, qui semble pourtant nécessaire? En passant par sa conception
du droit naturel, de l’état de nature et de l’État, il sera démontré au terme de notre
démarche que ce qui permet chez Spinoza la résolution de cette tension entre le
pouvoir de l’État et la liberté des individus n’est rien d’autre que la démocratie.
Mots-clés : Philosophie politique, Spinoza, liberté politique, droit naturel, État,
démocratie
Abstract
For Spinoza, politics is made on the foundations of the edifice of freedom. Indeed,
freedom is considered as an institutional form. Then, it is lived as Alain Billecoq says
“through laws that guarantee stability and continuity”. This should normally exclude any
possibility of conflict between the power of the Palace and people freedom. Especially
as the State draws its fundaments in the rights and freedoms that it’s supposed to
guarantee to its citizens. In other words, they would believe that there’s a certain
balance of power of the State and freedom of individuals. But, it’s not always that which
is happening. So for several people, freedom and power of command are not quite

compatible. Then, how to make possible this coexistence of the state as an organ of
control and coercion, and the freedom of individuals, which seems to be necessary?
Following his opinion about the right natural, the natural state and the civil state, it will
be proved with Spinoza at the end of our approach that this tension between state
power and people freedom is resolved thanks to the democracy.
Keywords: Political philosophy, Spinoza, political freedom, natural right, State,
democracy

Table des matières
Introduction ....................................................................................................................... vii
Chapitre I .......................................................................................................................... 11
Les pionniers de Spinoza .................................................................................................. 11
1-Machiavel et sa conception réaliste de l’État ............................................................. 12
1.1- La vérité effective de la chose ............................................................................ 13
1.2- Le couple Virtù-fortuna (et le principe de liberté politique) chez Machiavel .... 16
1.3- L’importance du conflit au sein de l’État machiavélien ................................... 20
2- Hobbes et la souveraineté absolue du Léviathan ...................................................... 23
2.1-L’état de nature et le droit naturel chez Hobbes .................................................. 24
2.2-Le contrat social et la formation de l’État hobbesien .......................................... 29
2.3-Hobbes et le principe de souveraineté ................................................................. 31
Chapitre 2 .......................................................................................................................... 34
Les affects, l’état de nature et le droit naturel chez Spinoza ............................................ 34
1-Les affects .................................................................................................................. 34
1.1-Les affects et l’individualité ................................................................................ 36
1.2-Les affects et l’état de nature ............................................................................... 37
1.3-Les affects et la thèse spinoziste de la sociabilité .............................................. 42
2- Droit naturel et loi naturelle au sein de l’état de nature. ........................................... 51
3- La loi naturelle et les limites du droit naturel ........................................................... 54
Chapitre 3 .......................................................................................................................... 57
La constitution de l’État chez Spinoza .............................................................................. 57
1-Le transfert du droit naturel (ou passage de l’état de nature à l’État) ........................ 58
2- La souveraineté de l’État .......................................................................................... 66
2.1-La souveraineté de l’État et l’obéissance des individus ...................................... 71
2.2-La souveraineté de l’État face à la liberté des individus ..................................... 77
Chapitre 4 .......................................................................................................................... 83
Les régimes politiques chez Spinoza ................................................................................ 83
1-La monarchie ............................................................................................................. 84
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
1
/
119
100%