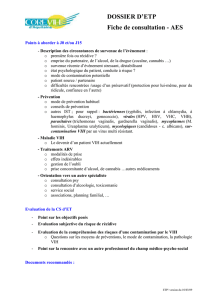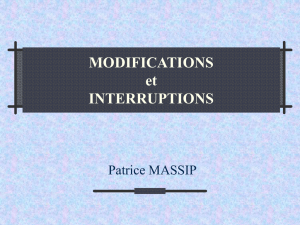Perspectives vaccinales à visée préventive ou thérapeutique anti-VIH

Revue critique
de l'actualité scientifique internationale
sur le VIH
et les virus des hépatites
n°100 - avril-mai 2002
Perspectives vaccinales à visée préventive
ou thérapeutique anti-VIH : 10 ans de
recherche mais jusqu'où ?
Gilles Pialoux
Hôpital Tenon (Paris)
Laurence Weiss
service d'immunologie clinique, Hôpital européen Georges Pompidou, Paris
Même si ces dix dernières années ont connu des avancées
tangibles tant dans le décryptage des mécanismes de la
reconstitution immunitaire que dans la mise en évidence de
propriétés structurelles et fonctionnelles du VIH jusque-là
inconnues, il n'existe pas, en cette année 2002, de vaccin contre
le sida. L'ultime objectif d'un vaccin est de protéger contre la
contamination. Néanmoins, dans le cas de l'infection à VIH, des
vaccins qui permettraient de diminuer notablement la charge
virale VIH en cas d'infection et donc la transmissibilité de
l'infection virale et la survenue d'une maladie sida ne peuvent
être complètement écartés, compte tenu des difficultés
rencontrées pour induire une immunité dite "stérilisante".
Parmi les obstacles rapportés comme s'opposant à la quête d'un
vaccin efficace contre le VIH figure l'absence d'immunité
naturelle ou acquise, associée à une protection, qui constituerait
un modèle que l'on pourrait tenter de reproduire avec un virus
atténué ou tué, ou des sous-unités recombinantes. Parce qu'il
était inutile, voire illusoire, de reproduire la réponse immune
naturelle incapable, dans l'immense majorité des cas, d'éradiquer
le VIH, il a fallu disséquer cette réponse immune, à commencer
par la cartographie des épitopes, ces éléments clés de l'antigène,
impliqués aussi bien dans l'activation des lymphocytes T CD4
helper que des cellules B et des lymphocytes T cytotoxiques. Ce
Perspectives vaccinales à visée préventive ou thérapeutique anti-VIH : 10 ans de recherche mais jusqu'où ?
http://publications.crips.asso.fr/transcriptase/100_1399.htm (1 sur 8) [21/02/2003 11:18:39]

travail a été un préalable aux essais conduits dans différents
modèles animaux, primates ou non primates, et chez l'homme.
La longue marche vers un vaccin préventif
Malgré une connaissance rapide des différents épitopes T et B,
importants dans l'induction des réponses immunes anti-VIH, la
progression des essais vaccinaux a, depuis le début des années
1990, essentiellement suivi une démarche empirique. C'est ainsi
que la plupart des premiers essais, animaux ou humains, se sont
centrés sur l'obtention d'une réponse anticorps par l'utilisation
d'antigènes d'enveloppe. Il n'a pas été possible de démontrer,
chez l'homme, l'existence d'une corrélation entre des réponses
anticorps ou cellulaires (CD4 ou CD8) obtenues suite à une
immunisation et une protection contre l'infection VIH. Dans les
modèles animaux néanmoins, il a pu être rapporté un seuil en
termes de titres d'anticorps neutralisants nécessaires à la
protection de l'animal lors d'une épreuve d'infection
expérimentale.
Idéalement, dans un modèle vaccinal, une réponse anticorps ou
une réponse cellulaire devrait être croisée vis-à-vis des souches
sauvages du virus à fortiori celles présentes dans une zone
géographique où le vaccin devrait être prioritairement
disponible. Il existe, chez la plupart des personnes infectées par
le VIH, une forte réponse anticorps anti-gp 120 mais une très
faible réactivité croisée.
En ce qui concerne la réponse immune cellulaire, une réponse T
proliférative croisée suite à la stimulation par des peptides V3
provenant de plusieurs souches sauvages a été observée chez des
patients VIH+. Il en est de même pour des réponses cytotoxiques
et des réponses cellulaires associées à la libération de facteurs
solubles type chimiokines. Plusieurs travaux suggèrent qu'il
existe, notamment sur la protéine Gag, des épitopes qui
induisent une réaction croisée envers des souches extrêmement
divergentes.
Un des objectifs essentiels de la vaccination est d'obtenir des
réponses immunes, qu'elles soient T ou B, dirigées contre de
nombreux épitopes du VIH, ces réponses immunes
polyépitopiques étant beaucoup plus efficaces que des réponses
restreintes à un petit nombre d'épitopes.
La discussion entre la nécessité d'une réponse anticorps
(neutralisante ou dite "stérilisante") et celle d'une réponse
cellulaire (T et B) est encore d'actualité.
En dix ans, un relatif consensus s'est établi sur le pré-requis en
matière de candidat-vaccin anti-VIH qui pourrait être évalué
dans un essai de phase III :
réaction muqueuse (IgA, CTL...)
Perspectives vaccinales à visée préventive ou thérapeutique anti-VIH : 10 ans de recherche mais jusqu'où ?
http://publications.crips.asso.fr/transcriptase/100_1399.htm (2 sur 8) [21/02/2003 11:18:39]

ou
réponse CTL
ou
anticorps neutralisants
Avec une réponse immune induite qui soit franche, croisée,
polyépitopique, efficace sur des isolats primaires, mémoire,
reproductible dans le temps et d'un individu à l'autre, applicable
industriellement à un coût raisonnable, et sans effet délétère
majeur, sans réponse anticorps facilitante - même si cette notion
reste imprécise.
L'étude des mécanismes de protection selon différents modèles
vaccinaux a montré l'importance de la réponse des cellules T,
que ce soit sous la forme d'une activité cytotoxique (CTL) ou de
la sécrétion des facteurs solubles suppresseurs de la réplication
virale (principalement les chimiokines).
Depuis les premiers essais vaccinaux, qui ont coïncidé avec les
premiers numéros de Transcriptase (1992), plus de 80 essais de
phase I-II ont été menés dans le monde, dont une douzaine dans
les pays en développement. En France, des essais vaccinaux
utilisant des lipopeptides VIH ont été privilégiés avec des
résultats encourageants en termes de réponse CD8
polyspécifique. Deux essais de phase III sont actuellement en
cours (Etats-Unis et Thaïlande) avec des candidats-vaccins de
première génération ciblés sur les protéines d'enveloppe.
Les résultats dont on dispose à l'heure actuelle suggèrent que
proposer une stratégie de première immunisation ("prime") avec
un immunogène donné et faire ensuite un rappel ("boost") avec
un second immunogène pourrait constituer une option
intéressante.
Le tableau 1 résume les différents candidats vaccins susceptibles
d'atteindre les essais de phase III. Les combinaisons
d'immunogènes sont multiples si l'on adopte le modèle de
prime-boost. Parmi les combinaisons possibles figurent, en essai
clinique I/II pour les années 2002-2005 :
- lipopeptides + ALVAC,
- ADN (B) + Adénovirus (B)
- ADN + MVA
- MVA + fowlpox (B)
- ADN + peptides
- ADN + ALVAC
- ADN B + IL-2 ADN
- ADN + lipopeptides...
Depuis ses premiers balbutiements, il y a dix ans passés, la
recherche vaccinale anti-VIH a connu, pêle-mêle, des avancées
techniques et méthodologiques qui devraient bénéficier à bien
d'autres secteurs de la recherche médicale. Néanmoins,
Perspectives vaccinales à visée préventive ou thérapeutique anti-VIH : 10 ans de recherche mais jusqu'où ?
http://publications.crips.asso.fr/transcriptase/100_1399.htm (3 sur 8) [21/02/2003 11:18:39]

beaucoup de questions restent posées :
- Comment faire progresser la recherche clinique dès lors que le
meilleur modèle animal est l'homme ?
- Comment apprécier au mieux la réponse immune vaccinale
alors même que les techniques continuent d'évoluer rendant
difficiles les comparaisons d'un essai vaccinal à l'autre :
techniques d'évaluation de l'immunité muqueuse (IgA
sécrétoires, CTL), de la réponse CD4 (prolifération, ELISpot) et
de la réponse CD8 (relargage du chrome, tétramère, ELISpot) ?
- Comment améliorer la réponse immune : méthode du
prime-boost, adjuvants (DC Chol, IL-2, IFA…), mode de
délivrance modifié (muqueux, pistolet intradermique) ?
- Comment améliorer le mode de délivrance du vaccin ?...
Tableau 1. Principaux candidats-vaccins* en piste
pour les essais pré-cliniques de phase III
* liste non exhaustive
protéines d'enveloppe recombinantes :
gp 120 monomérique ou oligomérique (++)
gp 120 - CD4 (B)
autres protéines virales :
p 55 gag (pseudoparticules),
toxine de l'anthrax + p 55 B
lipopeptides ++
vecteurs viraux :
vaccine (±)
canarypox (ALVAC)
vaccine atténuée modifiée Ankara (MVA) B, D, C, B/C...
vaccine NYVAC
follpox
flavivirus
picornavirus
adénovirus
"replicons" :
alphavirus
adenovirus + AAV
herpès virus
vecteurs bactériens atténués :
salmonelle
shigelle
listéria
BCG
vaccin ADN ++ (gag + pol, gag + pol + env + nef...)
d'après A. Schultz et J.A. Bradac, AIDS, 2001, 15, S147-S158
La vaccination à visée thérapeutique
Perspectives vaccinales à visée préventive ou thérapeutique anti-VIH : 10 ans de recherche mais jusqu'où ?
http://publications.crips.asso.fr/transcriptase/100_1399.htm (4 sur 8) [21/02/2003 11:18:39]

L'administration, depuis 1996, de traitements antirétroviraux
"hautement actifs" a permis de transformer l'évolution clinique
de l'infection par le VIH avec une réduction majeure du nombre
de décès liés au sida. Parallèlement à une amélioration clinique
spectaculaire, une reconstitution immunologique est observée,
avec notamment une augmentation significative des chiffres de
lymphocytes T CD4 sous trithérapie efficace sur le plan
virologique. L'administration d'antirétroviraux a ainsi permis
l'arrêt des prophylaxies anti-Pneumocystis carinii et anti-CMV
par exemple.
Toutefois, les traitements antirétroviraux ont un certain nombre
de limites :
- même si la charge virale plasmatique est réduite dans la
majorité des cas, du moins dans la première année de traitement,
en-dessous du seuil de détection, le réservoir de cellules
infectées de façon latente persiste et l'éradication virale apparaît
impossible avec les traitements antirétroviraux dont nous
disposons à l'heure actuelle ;
- une réplication virale persiste a minima et, de fait, la survenue
de résistance aux molécules antirétrovirales est fréquente.
Les limites des traitements antirétroviraux ont amené à proposer
des stratégies d'immunothérapie dans le but d'intensifier la
reconstitution immunitaire, de favoriser ainsi la participation du
système immunitaire au contrôle de la réplication virale et de
permettre, en conséquence, une épargne de traitements
antirétroviraux. On distingue des stratégies d'immunothérapie
non spécifique parmi lesquelles l'administration de cytokines
(non abordées ici), et des stratégies d'immunothérapie
spécifique, appelée encore vaccination thérapeutique.
L'immunothérapie spécifique vise à réinduire des réponses
immunes cellulaires CD4 et CD8 anti-VIH chez des sujets
contrôlés au plan virologique sous antirétroviraux chez lesquels
la diminution de l'exposition au VIH est associée à une
diminution du nombre de CTL spécifiques anti-VIH et à
l'absence de restauration de la réactivité des lymphocytes T CD4
spécifiques. Il a, en effet, été montré que les réponses
prolifératives CD4 anti-protéine p24 du VIH étaient conservées
chez les sujets non-progresseurs à long terme et chez les sujets
traités avec succès en phase aiguë de primo-infection ; par
contre, ces réponses sont, dans la plupart des cas, non
détectables (selon la sensibilité de la technique) chez les sujets
non traités en primo-infection ou traités en phase chronique de
l'infection.
La fréquence des lymphocytes T CD8 spécifiques du VIH
diminue avec la suppression virale. Plusieurs observations ont
démontré le rôle important des lymphocytes T CD8 dans le
Perspectives vaccinales à visée préventive ou thérapeutique anti-VIH : 10 ans de recherche mais jusqu'où ?
http://publications.crips.asso.fr/transcriptase/100_1399.htm (5 sur 8) [21/02/2003 11:18:39]
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%