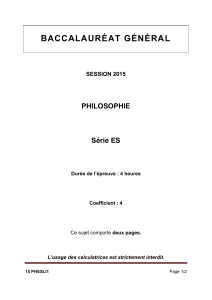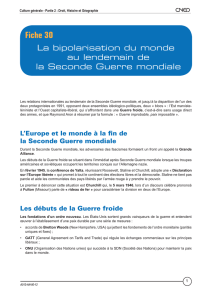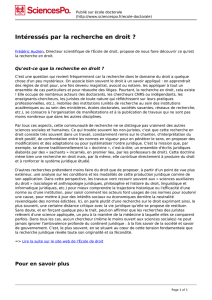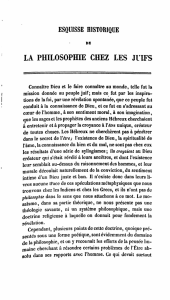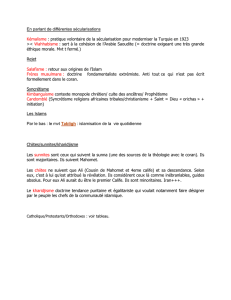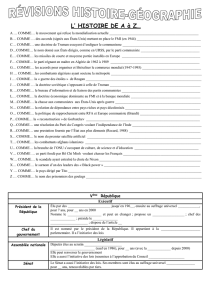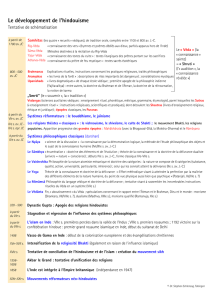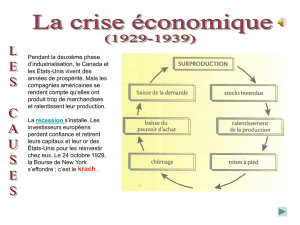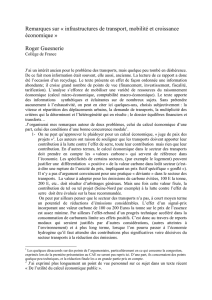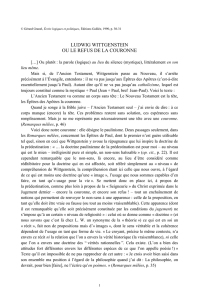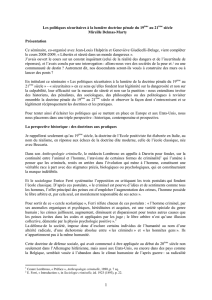table des matières

TABLE DES MATIÈRES
PARTIE 1 – LES COMPOSANTES
LA DOCTRINE ENTRE PENSÉE DES AUTEURS
ET COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
I QUEL STATUT POUR LA DOCTRINE AFRICAINE
FRANCOPHONE? ........................................................................................ 7
par Jean du Bois de Gaudusson
I LE STATUT ORGANIQUE : AUTEURS OU DOCTRINE? .................
II LE STATUT FONCTIONNEL : UN MOMENT HISTORIQUE
POUR LA DOCTRINE EN AFRIQUE FRANCOPHONE ...................
III LE STATUT MATERIEL :
LES DEFIS LANCES A LA DOCTRINE ..................................................
II ARRÊT SUR UN OJNI : LA DOCTRINE JURIDIQUE
EN AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE .................................................. 15
par Aboudramane Ouattara
I L’ IMPROBABLE ACCESSIBILITE DE LA DOCTRINE JURIDIQUE
NOIRE AFRICAINE FRANCOPHONE ..................................................
A. Un accès hypothétique .................................................................
B. Une visibilité incertaine ...............................................................
II L’ INTROUVABLE SINGULARITE DE LA DOCTRINE JURIDIQUE
AFRICAINE NOIRE FRANCOPHONE ..................................................
A. De l’ imperceptible spécicité… .................................................
B. Vers un essai de modélisation .....................................................
III LA DOCTRINE ÉCONOMIQUE :
UN CAPITAL HUMAIN? ............................................................................ 33
par Bédia François Aka
INTRODUCTION ..............................................................................................
I LA DOCTRINE ECONOMIQUE TRADITIONNELLE :
UN FREIN AU DEVELOPPEMENT DES PAYS AFRICAINS
FRANCOPHONES .......................................................................................
DOESAF-BAT.indd 403 29/10/14 17:04

TABLE DES MATIÈRES
A. Les fondements de la doctrine économique traditionnelle .....
1. Les classiques et les keynésiens ...............................................
2. Les néoclassiques et les néokeynésiens ...................................
B. Les résultats de l’ application de la doctrine traditionnelle en
Afrique francophone ....................................................................
1. Au plan macroéconomique .....................................................
2. Au plan microéconomique ......................................................
II LE RENOUVELLEMENT DE LA DOCTRINE ECONOMIQUE :
UN ATOUT POUR LE DEVELOPPEMENT DES PAYS AFRICAINS
FRANCOPHONES .......................................................................................
A. L’ économie de l’ innovation et la nouvelle économie des
institutions .....................................................................................
1. L’ économie de l’ innovation .....................................................
2. La nouvelle économie des institutions ...................................
B. Le modèle doctrinal .....................................................................
1. La structure du modèle ...........................................................
2. L’ équilibre du modèle ..............................................................
CONCLUSION ....................................................................................................
RÉFÉRENCES .....................................................................................................
IV LA SÉDIMENTATION D’ UNE COMMUNAUTÉ DE
CONNAISSANCE AU CŒUR DE L’ ACTION PUBLIQUE.
UN NOUVEAU SOUFFLE VENU D’AFRIQUE? .................................... 59
par Nadine Machikou Ngameni
I UNE COMMUNAUTE DE CONNAISSANCE AU CŒUR D’ UNE
TENSION EPISTEMIQUE .........................................................................
A. La charge d’ une diculté principielle … ...................................
B. Entre démarche analytique et posture normative ....................
II UNE COMMUNAUTE DE CONNAISSANCE ANIMEE D’ UNE
VOLONTE PERFORMATIVE ...................................................................
A. La doctrine comme forme de récit sur le réel ...........................
B. Politiques publiques et performativité : dépolitiser le
politique .........................................................................................
DOESAF-BAT.indd 404 29/10/14 17:04

TABLE DES MATIÈRES
PARTIE 2 – LA FONCTION
DE LA STRUCTURATION DU DROIT AU DROIT À LA CRITIQUE
CHAPITRE 1 – UNE SOURCE DU DROIT
I LA MISSION CRÉATRICE DE LA DOCTRINE DE DROIT DES
AFFAIRES DANS L’ ESPACE OHADA ....................................................... 83
par Pierre Etienne Kenfack
I UNE MISSION A EXERCICE PEU VISIBLE ...........................................
A. Un exercice de la mission créatrice masquée par celui de
l’ activité de diusion ...................................................................
B. La rareté des travaux mettant en perspective les rêves
d’ auteurs ........................................................................................
II UNE MISSION A EXERCICE DEVANT ETRE VU ..............................
A. Les contraintes de la suggestion .................................................
B. L’ intérêt pour l’ exercice de la mission créatrice de la doctrine
de droit des aaires OHADA à être vue ....................................
CONCLUSION ....................................................................................................
II LE RÔLE DE LA DOCTRINE DANS L’ ÉDIFICATION D’ UN DROIT
DES SURETÉS OHADA ............................................................................... 95
par Mohamed Bachir Niang
INTRODUCTION ..............................................................................................
I LE CONTENU DE L’ ACTIVITE DOCTRINALE EN DROIT DE
SURETES .......................................................................................................
A. La recherche d’ une cohérence interne du droit des sûretés ....
B. La sauvegarde d’ une cohérence externe du droit des sûretés .
II L’ INFLUENCE DE L’ ACTIVITE DOCTRINALE EN DROIT DES
SURETES .......................................................................................................
A. Une activité qui suscite une réaction législative et
jurisprudentielle ............................................................................
B. L’ absence de démarche prospective, manifestation d’ une
inuence atténuée .........................................................................
CHAPITRE 2 – LA CONSTRUCTION D’UN DISCOURS SAVANT
I LA DOCTRINE AFRICAINE ET LE JUS COGENS : RETOUR SUR UNE
NOTION LIVRÉE AUX TOURMENTS ..................................................... 113
par Abraham Gadji
I L’ ACCEPTATION HEURTEE DE LA NOTION .....................................
A. La solidité de la démarche des Etats africains ...........................
DOESAF-BAT.indd 405 29/10/14 17:04

TABLE DES MATIÈRES
1. La constance dans la position ................................................
2. La résistance aux oppositions ................................................
B. La variété dans la construction théorique des auteurs
africains ..........................................................................................
1. La construction principale .....................................................
2. La construction incidente ......................................................
II LA VALORISATION PROGRESSIVE DE LA NOTION ......................
A. L’ utilité de la notion .....................................................................
1. Le besoin de sécurité ...............................................................
2. Le refus de l’ incertitude de la notion .....................................
B. La consolidation de la notion .....................................................
1. La consécration jurisprudentielle ..........................................
2. Le triomphe par l’ émergence de nouvelles règles
impératives ? ............................................................................
CONCLUSION ....................................................................................................
II JUSTICE SOCIALE ET COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE :
DOCTRINE(S), ENJEUX ET PERSPECTIVES ........................................ 147
par Mouhamadou Fall
INTRODUCTION ..............................................................................................
I LA RENAISSANCE DU SOLIDARISME ..................................................
A. La solidarité : un outil de lutte contre les inégalités ................
B. Les formes de solidarité et leurs impacts dans la société ........
II CMU ET SOLIDARITE ..............................................................................
A. Le fonctionnement de la CMU ...................................................
B. Enjeux de la CMU dans l’ économie ...........................................
1. Dimension économique ...........................................................
2. Dimension politique ................................................................
III L’ AVENIR DE LA CMU .............................................................................
A. Les obstacles de la mise en œuvre de la CMU ..........................
1. La problématique du nancement .........................................
2. Les refus de consultation .........................................................
3. L’ aléa moral ..............................................................................
B. Les incitations à mettre en place ................................................
CONCLUSION ....................................................................................................
BIBLIOGRAPHIE ...............................................................................................
DOESAF-BAT.indd 406 29/10/14 17:04

TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 3 – LA CONSTRUCTION D’UN DISCOURS
CRITIQUE OU DE LÉGITIMATION
I DOCTRINE ET DIFFUSION DU DROIT DANS L’ ESPACE
AFRICAIN FRANCOPHONE ..................................................................... 165
par Gérard Martin Pekassa Ndam
I LES ECRITS ....................................................................................................
A. La disparité des supports de diusion .......................................
1. Le préférentiel ..........................................................................
2. Le résiduel ................................................................................
B. La décience des matières diusées ...........................................
1. Le désintérêt pour les matières « périphériques » ................
2. La carence substantielle des publications ..............................
II LES PAROLES ...............................................................................................
A. L’ habituel .......................................................................................
1. Au sein des campus universitaires .........................................
2. Hors des campus universitaires ..............................................
B. L’ inhabituel ....................................................................................
1. Les canaux médiatiques ..........................................................
2. Les canaux extra-médiatiques ................................................
CONCLUSION ....................................................................................................
II LA DOCTRINE ET LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE
DANS LES ETATS AFRICAINS FRANCOPHONES :
LA DIALECTIQUE DU NÉANT OU DE L’ ÊTRE? ................................. 193
par Yédoh Sébastien Lath
I UNE JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE ANTERIEUREMENT
EXPOSEE A LA CRITIQUE VIRULENTE DE LA DOCTRINE .........
A. Une approche dogmatique de la jurisprudence fondée sur
une idéalisation du modèle français ..........................................
1. L’ analyse de la jurisprudence africaine à l’ aune du modèle
français .....................................................................................
2. Une tendance à la francisation de l’ étude doctrinale de la
jurisprudence administrative africaine francophone ...........
B. Un apport peu visible de la doctrine à la construction de
l’ œuvre jurisprudentielle .............................................................
1. L’ inexistence d’ un dialogue formel entre la doctrine et les
juridictions en matière administrative ..................................
2. La fragilisation de la jurisprudence en rapport avec les
vacillements de la démarche doctrinale .................................
DOESAF-BAT.indd 407 29/10/14 17:04
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%