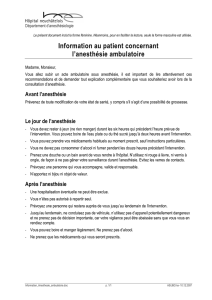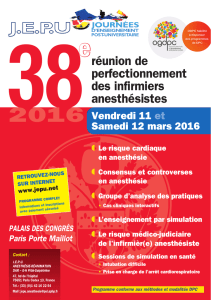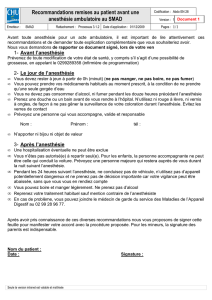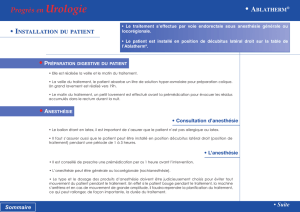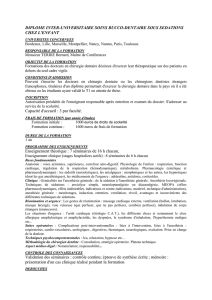l`information du patient

L'INFORMATION DU PATIENT
A. Lienhart, Département d’Anesthésie-Réanimation - Hôpital Saint-Antoine -
Paris, France.
INTRODUCTION
Ce sujet a une double connotation, médicale et juridique. Médicale, car le
consentement libre et éclairé du patient est un préalable indispensable aux soins.
Juridique, car le défaut d’information préalable est une faute susceptible d’entraîner
la condamnation du praticien (en exercice privé, pour laquelle il doit être assuré), ou
de l’hôpital (en pratique publique), à verser une indemnité en cas de préjudice
rattachable à ce défaut d’information.
1. DATE DE L’INFORMATION
Le fait que la consultation pré-anesthésique doive réglementairement avoir lieu
plusieurs jours avant l’acte obéit à des impératifs techniques permettant de faire
réaliser en temps utile les examens éventuellement nécessaires, ou d’adapter les
traitements. Mais ce délai est également indispensable pour permettre une décision
réellement libre. En effet, informé le jour-même, ou hospitalisé la veille, le patient
comme l’anesthésiste-réanimateur est soumis à une contrainte. L’exemple le plus
caricatural est celui des colonoscopies, où des patients apprenaient peu avant

MAPAR 1997
290
l’examen que les termes employés par le médecin ayant demandé l’examen : «on
vous fera quelque chose pour que vous n’ayez pas mal», recouvraient en réalité une
anesthésie. Quelle est la liberté de décision de celui qui s’est organisé pour se rendre
libre ce jour-là, a bu plusieurs litres de PEG, s’est déplacé vers la clinique ou
l’hôpital ? Désormais, le caractère préalable de la consultation pré-anesthésique
évite cet écueil. A condition toutefois qu’une information réelle soit fournie. De
manière incidente, bien que ceci ne concerne pas notre spécialité, il est évident que
ces règles sont également valables pour l’opérateur. A titre d’exemple, un arrêt
récent de la Cour de Cassation (25.2.1997) a rappelé, à propos d’une endoscopie
compliquée de perforation colique, l’importance de l’information préalable pour qui
conteste la demande d’indemnisation. De ce point de vue, structurellement,
l’absence de consultation préalable peut constituer une indiscutable fragilité, mais le
«renversement de la charge de la preuve» instauré par cet arrêt fait que cette
consultation n'est pas une «preuve» suffisante que l'information a bien été donnée.
Cependant, le fantasme étalé par certains médias «grand public», de listes de
complications à faire signer au patient, ou de «dérive à l’américaine», dont la
démonstration reste toujours à faire, sont du domaine de la contrevérité, pas
nécessairement innocente. Les «bonnes pratiques» françaises ne sont pas les
pratiques nord-américaines et devoir d’information n’est pas synonyme de
«décharge» à faire signer. En terme de responsabilité civile, en pratique privée, il
s’agit de sceller un contrat «tacite» suffisamment éclairé. La question juridique est
différente à l’hôpital public, mais les principes de loyauté dans l’information restent
les mêmes. Dans tous les cas, au plan pénal, l'intervention sur le corps humain exige
un consentement préalable.
2. DE QUELS RISQUES DOIT-ON PARLER ?
Cette question revient à demander s’il faut mentionner tous les risques des
techniques envisagées ou envisageables, ou signaler l’existence de certains risques,
généraux ou plus spécifiques du patient et de l’acte envisagé. Elle est posée aussi
bien par ceux qui ont vu les listes qu’il est demandé de signer aux patients
préalablement à une anesthésie aux USA, incluant la mort, les accidents des
cathétérismes veineux profonds, etc..., que par ceux qui voient dans l’incongruité de
la proposition dans notre culture, un moyen de faire obstacle à la pression de
demande d’information.
Le premier élément de réponse se situe dans l’évidente erreur qui consisterait à
affirmer qu’une anesthésie pourrait être sans aucun risque. Dès lors, il apparaît
évident que l’existence d’un risque doit être évoquée. Paradoxalement, cet impératif
est d’autant plus important que l’acte, et l’anesthésie qui l’accompagne, comportent
un risque faible. Qui pourrait s’imaginer qu’une chirurgie portant sur les coronaires
ne comporterait ni anesthésie ni risque ? En revanche, un acte bénin - ou présenté
comme tel - comme une chirurgie esthétique ou un examen endoscopique, ne

Session professionnelle
291
s’accompagne pas d’une telle évidence, d’autant que l’anticipation habituelle d’un
retour au domicile, dans le cadre de «l’ambulatoire», porte à faire croire à une
absence de danger. En réalité, le paradoxe n'est qu'apparent si la problématique est
énoncée en terme de rapport bénéfice / risque : moins l'acte envisagé a de bénéfice
thérapeutique, plus il importe que le patient ait conscience du niveau de risque de
l'ensemble acte + anesthésie ; inversement, lorsque l'intervention s'impose, avec un
bénéfice thérapeutique évident, s'il reste impossible de se soustraire à l'obligation
d'information, l'objectif est surtout de concourir à la réalisation de la thérapeutique.
Il est donc entendu que le risque doit être évoqué, mais faut-il pour autant
préciser tous les risques ? Chacun de nous sait que c’est impossible. Il convient
donc de faire un choix. Sans pouvoir fixer de règle absolue, quelques orientations
peuvent être proposées. Les inconvénients les plus habituels sont certainement à
mentionner. Les problèmes graves, lorsqu’ils sont exceptionnels, ne méritent
habituellement qu’une allusion, à quelques exceptions près. D’une part, lorsque le
patient pose directement la question. D’autre part, lorsque, comme précédemment
indiqué, la bénignité de l’acte fait que c’est le seul risque notable pour le patient.
Enfin et surtout, lorsqu’il existe une alternative ne comportant pas les mêmes
risques.
A titre d’exemple, l’analgésie obstétricale par anesthésie péridurale, ou
l’analgésie postopératoire par la même technique, mérite que l’information ne porte
pas que sur les bénéfices de la méthode, mais mentionne les exceptionnelles
séquelles neurologiques, tout en les remettant à leur juste place et en les situant dans
l’expérience personnelle du praticien.
3. COMMENT ABORDER LE PROBLEME ?
Cette question est souvent accompagnée du commentaire : «si je dis au patient
qu’il risque de mourir ou d’être paraplégique, il refusera tout soin». Il est vrai que
du tact est nécessaire. Certaines réalités ne doivent pas être assénées et la
consultation ne doit pas servir à l’anesthésiste-réanimateur à transférer son anxiété
sur le patient ou sa famille. S’il revient à chacun de trouver ses propres solutions,
quelques pistes conduisent généralement au but souhaité : informer sans inquiéter
inutilement. Une première façon de signaler le risque sans y insister lorsqu’il est
exceptionnel, est d’indiquer que le risque nul n’existe pas et de laisser le temps au
patient de poser des questions s’il le désire. Une autre façon, non exclusive de la
première, est de fournir un exemple imagé de la prise de risque, tiré de la vie
quotidienne, comme la conduite automobile ou la marche en ville. Une autre,
également non exclusive, est d’aborder le problème par les moyens utilisés pour
prévenir le risque : surveillance du cœur par visualisation permanente de l’ECG,
surveillance permanente de l’oxygénation du sang par l’oxymètre de pouls, etc.
L’importance des moyens mis en œuvre donne un reflet indirect de l’importance

MAPAR 1997
292
accordée par l’anesthésiste-réanimateur au risque, tout en fournissant une réponse à
l’inquiétude générée par la compréhension qu'un tel risque existe. Plus
accessoirement, l’image de «haute technologie» de l’anesthésie-réanimation s’en
trouve améliorée.
De la même façon, s’il existe un risque spécifique, lié à la pathologie ou à la
chirurgie, il est souvent moins inquiétant d’aborder le problème en même temps
qu’on énonce la solution proposée. Par exemple, chez un patient âgé et cardiaque,
l’information peut être du type : «bien sûr, vous n’avez pas un cœur de 20 ans et il
est évident que ceci augmente votre risque, mais ce que je peux vous dire, c’est
d’une part que nous avons anesthésié beaucoup de patients comme vous et que ça
s’est le plus souvent bien passé, d’autre part que vous êtes dans la meilleure
condition possible pour votre intervention et que votre cœur sera surveillé en
permanence par des appareils». Il va de soi que ce propos suppose que ce soit vrai.
Si ce n’est pas le cas, mieux vaut mettre le patient dans une situation telle que ce
propos puisse lui être tenu. Ou l’informer du caractère non exceptionnel des
problèmes soupçonnés.
En effet, l’information pour le risque non exceptionnel ne peut être aussi
générale. Il peut s’agir d’un risque vital et il convient alors de le comparer au risque
d’évolution spontanée de la maladie, en tenant compte du souhait de qualité de vie
du patient. Mais les inconvénients éventuels de l’anesthésie ne se limitent pas au
risque vital ou de séquelles neurologiques lourdes. Beaucoup plus fréquents sont les
échecs relatifs d’anesthésie loco-régionale, les nausées au réveil, l’inconfort de la
salle de réveil, la sonde gastrique, la douleur postopératoire... L’essentiel de ces
problèmes doit être évoqué pour que le patient puisse s’y préparer.
4. LE CHOIX DE LA TECHNIQUE REVIENT-IL AU PATIENT ?
Pour pouvoir faire un choix, il faut être informé et l’anesthésiste-réanimateur est
certainement le mieux informé pour faire ce choix. De plus, celui qui réalise l’acte
est seul à pouvoir décider de celui-ci, donc la décision finale revient à celui qui fait
l’anesthésie : ni au chirurgien, ni à un collègue ayant vu le patient en consultation.
D’un autre côté, le patient doit avoir donné son accord et avoir été informé
auparavant. S’il découvre au dernier moment un changement de personne et de
technique, il peut légitimement penser que le contrat initial n’est pas respecté
(secteur privé) ou qu’il existe un dysfonctionnement dans l’hôpital (secteur public).
Il doit donc être prévenu de cette possibilité dès la consultation.
Concernant la technique, il est rare que le choix des produits d’une anesthésie
générale fasse l’objet d’une information détaillée du patient en dehors de cas
particuliers, telle une allergie, donc cette question est inapparente. Ce n'est en
revanche pas le cas du choix entre anesthésie générale (AG) et anesthésie loco-
régionale (ALR) ou AG + ALR per- et/ou postopératoire. Dans tous les cas, les

Session professionnelle
293
avantages et inconvénients des différentes méthodes doivent être exposés, avec leurs
incertitudes et leurs limites. Bien évidemment, le praticien indique sa préférence,
mais dès lors que l’état du patient, le type de chirurgie et la pratique de
l’anesthésiste-réanimateur rendent une alternative possible, les termes de celle-ci
méritent d’être schématisés.
Par ailleurs, si le praticien n’est pas certain d’être celui qui réalisera l’anesthésie,
par exemple pour des motifs d’organisation, il en prévient le patient. La visite pré-
anesthésique permettra à celui qui réalisera l’anesthésie de se présenter et de
compléter l’information, en tenant compte des données de la consultation pré-
anesthésique, qui a fait l’objet d’un dossier. Si le patient rentre dans l'établissement
le jour-même de l’acte, ou si le praticien qui réalise l’anesthésie est différent de
celui qui a réalisé la visite préopératoire de «prémédication», cette dernière
information a lieu le plus tôt possible avant l’anesthésie.
Dans tous les cas, il est utile que l’information donnée au patient lors de la
consultation pré-anesthésique figure dans le dossier établi lors de cette consultation,
et ce pour plusieurs raisons. La première est que c’est le seul moyen pour
l’anesthésiste-réanimateur qui réalise l’anesthésie de savoir ce qui a été dit au
patient plusieurs jours plus tôt, éventuellement par un collègue. La seconde est que
c’est un bon moyen, en cas de litige juridique, d’apporter la démonstration que le
patient a bénéficié d’une information. Entre les préoccupations «sécuritaires» des
uns, envisageant de faire signer des listes de complications, et le refus de
communication des autres, il existe un vaste champs d’information simple et loyale,
résumée dans le dossier à toutes fins utiles. Enfin, si (lorsque) un formulaire
d'information est (sera) établi par un consensus professionnel, il est bon de le
remettre au patient. Sa signature par le patient est un problème d'une toute autre
nature et, tant qu'elle n'est pas demandée par un texte réglementaire (comme dans la
loi Huriet), une clause des contrats d'assurance professionnelle ou un avis du
Conseil de l'Ordre des Médecins (comme pour la chirurgie esthétique), elle ne peut
être recommandée. Il importe en revanche de s'être assuré que le patient n'a pas
d'autre question à poser avant de terminer la consultation.
5. LA TRANSFUSION SANGUINE
Lorsqu’une transfusion sanguine est prévisible, le patient doit être informé de
cette éventualité. S’il a été transfusé, il doit être informé de cette réalité. Un suivi
biologique post-transfusionnel est programmé à cette occasion, à la recherche
notamment d’une contamination virale. Pour juger de l’évolution des marqueurs
recherchés trois mois après la transfusion, il est utile de réaliser les mêmes examens
avant la transfusion. Si cette recherche comporte une sérologie VIH, le patient doit
en être spécifiquement informé.
 6
6
1
/
6
100%