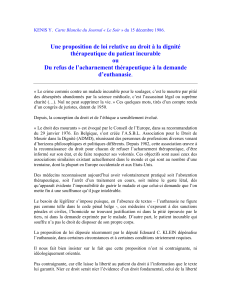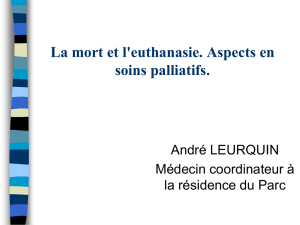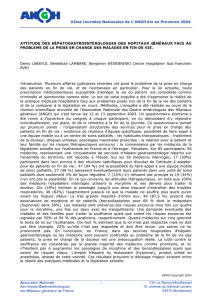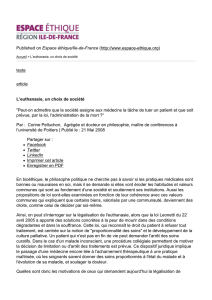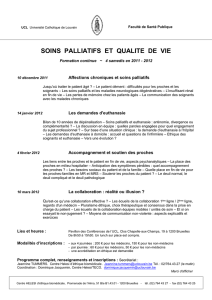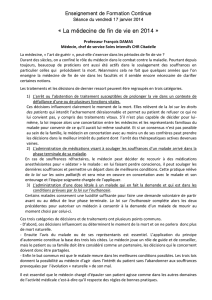Evaluer les souffrances physiques et morales

CHAPITRE III
SAVOIR EVALUER LES SOUFFRANCES PHYSIQUES ET MORALES
CHEZ UN MALADE EN FIN DE VIE ETHIQUE ET DECISION EN FIN DE VIE
Plan du Chapitre
3-1 Souffrance physique : La place de la douleur dans l’accompagnement
des patients en fin de vie
3.1.1 Rappel des bases neurophysiologiques
3.1.2 Rappel des principes d’évaluation de la douleur
3.1.3 Echelle de prise en charge de la douleur cancéreuse de l’OMS
1- Les recommandations de bonnes pratiques du groupe expert de
l’Association Européenne de Soins Palliatifs
2- Les stratégies thérapeutiques
3- Traitement s médicamenteux : Les paliers d’analgésiques pour le
traitements de la douleur cancéreuses
3.1.4 Les recommandations de bonnes pratiques du groupe expert de l’Association
Européenne de soins palliatifs
3-2 Le concept de souffrance totale
3.2.1 Définition
3.2.2 La souffrance spirituelle
3.2.3 La souffrance sociale
3.2.4 La souffrance mentale
3.2.5 La souffrance de l’équipe soignante
3-3 Éthique et décisions en fin de vie
3.1 Introduction
3.2 L’acharnement thérapeutique
3.2.1 Définition
3.2.2 La renonciation à l’acharnement thérapeutique : positions déontologiques
3-3 L’euthanasie
3.3.1 Définition
3.3.2 Le code déontologique
3.3.3 L’euthanasie et les missions de porter secours
3.3.4 L’euthanasie peut être qualifiée de meurtre
3.3.5 L’euthanasie et le droit de mourir dignement
3.3.6 L’exception d’euthanasie
3.3.7 Les décisions de limitation et d’arrêt de soins
3- 4 Repères pour une prise de décision dans les situations difficiles
de fin de vie
3.4.1 Introduction
3.4.2 Les repères déontologiques
3.4.3 Les repères pragmatiques de la décision
3.4.4 Le concept d’éthique clinique

CHAPITRE III
SAVOIR EVALUER LES SOUFFRANCES PHYSIQUES ET MORALES
CHEZ UN MALADE EN FIN DE VIE ETHIQUE ET DECISION EN FIN DE VIE
Docteur Thierry MARMET – Chef de Service – CRASP- HJD
3.1. Souffrance Physique : La place de la douleur dans l’accompagnement des
patients en fin de vie
3.1.1. Rappel des bases neurophysiologiques
Il est exceptionnel que dans l’accompagnement d’un patient en fin de vie, la douleur
physique soit absente.
Les différents mécanismes de la douleur physique peuvent être à l’œuvre :
- La douleur par excès de nociception lorsqu’il y a une lésion tissulaire.
- Les douleurs neuropathiques lorsqu’il existe une ou des lésions sur les neurones des voies
de la douleur. Il convient ici d’attirer l’attention sur la situation de la cancérologie. Les traitements et
le génie propre évolutif des cellules cancéreuses sont propres à créer les conditions de l’émergence
d’une douleur neuropathique :
la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie sont potentiellement agressives pour les
neurones de la douleur ; dans son génie évolutif, la maladie cancéreuse par compression,
infiltration, envahissement médullaire peut potentiellement créer des douleurs neuropathiques.
- Le mécanisme des douleurs psychogène est également très présent dans les situations de fin
de vie. Il n’est pas exceptionnel qu’il mobilise le souvenir de situations douloureuses vécues par des
membres proches du patient. Il est aussi habituel au travers d’un interrogatoire fin, de mettre en
évidence la résurgence d’une douleur que l’on peut qualifier « cicatricielle » d’une expérience
douloureuse vécue antérieurement par le patient. On peut alors la qualifier de lésion potentielle
puisque l’imagerie et la clinique ne peuvent valider la réalité de lésions tissulaires à ce moment là.
C’est par exemple, le cas d’une douleur qui réapparaît dans le territoire où un patient à fait vingt
auparavant un zona ; il n’avait eu aucune des douleurs classiques post-zostériennes ; à l’occasion
d’une tumeur cérébrale sans aucun rapport avec le territoire incriminé, il va développer un tableau
douloureux dans le métamère concerné. Mais bien souvent il s’agit d’une douleur siné-
matéria qui nécessitera une attention particulière dans sa prise en charge, dans la mesure où elle ne
relève pas des thérapeutiques médicamenteuses antalgiques habituelles, mais sentiellement d’une
approche psycho-comportementale.
3.1.2. Rappel des principes d’évaluation de la douleur
Nous ne reprendrons pas ici en détail l’ensemble des connaissances et des modèles mis en œuvre
dans l’évaluation de la douleur mais nous tenterons de proposer une synthèse pratique
opérationnelle dans l’accompagnement des patients en fin de vie.
1 : L’évaluation initiale de la plainte douloureuse : elle doit répondre aux cinq classiques questions
de la démarche de résolution de problème : où le patient a-t-il mal ? quand a-t-il mal ? comment a-t-
il mal ? combien a-t-il mal ? et pourquoi a-t-il mal ? :

-
-
-
-
-
A
la réponse « où » qui doit préciser le siège et l’irradiation de la douleur, la réponse peut
mobiliser le schéma du corps où le patient dessine lui-même les siège de sa ou ses
douleurs, leurs irradiations, leurs superficialités ou leurs profondeurs.
A la question « quand » il s’agit non seulement de faire un calendrier de la douleur dans
la journée, dans la semaine où dans le temps plus généralement mais également de
créer les conditions de le relier à des évènements qu’il augmentent ou la diminuent. Le
principe de la feuille de surveillance horaire laissée à la disposition des patients
compétents ou remplie régulièrement par l’équipe soignante dans les autres situations,
semble l’outil le plus approprié pour répondre à cette question.
La question « comment » comporte au moins quatre facettes :
•Les mots qu’emplois le patient pour décrire sa douleur : bien entendu, on peut mobilise
r
les questionnaires de vocabulaire mais il y a surtout une attention à porter à l’utilisation
de tous les mots qui peuvent d’une part décliner les douleurs neuropathiques (toutes les
variations autour de la sensation de brûlures, de dysesthésies, de fulgurances…) et les
maux qui réfèrent à un retentissement émotionnel à la douleur (notamment dans le
registre de la dépression).
•Le retentissement de la douleur sur les actes de la vie quotidienne en soulignant qu’ils
servent de support à toutes les échelles d’hétéro-évaluation.
•Le retentissement de la douleur en terme de comportement : on retrouve également ces
critères dans les échelles d’hétéro-évaluation. En pratique ambulatoire, cinq paramètres
sont particulièrement fondateur de l’hypothèse que le patient est douloureux : la
crispation de son front, la crispation de ses mâchoires, la recherche d’une attitude
antalgique, l’anticipation anxieuse des soins potentiellement douloureux, et la plainte.
Dans la pratique des Soins Palliatifs où la réalisation systématique des échelles d’hétéro-
évaluation pour les patients dans l’incapacité de s’exprimer est très chronophage, il est
entendu, lorsque nous faisons une prescription anticipée protocolisée et singularisée
pour chaque patient que si ces critères sont présents, le patient accède à une dose
supplémentaire d’antalgiques appelée entredose.
•La réponse « comment » doit aussi s’attacher à repérer les signes d’accompagnement
du tableau douloureux en terme d’asthénie, d’insomnie, de peur, de nausée, de
constipation, de dyspnée…
La réponse « combien » relève de deux modalités d’évaluation :
•D’une part, en mobilisant les échelles d’autoévaluation pour les patients compétents :
bien entendu, en priorité, l’échelle visuelle analogue et en cas d’impossibilité d’utilisation,
les échelles numériques ou de vocabulaires simples.
•D’autre part, les échelles d’hétéroévaluation validées (échelle de l’IGR pour les enfants,
échelle San Salvadou pour les patients handicapés mentaux, échelle ECPA, Doloplus 2
pour les personnes âgées non communicantes) ou simplifiées telles que décrites ci-
dessus. Il est indispensable de croiser l’autoévaluation et l’hétéroévaluation de l’intensité
de la douleur qui donne également une appréciation des composantes psychogènes des
comportements douloureux.
A la question « pourquoi », il s’agit de formuler l’hypothèse des composantes
nociceptives, neuropathiques ou psychogène du comportement douloureux fondatrice de
la décision thérapeutique à mettre en œuvre mais aussi de préciser l’éventuelle intrication
avec les autres composantes de la souffrance au plan psychique, sociale et spirituel
comme nous le détaillerons ci-après.
2 : L’évaluation de la douleur à la phase de titration des besoins en antalgiques et une fois l’équilibre
antalgique atteint :

A
la phase de titration, l’évaluation doit être attentive, régulière, rigoureuse. Elle doit faire
systématiquement l’objet d’une feuille de surveillance.
Bien entendu, les indicateurs de l’intensité de la douleur tant en auto qu’en hétéroévaluation sont ici
les critères les plus pertinents pour assurer le suivi tout en gardant des liens étroits
avec le temps, le retentissement sur les actes de la vie quotidienne et la survenue
d’effets secondaires. Les supports de surveillance doivent intégrer ces différentes
dimensions.
3.1.3. Echelle de prise en charge de la douleur cancéreuse de l’OMS6
En 1982, une consultation de l’OMS s’est tenue à Milan en Italie. Elle a réuni un groupe d’experts
sur le traitement de la douleur cancéreuse. Ils appartenaient à des spécialités comme
l’anesthésiologie, la neurologie, la neurochirurgie, les soins infirmiers, l’oncologie, la pharmacologie,
la psychologie et la chirurgie. Ils ont préparé un premier exposé sur les directives concernant le
traitement de la douleur cancéreuse. Ces directives exprimaient un avis unanime, à savoir qu’en
utilisant un nombre limité de médicaments, il était tout à fait possible de soulager la douleur chez la
majorité des cancéreux dans le monde. Des études sur la possibilité d’appliquer ces directives et su
r
leur efficacité ont commencé dans un certains nombres de pays ayant différents systèmes de soins
de santé sous la direction de l’OMS et du Centre collaborateur OMS pour le traitement de la douleu
r
cancéreuse à l’Institut National de Cancérologie de Milan. Les directives sur la prise en charge de la
douleur cancéreuse ont pris corps après une réunion de l’OMS sur le traitement global de la douleur
cancéreuse qui s’est tenu à Genève en décembre 1984.
1 : Les recommandations de l’OMS pour l’évaluation de la douleur cancéreuse :
1. Croire les plaintes du malade concernant sa douleur ;
2. Evaluer la sévérité de la douleur du malade ;
3. Evaluer l’état psychologique du malade ;
4. Analyser en détail les plaintes concernant la douleur ;
5. Effectuer un examen physique complet ;
6. Ordonner et contrôler personnellement toutes les investigations diagnostiques
nécessaires ;
7. Envisager d’autre méthode de traitement de la douleur pendant le bilan initial ;
8. Evaluer le degré de soulagement de la douleur après le début du traitement.
2 : Les stratégies thérapeutiques reposent sur la série de principes ci-après :
1. La dose d’analgésique devrait être déterminée d’après les besoins individuels ;
2. L’emploi de médications orales est préférable ;
3. L’insomnie doit être vigoureusement traitée ;
4. Les effets secondaires doivent être systématiquement traités ;
5. Des médicaments adjuvants sont nécessaires chez certains malades (principe de la
coanalgésie) ;
6. L’évolution du malade doit être soigneusement surveillée.
3 : Traitements médicamenteux : les paliers d’analgésiques pour le traitement de la
douleur cancéreuse :
L’emploi des analgésiques est l’élément fondamental du traitement de la douleur
cancéreuse ; utilisés correctement, ils sont efficaces chez un fort pourcentage de malades. Il
est suggéré de suivre trois paliers successifs :
1. L’utilisation des antalgiques non opioïdes avec la mobilisation d’éventuels adjuvants co-
antalgiques. Les antalgiques non opioïdes sont en premier ligne le Paracétamol puis
l’Aspirine et les anti-inflammatoires. La Noramidopyrine douée d’une activité antalgique
6
( ) Traitement de la douleur cancéreuse. Organisation Mondiale de la Santé. Genève. 1987
(disponible Librairie
Arnette 2, rue Casimir-Delevigne – 75006 Paris).

très significative compte tenu de ses effets secondaires ne sera mobilisée que si ces effets sont
proportionnés à la situation pronostique du patient, dans la mesure où la Noramidopyrine s’avère un
coanalgésique puissant dans les douleurs des viscères et organes digestifs.
En ce qui concerne la coanalgésie, on entend par là, la mobilisation en co-prescription de certains
médicaments psychotropes mais également de techniques spécifiques comme la chirurgie, la
radiothérapie, la chimiothérapie à visée antalgique. Il s’agit également de la mobilisation de toutes
les techniques qui peuvent contribuer au confort du patient : kinésithérapie, ergothérapie,
relaxation, sophrologie,…
2. En cas d’inefficacité du palier 1, sont mobilisés les opioïdes faibles. Nous disposons de trois
types de molécule : la codéine, le dextropropoxyphène, le tramadol, en soulignant que seul le
tramadol existe sous une forme injectable. La codéine et le tramadol existent sous des formes à
libération prolongées. Dans ce deuxième palier, il est possible d’associer aux opioïdes faibles, des
non opioïdes en particulier le paracétamol qui est souvent associé aux molécules précitées.
Dans ce même palier, la mobilisation de la coanalgésie à bien entendu toute sa place.
3. En cas de contrôle insatisfaisant au palier 2, il convient de mobiliser les opioïdes forts. La
panoplie des opioïdes forts disponibles en France s’est actuellement élargie outre l’accès à la
morphine sous toutes les formes possibles orale, à libération immédiate et prolongée et injectable.
Sont arrivés sur le marché français d’Hydromorphone(forme LP exclusive) et l’Oxycodone (formes
LP, LI et injectable) qui sont venues compléter la présence du Fentanyl qui existe sous forme de
patch à libération prolongée sur 72 h et plus récemment sous forme à libération immédiate par voie
transmuqueuse. Cette panoplie devrait s’enrichir probablement de la méthadone compte tenu des
effets limitant l’hyperalgésie propre à cette molécule. Là encore, la mobilisation des non opioïdes et
en particulier le paracétamol obéit à des principes de coanalgésie. Bien entendu, toutes les autres
formes de coanalgésie concourent à la qualité et à l’efficacité de la prise en charge.
4. Bien que l’échelle de l’OMS n’ait que 3 marches, il est un petit nombre de situations qui ne sont
pas contrôlées par cette approche et qui relèvent d’une approche interdisciplinaire telles qu’elles
peuvent être mises en œuvre dans les centres d’évaluation et de traitement de la douleur. Cette
évaluation pluridisciplinaire peut conduire à mobiliser si les décisions sont proportionnées avec
l’état pronostique du patient des techniques neurochirurgicales notamment en terme de
neurostimulations et plus exceptionnellement d’interruption des voies de la douleur.
3.1.4. Les recommandations de bonnes pratiques du groupe expert de l’Association
Européenne de Soins Palliatifs
La grande majorité des douleurs dues au cancer répondent à des traitements
pharmacologiques qui utilisent des antalgiques administrés par voie orale, en association
avec des médicaments adjuvants. Ce traitement est basé sur les recommandations de
l’OMS : une échelle propose une augmentation progressive, étape par étape des
antalgiques. Il s’agit plus d’un concept que d’un protocole rigide et non modifiable (OMS,
1986). Ce schéma thérapeutique permet une très grande flexibilité dans le choix des
médicaments, et l’échelle de l’OMS doit être surtout considérée comme une stratégie de
prise en charge de la douleur due au cancer. Cette prise en charge symptomatique est
intégrée dans le traitement spécifique de la maladie et avec les techniques non
médicamenteuses.
1/ La morphine est l’opioïde à utiliser en première intention pour traiter la douleur modérée
ou sévère du cancer.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%