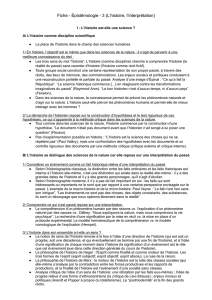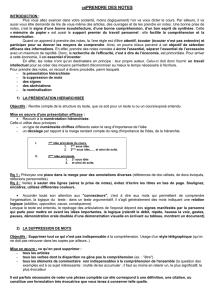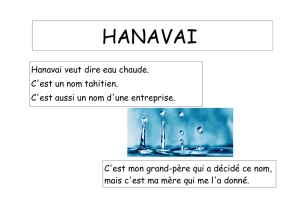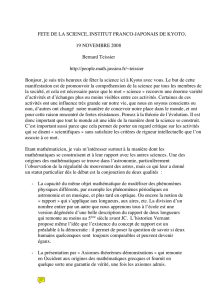Construction / reconstruction des normes et

Construction / reconstruction des normes et processus de conceptualisation
Maria Pagoni1
Il s’agit ici de contribuer au débat sur les normes et la normativité par une
interrogation concernant les processus d’appropriation des normes par les élèves dans le cadre
de situations d’éducation morale et / ou à la citoyenneté. Je m’intéresse plus particulièrement
aux normes qui sont liées au « champ conceptuel de la loi » qui renvoie à trois domaines de
l’action sociale : le domaine du droit (ensemble des droits et obligations explicites et codifiés
qui régissent la vie collective), le domaine de la morale (valeurs qui fondent le droit et qui
sont enracinées dans l’histoire et l’identité des collectifs), le domaine politique (exercice du
pouvoir et participation à des processus de prise de décisions concernant justement les règles
de la vie collective en fonction des valeurs fondatrices).
Cette interrogation a un double ancrage :
- Ancrage théorique renvoyant à des approches psychologiques du développement et de
l’apprentissage telles que la théorie des champs conceptuels (Vergnaud 1996, Merri coord.,
2007), la perspective historico-culturelle de l’activité et du développement (Leontiev 1975,
Clot coord., 2011) ou la didactique professionnelle (Pastré 2011, Vinatier 2009).
- Ancrage empirique renvoyant à des travaux de recherche développés depuis plusieurs
années sur les processus d’appropriation des normes par les élèves dans un objectif
d’éducation morale et / ou à la citoyenneté ou par les enseignants dans des situations de
transmission et / ou d’appropriation des principes qui contribuent à la construction de leur
professionnalité (Pagoni 2011, 2013).
L’hypothèse soutenue est que l’enjeu de ce processus d’appropriation des normes est
lié à la signification que celles-ci acquièrent dans des contextes précis d’action. Cette
signification conditionne la construction de la légitimité de ces normes et constitue le produit
de déplacements, de tensions et de conflits à la fois intra et interindividuels qu’il convient de
décrire avec précision pour comprendre comment et dans quelles conditions ces normes
deviennent des outils de développement de l’activité des acteurs.
La question posée est la suivante : comment une approche par la conceptualisation peut-
elle contribuer à l’éclaircissement de ce processus d’appropriation des normes qui régissent la
vie collective ?
L’appropriation*des*normes*comme*un*processus*de*construction*de*
significations*
Pour définir l’appropriation des normes de l’environnement social dans le cadre de
l’éducation morale, je me base sur une citation de Ricoeur (1996) faisant le lien entre normes,
morale et éthique. Cet auteur propose « de tenir le concept de morale pour le terme fixe de
référence et de lui assigner une double fonction, celle de désigner, d’une part, la région des
normes, autrement dit des principes du permis et du défendu, d’autre part, le sentiment
d’obligation en tant que face subjective du rapport d’un sujet à des normes. » Il distingue par
la suite l’éthique qui se situe en amont et en aval de la morale, l’éthique antérieure visant
« l’enracinement des normes dans la vie et dans le désir, l’éthique postérieure visant à
insérer les normes dans des situations concrètes. À cette thèse principale je joindrai une thèse
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Professeure des Universités en sciences de l’éducation, Université Lille 3, Proféor-CIREL.
2 Voir Paul Ricoeur «De la morale à l’éthique et aux éthiques » dans Monique Canto-Sperber

complémentaire, à savoir que la seule façon de prendre possession de l’antérieur des normes
que vise l’éthique antérieure, c’est d’en faire paraître les contenus au plan de la sagesse
pratique, qui n’est autre que celui de l’éthique postérieure. »2
Deux éléments semblent importants à retenir de cette citation de Ricoeur par rapport au
processus d’appropriation des normes :
" Ce processus est intégré dans une approche générale de l’activité de l’individu en
situation, ce que ce philosophe appelle la sagesse pratique. A partir de ce constat, je
fais l’hypothèse qu’un des objets centraux de l’éducation morale est d’aider l’élève à
construire la signification des normes sociales auxquelles il se trouve confronté par
l’interprétation de son activité dans différents contextes. Du point de vue de la
recherche, cela signifie que l’analyse de l’activité de l’élève au sein de l’espace
scolaire et dans le cadre des situations éducatives finalisées peut donner des indices
sur la façon dont il construit ces significations.
" Ce processus implique une réflexion sur le sentiment d’obligation de l’individu et sa
transformation en un choix délibéré qui détermine son éthique personnelle enracinée à
la vie et au désir. Ce constat conduit à considérer les liens entre règles de vie collective
et normes sociales. Les normes déterminent les limites du permis et du défendu, elles
peuvent être personnelles ou collectives, elles sont le produit d’une culture et d’une
histoire. Or, quand on se place du point de vue de l’éducation, ce qui nous intéresse
c’est de comprendre comment les normes s’objectivent, s’explicitent, se justifient et se
transmettent sous forme de règles prescrites en jouant sur le passage de l’implicite à
l’explicite et de l’arbitraire au droit. Nous faisons ainsi l’hypothèse que la construction
d’un espace de droit peut jouer un rôle de médiation qui favorise la construction de la
signification des règles qui régissent la vie collective par les élèves.
La*place*des*médiations*symboliques*dans*la*construction*de*la*signification*des*
concepts*
Jerôme Bruner (1991) signale qu’on peut distinguer, en psychologie, deux grandes
tendances : celle qui s’attache à étudier les liens entre stimulus et réponses en considérant
l’activité des individus en termes de procédures et de réactions à des stimuli et celle qui met
au centre de l’analyse de l’activité de l’individu la construction de la signification du réel.
Dans ce dernier cas nous ne sommes pas situés dans un paradigme stimulus – réponse
mais dans un paradigme de résolution de problème où l’élève est censé se construire une
représentation de la situation en prélevant des indices et en faisant une sélection et une
hiérarchisation des informations qui lui semblent les plus significatives selon le but de
l’activité et le mobile qu’il se donne.
Dans cette optique, la signification est à la fois moyen et objet de l’activité de l’élève :
elle est un moyen parce que l’élève mobilise des concepts qui lui semblent pertinents pour
analyser la situation ; elle est un objet parce que la résolution de cette situation peut conduire
à la re-configuration de la signification d’une règle. Dans les deux cas de figure, l’activité est
médiatisée par des signes dont le langage occupe une place importante.
J’adopte à ce propos l’analyse faite par Moro et Rickenmann : « C’est par le biais des
médiations éducatives / formatives – et donc par le medium de la communication – que le
sujet apprenant se trouve peu à peu inclus dans les systèmes de pratiques et d’usages
existants. Ces derniers en tant que systèmes ou formes de significations constituent à la fois le
but des apprentissages mais en constituent aussi le moyen, rendant en quelque sorte possibles
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Voir Paul Ricoeur «De la morale à l’éthique et aux éthiques » dans Monique Canto-Sperber
(1996), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris : PUF.!

les apprentissages eux-mêmes – et ce, au travers des différentes modalités sémiotiques qu’ils
recèlent. Ce faisant, au travers des médiations éducatives / formatives, la signification est à la
fois moyen et objet de la construction. Se pose en conséquence la question du rôle respectif
des différents systèmes de signes […] dans les processus de médiation, ces derniers
concernant autant les outils matériels et symboliques utilisés que les modalités de
l’éducationnel » (2004, p.10).
Cet intérêt pour le langage comme outil de construction de la signification des normes
auxquelles se trouvent confrontés les élèves, conduit à réfléchir sur le statut des concepts dans
les situations de communication qui concernent les normes régissant la vie collective.
Le*statut*des*concepts*dans*trois*registres*d’activité*
*
La recherche des indices de conceptualisation des normes socio-morales dans le discours
des adolescents était l’objet de ma thèse de Doctorat. Les adolescents avaient comme
consigne de discuter par groupes de trois, sans la présence du chercheur, pour se mettre
d’accord sur six règles de comportement qu’ils considéraient comme les plus importantes
pour les relations humaines, et les hiérarchiser par ordre d’importance. L’analyse de ce
matériau très riche a permis de poser quelques questions fondamentales pour éclairer ce
processus de conceptualisation, conçu comme un processus de construction de la signification
des concepts socio-moraux (Pagoni 1997).
La première question concerne la relation entre règles et valeurs qui les sous-tendent.
Quel rôle joue la compréhension de ces valeurs dans la construction de la signification de ces
règles et l’acceptation de leur légitimité ? L’analyse du discours des adolescents a mis en
évidence que ceux-ci construisent cette signification à partir du moment où ils commencent à
se poser des questions sur les conditions de validité des règles socio-morales dans des
situations précises. Par exemple, ils considèrent qu’il faut dire la vérité mais il y a des cas où
il est nécessaire de mentir pour différentes raisons (ne pas blesser l’autre, etc.) Ce
questionnement les conduit à thématiser le contenu des valeurs véhiculées par les règles, à les
considérer comme des objets de réflexion et à les intégrer dans un système conceptuel en
relation avec d’autres concepts du même champ. On passe ainsi d’une réflexion sur les règles
à une réflexion sur les concepts qui y sont intégrés. Pour analyser ce processus, il a fallu
construire trois catégories d’opérations du discours que les adolescents utilisaient pour
s’exprimer à propos des concepts socio-moraux : les opérations normatives, les opérations
pragmatiques et les opérations conceptuelles. Ces catégories ont permis de montrer qu’il y a
une évolution graduelle, avec l’âge, des opérations normatives vers les opérations
conceptuelles. Les opérations pragmatiques jouent le rôle d’un maillon intermédiaire dans
cette évolution et sont également présentes aux deux classes d’âge distinguées (13-14 ans et
17-18 ans) même si leur usage varie dans chacune d’elles. En tant que révélatrices d’un
processus d’adaptation au réel, ces opérations jouent un rôle central dans la construction de la
signification des concepts moraux. Elles permettent de faire le lien entre les trois domaines de
la cognition auxquels renvoie la réflexion socio-morale : le moralement prescriptif (il faut
s’aimer les uns les autres), le pragmatiquement possible (il n’est pas possible d’aimer tous les
autres) et le conceptuellement nécessaire (est-ce que l’amour est la même chose que le
respect ? Quand on dit qu’il faut s’aimer les uns les autres, ne parle-t-on pas en réalité de
respect ? ).
L’étude du processus de conceptualisation des règles socio-morales à travers les
opérations du discours renvoie en même temps au caractère pragmatique des concepts au sens
de la pragmatique linguistique. Ce qui signifie que les concepts sont l’outil / le produit non
seulement de l’action sociale de l’individu mais aussi d’opérations à la fois cognitives et
discursives. Cette idée se base sur le rapport entre la fonction de communication de la langue

et la fonction de représentation de celle-ci, rapport interrogé en psycho-linguistique par les
travaux de Jean-Blaise Grize ou de Culioli, en philosophie par Habermas, en socio-
linguistique par Basil Bernstein et en psychologie par Vygotski. Je me suis ainsi intéressée
aux indices de conceptualisation des notions morales dans le discours et à la transformation
d’une notion, d’outil en objet d’une activité. Cette investigation conduit à la position
théorique selon laquelle on n’apprend pas seulement « par la pratique », comme le dit le vieil
adage selon lequel « c’est en forgeant qu’on devient forgeron » mais aussi par l’analyse de
celle-ci, en proposant ainsi, comme un moment important dans la conceptualisation d’une
norme socio-morale, la prise de conscience des propriétés qui permettent de la rendre
fonctionnelle dans l’activité.
La deuxième question soulevée par cette thèse était celle de la relation entre deux grands
champs conceptuels de la morale étudiés par la littérature spécialisée et notamment les
travaux de Kohlberg (1984) et de Gilligan (1982/1986) : le champ de la justice, qui accentue
la dimension généralisée et décontextualisée des valeurs, et le champ de la sollicitude qui
accentue la dimension contextualisée et relationnelle de celles-ci. La recherche a montré la
complémentarité existant, dans le discours des adolescents, entre ces deux grandes catégories
de concepts et leurs propriétés, ainsi que le rôle important de la valeur de la sincérité dans
cette intégration. Ces résultats contribuent à l’éclaircissement de certains conflits de normes
qui peuvent être rencontrées par les jeunes par rapport à la double fonction qui caractérise les
normes socio-morales : elles structurent les relations interpersonnelles et notamment l’amitié
et la coopération ; elles structurent le groupe et son organisation démocratique et égalitaire.
Cette double fonction des valeurs peut provoquer des tensions dans les choix et la
construction de la personnalité de l’enfant ou du jeune adolescent, ce qui apparait dans les
recherches concernant le fonctionnement des conseils de coopérative à la fin de l’école
primaire : tension, par exemple, rencontrée par un délégué des élèves entre favoriser ses amis
d’une part et adopter un comportement égalitaire envers tous les camarades de classe en
respectant la fonction qu’il exerce au sein du collectif, d’autre part.
Ces conclusions et questionnements ont alimenté ma réflexion sur la relation qui existe
entre les trois registres de l’activité qui construisent la signification des concepts, à savoir le
registre prescriptif, le registre pragmatique et le registre conceptuel au sein des situations
éducatives dans les établissements scolaires. Dans quelles conditions un milieu éducatif peut-
il contribuer à la construction de la signification des normes qu’il génère ? Cette question a
été examinée dans le cadre d’une recherche analysant les processus et les effets de
socialisation scolaire des élèves dans une école primaire fonctionnant selon les principes de la
pédagogie Freinet.
Méthodologie*de*recherche*
La recherche se base sur la monographie d’une école primaire située dans une zone REP
(Réseau d’Education Prioritaire) à Mons-en-Baroeul dans la banlieue lilloise. Cette école
accueillant une population d’élèves issue essentiellement de milieu populaire et présentant des
difficultés scolaires et comportementales importantes, l’Inspection Académique a demandé à
une équipe d’enseignants faisant partie du mouvement Freinet (ICEM : Institut Coopératif de
l’Ecole Moderne) de prendre en charge le projet de l’école pour une période de cinq ans avec
l’objectif d’améliorer les résultats des élèves dans tous les domaines d’apprentissage.
L’équipe d’accueil Theodile-CIREL a assumé l’évaluation de ce projet (Reuter 2007). Ayant
comme objectif d’étudier les processus de socialisation des élèves au sein de cet établissement
scolaire, j’ai eu l’occasion de réunir, pendant plusieurs années, différents types de données
concernant ce processus, dans une perspective de comparaison avec d’autres établissements
scolaires situés soit dans la même ville mais utilisant une pédagogie dite « traditionnelle » soit

dans d’autres villes mais utilisant une autre pédagogie alternative, comme la pédagogie
institutionnelle.
Ce matériau très riche conduit à une hypothèse sur les conditions qui déterminent la
construction de la signification des règles scolaires par les élèves. Cette hypothèse s’appuie
sur l’analyse des données qui correspondent à trois types de discours construits, au sein de
l’établissement, autour des règles scolaires, leurs fondements et leurs conditions
d’application :
" Discours des prescriptions (règlement intérieur, règles de classe, règlement de
récréation, règles spécifiques de chaque discipline ou de chaque activité …) ; il est
abordé à partir de l’analyse du contenu et de la forme de ces textes prescriptifs :
longueur, présence des obligations et des devoirs des élèves seulement ou de tous les
membres de la communauté éducative ; référence aux finalités de cette
communauté pour justifier l’existence de ces règles ; explicitation des sanctions
prévues en cas de manquement aux règles prescrites. En s’inspirant des travaux de
Merle (2003) sur les conditions de construction d’un espace de droit au sein de
l’établissement scolaire, cette analyse a montré que la construction de cet espace
dépend du degré de transparence des règles scolaires et des sanctions qui les
accompagnent, de leur référence aux principes qui les fondent et qui les justifient ainsi
que de leur possibilité d’évolution par des processus démocratiques de prise de
décision.
" Discours des élèves sur leur expérience scolaire. Il s’agit d’entretiens effectués avec
les élèves sur leur sentiment de justice et la pertinence des sanctions, le sentiment de
sécurité, le respect des droits et obligations par les élèves et les enseignants, le
sentiment de participation dans des processus de prise de décision. L’analyse de ces
entretiens, en comparaison avec d’autres établissements scolaires (Pagoni 2009), a
permis de montrer que l’acceptation de la légitimité des règles scolaires par les élèves
est liée à la fois à leur sentiment de justice et de participation à la vie scolaire mais
aussi à leur représentation de l’éthique professionnelle des enseignants (responsabilité
dont ils font preuve envers les élèves).
" Discours élaboré au sein des conseils de coopérative en cycle trois. Ces conseils ont
lieu une fois par semaine et ont une fonction de prise de décision concernant à la fois
les sanctions des élèves et le respect des règles, l’évolution de celles-ci selon les
besoins de la classe et / ou de l’établissement (suppression de certaines qui ne sont
plus fonctionnelles et institution d’autres qui peuvent s’avérer nécessaires au cours de
l’année) ou encore l’organisation générale de la classe (mise en place de projets, etc.).
Les interactions verbales qui ont lieu dans ces conseils ont été analysées par rapport
aux objets de discussion mais aussi aux modalités du discours utilisé et notamment la
distinction entre le discours prescriptif, le discours pragmatique / explicatif et le
discours conceptuel (discussion autour de la signification des règles et des valeurs qui
les fondent). Ces critères d’analyse ont permis de montrer des différences dans la
façon de mener ces conseils aussi bien entre enseignants du même établissement plus
au moins expérimentés qu’entre enseignants d’établissements différents qui
s’inscrivent dans d’autres courants pédagogiques et notamment la pédagogie
institutionnelle. L’étude a montré que les conseils de coopérative font appel à des
compétences professionnelles spécifiques de la part des enseignants (Pagoni, 2011).
Ces compétences permettent aux enseignants de résoudre de façon spécifique à chacun
des tensions qui régissent les finalités de ces conseils : outils de pacification des élèves
et des problèmes qui existent entre eux, outils de résolution de problèmes concernant
la vie scolaire, outils de réflexion sur l’expérience scolaire des élèves et sa régulation.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%



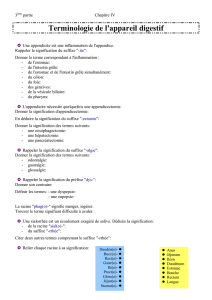

![8- psycho et dlr - D Caysac [Mode de compatibilité]](http://s1.studylibfr.com/store/data/003273408_1-6dde464fd9fb9fc2c660702e3834626b-300x300.png)