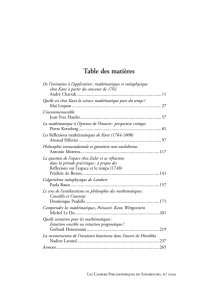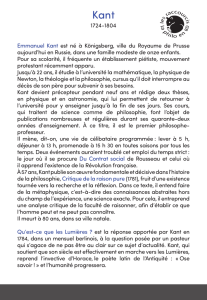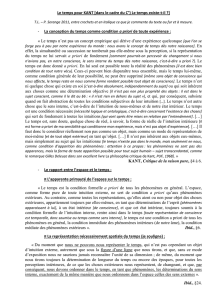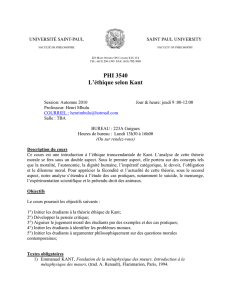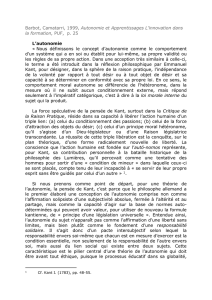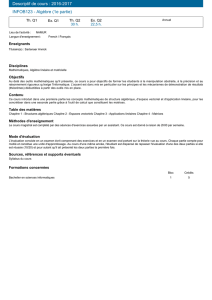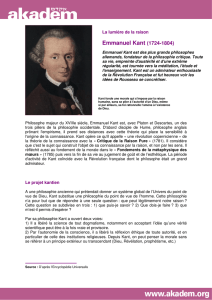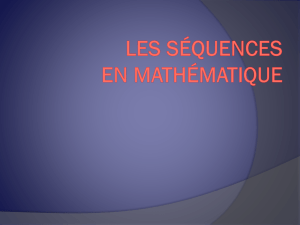Frank Pierobon, Kant et les mathématiques. La conception

Frank Pierobon, Kant et les mathématiques. La conception kantienne des mathématiques,
Paris, Vrin, 2003, 239pp.
Paru dans la Revue Internationale de Philosophie, 2004, vol. 58, p. 491-493.
Kant considère que la géométrie et l’arithmétique dépendent des formes pures de l’intuition
de l’espace et du temps. Or, à partir de la fin du XVIIIe siècle, une « révolution algébrique » se
met progressivement en place, qui finira par réunir l’arithmétique et la géométrie dans une
algèbre générale des transformations. Une telle « subordination de l’intuition à l’opération »
ne « contredit-elle pas le dessein général du kantisme », comme le déclarait Jules Vuillemin ?
L’auteur se propose de montrer « qu’il n’en va pas nécessairement ainsi » (p.13) et s’engage
dans une interprétation du statut de l’intuition chez Kant qui pourrait déboucher sur une
phénoménologie non du visible ou de la vue, mais du sentiment d’évidence notamment face à
l’écriture algébrique. Un « statut distinct peut et doit être donné à l’écriture, de manière à la
distinguer de l’image » (p. 201). « Nous formons l’hypothèse ici, sous la forme d’une piste
pour des recherches ultérieures, que l’algèbre est une intuition sans image» (p. 86).
F. Pierobon parcourt d’abord les principaux textes précritiques traitant des mathématiques,
puis regroupe les écrits de maturité selon trois grands objets : les réflexions sur la géométrie,
celles sur l’arithmétique, celles sur «l’algèbre » et le calcul infinitésimal. Il conclut par une
« interprétation architectonique » de la place des mathématiques, et plus spécialement de
l’algèbre, dans le système kantien. Sans suivre ce fil pas à pas, traçons quelques axes de
réflexion.
Dès 1763, dans la Recherche sur l’évidence des principes de la théologie et de la morale,
Kant découvre « à l’aveugle ou à tâtons pourrait-on dire » (p. 38) ce qui deviendra l’une des
thèses majeures de la « Théorie transcendantale de la méthode », à savoir la différence entre la
méthode « analytique » du philosophe, et l’activité « constructive » du mathématicien. Tandis
que le philosophe analyse un concept déjà donné, le mathématicien opère des liaisons
arbitraires qui rendront possible la pensée d’un nouvel objet. Contrairement au philosophe, le
mathématicien n’a donc pas besoin d’avoir « les choses mêmes devant les yeux » (p. 38).
Cependant, remarque Pierobon, Kant ne cessera de répéter qu’en géométrie « tout est toujours
sous le regard, dans la pensée » (p. 43). Or ce qui peut apparaître, dans les écrits précritiques,
comme l’échec « d’une conception unifiée des mathématiques » (p. 43), va bientôt se révéler
comme la richesse ou la force du point de vue kantien sur les mathématiques: ne pas perdre de
vue les « conditions empiriques » de leur genèse , alors même que « la logique et la science
(mathématique ou autre) ne produisent de savoir que dans l’éclipse de ces conditions » (pp.
137).
On en arrive ainsi à la question principale du livre, qui est de savoir jusqu’à quel point la
réalité empirique de l’activité mathématique s’accorde avec la thèse transcendantale selon
laquelle les mathématiques dépendent de l’intuition sensible. Dans quelle mesure cette thèse
vaut-elle pour d’autres domaines que celui de la géométrie ? Commençons par l’arithmétique.
Alors qu’une construction géométrique se veut « performative et synthétique », l’énoncé
arithmétique déroule pour ainsi dire analytiquement (p. 209) toute une série de propriétés liées
au concept de grandeur, mais sans produire par là aucune évidence intuitive immédiatement
accessible à notre sens externe. Pour qu’il y ait synthèse, et que l’évidence de l’énoncé
1

arithmétique s’impose empiriquement à nous, il faut attendre qu’apparaisse à notre perception
interne le résultat chiffré de la succession des compositions et divisions effectuées dans le
calcul. Ainsi, dire que la construction mathématique de concepts requiert une intuition
sensible n’implique pas que cette intuition fasse nécessairement intervenir des images : elle
peut aussi porter sur des entités qui nous sont rendues sensibles par leur caractère distinct au
sein d’un certain processus de composition ou de production, processus qui s’inscrit toujours
dans le temps.
L’auteur insiste donc sur le nécessaire élargissement du champ de l’intuition sensible à la
temporalité du sens interne. Il nous semble ici que Pierobon voit juste. Certains « algébristes »
ne se sont-ils pas eux-mêmes reconnus dans un tel élargissement ? Ainsi W. R. Hamilton, le
premier grand théoricien des nombres complexes (jugés par Kant « impossibles à penser »)
décrira sa nouvelle algèbre comme « une science du temps pur », et se dira « encouragé à
faire connaître cette conception par le souvenir [qu’il garde] de certains passages de la
Critique de la raison pure de Kant »1. D’autre part, l’extension du champ de l’intuition aux
signes et à l’écriture présente l’avantage non négligeable de saper l’opposition entre
« intuitionnistes » et « formalistes », opposition à laquelle se résument trop souvent les débats
de philosophie des mathématiques. Hilbert, par exemple, généralement confiné dans son rôle
de partisan pur et dur d’un « formalisme sans image », ne considérait-il pas les formules de
l’algèbre comme « les objets concrets d’un attitude intuitive », consistant précisément à saisir
les signes dans leur distinction et leur succession2 ?
Pourtant, lorsque l’auteur aborde de front le problème de l’algèbre –dont on peut regretter, au
demeurant, qu’elle soit définie seulement par son caractère scriptural ou formel, sans préciser
davantage la spécificité de ses méthodes– c’est pour souligner la tension qu’il faut imprimer
au concept même de l’intuition, « tension terrible qui risque, à la réflexion, de le défigurer »
(p. 178). « L’algèbre représente, en quelque sorte, la limite de la conception kantienne des
mathématiques… de nouvelles mathématiques apparaissent que Kant n’a pas eu le temps et-
ou l’occasion d’évaluer à leur juste mesure » (p. 182). Que Kant rencontre des difficultés à
penser l’algèbre, cela paraît indéniable. Mais le manque de temps ou d’occasions suffit-il à les
expliquer ? Heureusement Pierobon ne s’en tient pas là, et invoque une autre raison, bien plus
essentielle : l’élargissement de l’intuition, s’il ne pose pas de problème du côté du sens
interne, ne peut se faire en direction du concept, sous peine de retomber dans l’illusion
transcendantale qui consiste à prendre nos concepts pour des intuitions. « Si, comme nous le
suggérons, l’on allait jusqu’à considérer qu’il y a intuition dès qu’il y a conscience empirique
d’un mouvement de pensée, la distinction architectoniquement essentielle entre intuition et
concept finirait par s’estomper et l’on serait bien en mal de produire un critère suffisamment
discriminant pour séparer l’algèbre de la logique, et vice-versa » (p. 181). Cela finirait « par
réunir à nouveau les conditions d’une illusion transcendantale puissante, dans la mesure où
plus rien ne permettrait de distinguer critiquement entre une « intuition sensible » (l’usage
empirique de l’entendement) et une « intuition en général » (l’usage pur de l’entendement),
comme l’explique l’Amphibologie » (p. 206).
Ainsi ce qui, en définitive, empêcherait réellement Kant de progresser davantage dans
l’explicitation des constructions algébriques de son temps serait tout simplement le cadre
métaphysique, ou transcendantalement illusoire, dans lequel évoluerait la nouvelle
algèbre. Tout se passe au fond comme si l’algèbre, en tant qu’écriture, pouvait être intégrée
1 The Mathematical papers of Sir William Rowan Hamilton, rééd. Cambridge University Press, 1967, p. 117.
2 D. Hilbert, « Die Grundlagen der Mathematik », Abhandlugen aus dem mathematischen Seminar der
Hamburgischen Universität, VI, 1928, p. 71.
2

au système kantien, mais, en tant que pensée (« logique », ou « abstraite »), en était exclue.
Curieux paradoxe selon lequel, du point de vue de Kant, les « algébristes logiciens»
d’aujourd’hui appartiendraient au clan des « métaphysiciens dogmatiques » d’hier. Mais ce
paradoxe semble bien confirmé par certains textes. Nous songeons en particulier à ce passage
de la Recherche sur l’évidence des principes de la théologie naturelle et de la morale, cité en
note par l’auteur. Kant y dénonce les mathématiciens qui définissent leurs objets « avec le
regard du philosophe ». Et d’évoquer la définition de la similitude proposée par Wolff dans
ses Elementa matheseos universae (définition en fait empruntée à Leibniz): « sont semblables
deux choses qui sont indiscernables lorsque chacune d’elles est considérée séparément ». Ce
genre de définition « selon le concept général » « a toujours été une erreur », estime Kant, et
« n’a pour le géomètre absolument aucune importance », car elle expose sa science « aux
mêmes dissensions malheureuses que la philosophie ». Or c’est précisément dans cette
définition de la similitude, jugée métaphysique par Kant, que Hermann Weyl apercevra, deux
siècles plus tard, l’idée initiatrice de… la théorie des groupes de transformations3.
On l’aura compris, ce livre bien construit, d’une écriture toujours claire et agréable, donne à
penser, ce qui n’est pas la moindre des qualités.
Benoît Timmermans
Fonds National de la Recherche Scientifique (Belgique)
3 H. Weyl, Symétrie et mathématique moderne, trad. Fr. Flammarion, 1964, pp. 27 et 126.
3
1
/
3
100%