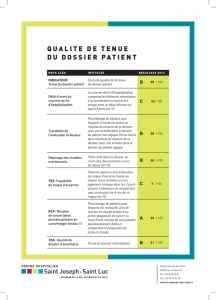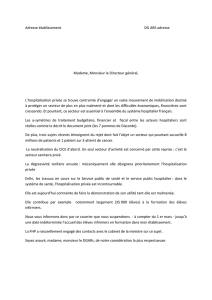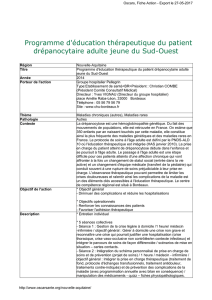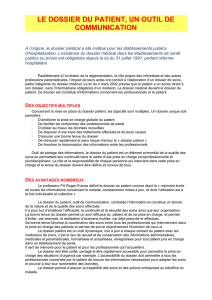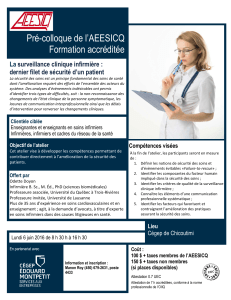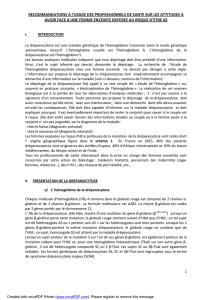L`ACCUEIL DU PATIENT DRÉPANOCYTAIRE EN CRISE ALCIQUE

Cadre Supérieur Infirmier
L’ACCUEIL DU PATIENT DRÉPANOCYTAIRE EN CRISE
ALCIQUE
Avec la participation~des infirmières
et
des aide-soignantes
Mélanie ARAS, Véronique SURON, Monique
GUILHEM,
Annie PIQUEMAL, Patrick RICHARD,~Josiane SEVERIN
Centre de la DrépanocytoSe et des Thalassémies, hôpital Henri
Monder
AP-HP
INTRODUCTION
La drépanocytose
ou
anémie
falciforme,
est une mala-
die héréditaire du sang, due à une anomalie de I’hémo-
globine contenue dans les globules rouges assurant le
transport de l’oxygène dans les tissus (iconographie,
physiologie du globule rouge, Annexe
1).
C’est actuel-
lement une maladie rencontrée couramment dans les
services hospitaliers de pédiatrie et d’adultes en Ile de
France (1 enfant sur 1 500 naît drépanocytaire et le
nombre estimé de patients en Ile-de-France dépasse
3 000). Cette maladie est également
rec~%~~e
par
I’OMS comme l’une des plus importantes maladies
génétiques dans le monde. Les drépanocytaires sont
pour 80 % originaires des Départements d’outre-Mer
ou
d’Afrique noire et pour 20
%
des sujets originaires
d’Europe
ou
d’Afrique du Nord.
A côté de l’anémie hémolytique chronique qui gêne
peu
les
patients, les accidents
vax>-occlusifs,
entraî-
nant des crises douloureuses
ostéoarticulaires
&OU
abdominales, sont les manifestations principales de
cette. maladie. Ces crises constituent l’aspect le plus
invalidant de la drépanocytose par leur caractère im-
prévisible, douloureux, leur retentissement multiple sur
l’individu, son environnement familial social et
profes-
sionnet.
La drépanocytose a bénéficié d’un grand nombre de
progrès diagnostiques et thérapeutiques qui améliorent
la prévention de cette maladie mais il n’existe toujours
pas de traitement curatif radical (hormis l’éventualité
d’une greffe de moelle).
Le
Centre
de la Drépanocytose et des Thalassémies de
l’hôpital Henri Monder comprend quatre lits d’hospita-
lisation pouvant accueillir dix à quinze patients par
jour et un secteur de consultation. Inauguré en 1994, la
spécificité de ce Centre est donc de rassembler dans un
même lieu un ensemble de moyens (consultation, hos-
pitalisation, laboratoire) permettant de prendre en
charge les patients de façon globale, prise en charge
rendue parfois délicate du fait des particularités ethno-
socio-culturelles des patients. Ce Centre n’a pas
d’équi-
valent en France Métropolitaine, et son mode d’organi-
sation paramédicale et médicale intègre toutes les
facettes de cette maladie chronique émaillée de com-
plications aiguës fréquentes.
PROBLÉMATIQUE
L’intensité de la douleur dans cette maladie déroute
IE
soignant, elle est source pour le patient de souffrance
extrême et parfois de
<<
désir de mort
».
16
Recherche en soins infirmiers Na
48 -Mars
1’397

L’ACCUEIL DU PATIENT DRÉPANOCYTAIRE EN CRISE ALCIQUE
La réflexion engagée par les soignants sur la
«
crise
»
algique drépanocytaire a débuté par une recherche de
ce que représente la douleur. Si l’on prend la définition
du Comité de taxonomie de
«
L’international Associa-
tion for the Study of Pain
»
(IASP)
c’est :
«
Une sensation désagréable et une expérience émo-
tionnelle en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou
potentielle décrite en ces termes.
»
La douleur semble donc se composer de différents
éléments, un stimulus physique ou mental, une sensa-
tion physique de souffrance et la réaction du patient qui
subit.
Le patient drépanocytaire arrivant en
«
crise algique
b>
subit effectivement ces différents éléments. En premier
lieu, l’infirmière doit
«
croire
»
le malade, car les épi-
sodes algiques sont d’une douleur intense, insuppmta-
ble et sont la hantise du patient et de son entourage.
Communiquer sa douleur est impossible et endurer sa
douleur est affaire de culture et de personne, alors le
moins que le patient puisse nous demander est le crédit
mais aussi l’empressement et l’efficacité à le soulager.
La
«
crise algique
»
va par ailleurs, à plus ou moins long
terme, entraîner une dégradation physique incompré-
hensible et
mutilante
pour le patient Wcrose de han-
che, atteintes
neuro-sensorielles,
ulcères de jambe,
priapisme).
Le drépanocytaire est conscient de cette
dégradation et peut parfois considérer sa maladie
comme un mauvais sort ou une punition. Cependant
souvent, il vit cette crise comme porteuse d’un risque
de
mort
prochaine. Pour toutes ces raisons, la relation
soignant/soigné
est au premier plan. L’élaboration
d’une stratégie en soins infirmiers est donc primordiale.
Cette réflexion engagée par les soignants sur
«
la crise
algique
»
drépanocytaire et sa prévention doit donc
permettre d’améliorer les connaissances dans tous,ses
aspects, avec comme bénéfices attendus l’instauration
d’une relation de confiance avec le patient et une
intervention plus active de celui-ci dans sa propre prise
en charge.
Les questions posées en pratique par cette étude sont
de deux ordres :
1)
L’évaluation de la crise algique comprenant :
-
l’évolution sous traitement
;
-
l’évaluation par le personnel de la douleur des
patients : l’extériorisation fréquente des signes de dou-
leur gêne-t-elle l’appréciation de la douleur par le
personnel
!
2)
Les particularités culturelles
et/ou
sociales de cette
maladie comprenant :
-
le positionnement du patient face à cette maladie
héréditaire chronique avec paroxysmes ;
-
la connaissance de la maladie et
«
l’autogestion
»
de cette maladie par le patient et/ou les proches.
MÉTHODOLOGIE
1. Cadre du travail
L’étude a été réalisée dans le Centre de Drépanocytose
et des Thalassémies de l’hôpital Henri Monder. Cette
structure prend en charge les patients arrivant en
«
crise
algique
»
drépanocytaire. Un bilan fait par un médecin
à l’arrivée du patient permet de choisir entre une ad-
mission ambulatoire dans ce Centre ou une hospitali-
sation aux Urgences de l’hôpital si la
«
crise
»
paraît
nécessiter des éléments thérapeutiques et de sur-
veillance autres que ceux de la douleur (fièvre, difficul-
té respiratoire, grossesse, déshydratation importante).
Les infirmières (4) et aides-soignants (2) présents actuel-
lement ont tous participé à l’ouverture de ce Centre en
1994. Ils ont suivi des cours sur cette pathologie. Ces
cours ayant été donnés par des médecins du Centre de
Drépanocytose ou des médecins du Centre de Transfu-
sion Sanguine rattachés à l’hôpital Henri Monder.
Les patients étudiés sont des patients en crise algique
non compliquée c’est-à-dire ne présentant ni fièvre ni
douleur thoracique ou abdominale pouvant évoquer
une complication chirurgicale
et/ou
médicale. En d’au-
tres termes, les patients étudiés dans ce travail sont a
priori en situation ambulatoire, c’est-à-diredevantquit-
ter l’hôpital avant la fin de la journée.
Le protocole de traitement de la douleur était systéma-
tisé et comportait :
-
Prodafalgan
intraveineux, 2
g
en 30 minutes.
-
Profénid IV, 100 mg dans 100 ml en 30 minutes.
-
Perfusion C5,50
ml/kg
+
NaCI
4g/l; KCI
2gIL.
-
Avec Vichy ou Bicarbonate, 14
%dperiusion).
-
02 si
Sa02
<
95
%.
2. Outils de recueil
Les soignants ont travaillé sur deux types de question-:
naires.

2.A. Questionnaire 1 (Annexe 2)
Analyse de la
«
crise douloureuse
»
drépanocytaire
traitée à l’hôpital de jour du centre, ses caractéristiques
(analyse par le soignant et le patient).
Les paramètres ont été mesurés à l’arrivée, à 30 minu-
tes, 1 h, 2 h, 4 h après l’arrivée du patient.
CeS
mesures
ont été réalisées de façon systématique, sauf si le pa-
tient s’endormait, dans ce cas l’évaluation était faite à
la période suivante.
Nous avons essayé de faire apparaître différents axes :
l Données médicales, permettant une
survei//ance
de
/‘état
physique du patient. Ces donnéés ont été analysées
à partir des questions N” 5 (pouls, pression artérielle,
saturation capillaire en oxygène sans apport d’Oz, fié-
quence
respiratoire,
diurèse)
no
9
-
n”
10 -
no
Il
(séda-
tien)
-
No14 (la nécessité d’un arrêt de travail).
-
Données sur /‘appréciation de /‘évolution de
/a
dou-
leur et de son traitement. Ces données ont été atialysées
suivant l’appréciation de l’infirmière prenant en charge
le patient à partir des questions :
N” 1, score de la douleur :
-
1 : pas de douleur
-
2 : douleur mineure
-
3 : douleur modérée
-
4 : douleur intense.
N” 2, localisation prédominante de la douleur :
-
1 : membres supérieurs
-
2
:.membres
inférieurs
-
3 : thorax
-
4 : abdomen
-
5 : dos
-
6 : tête.
N” 3, notation en mm de l’échelle visu$lle analogique
donnée au patient. L’échelle visuelle analogiqw (EVA)
est une échelle
unidimensionnelle
continue graduée de
0 à 100 mm. Elle se présente sous la forme d’une
réglette
à deux faces. Une face concernant le patient ;
sur cette face se trouve un curseur, celui-ci peut être
déplacé du point
«
pas de douleur. au point
«
douleur
maximale
».
Le patient se positionne en fonction du
niveau de sa douleur. Une face destinée à l’infirmière;
cette face comporte une échelle numérotée de 0
(ab-
sente
de douleur) à 10 (douleur maximale) et permet à
l’infirmière de chiffrer la douleur du patient.
N” 4, score de sédation :
-
1 : éveillé
-
2 : somnolent, mais facile
à
réveiller
-
3 : somnolent difficile à réveiller
-
4 : coma.
N”
i3,
le devenir du patient vers une hospitalisation est
toujours secondaire à une persistance de la douleur,
EVA supérieur à 5.
l Données par rapport au
rôle
propre infirmier. Ces
questions ont été analysées à partir des questions
No
6,
installation du patient algique :
-- 1 : sans aide
-
2 : avec aide + besoin de chaleur
-
3
: avec aide + cerceau
-
4 : avec aide
+
chaleur + cerceau.
N”
12, massages.
l Données psychologiques pouvant avoir une réper-
cussion
sur
la douleur ressentie par
le
patient. Ces
données ont été analysées à partir des questions N” 7
évaluation du stress :
-
1~
:-ne paraît pas stressé
-
2 : paraît peu stressé
-
3 : angoissé découragé
A
4 : agité.
N” 8, rôle de la famille :
-
1’ Tenvironnement familial ‘non
stressant
-
2 : environnement familial stressant.
2.8.
Q,uestionnaire
2
(Ame!~?
3)
L’objectif de ce questionnaire, rempli en totalité par le
patient, aidé si nécessaire par une infirmière du Centre
lors d’une consultation variant entre 10 et 20 jours
après l’hospitalisation du patient; permettait alors de
déterminer deux axes :
-
une évaluation rétrospective de
/a
crise par
le
pa-
tient. Ces donn+s ont été analysées à partir des ques-
tions ; a-b-c
-d
sowenir de I’EVA, délai d’arrivée,
facteurs
déclenchants,
nature du soulagement à I’arri-
vée ;
-
une évaluation
post-critique,
orientée sur la situa-
tion psychologique en rapport avec la pathologie et
l’éducation &I patient.
Cgs
données ont été analysées
à
partir’des
questions ; e f
‘g
-
h
-
i j
-
évaluation
comportementale de LINTON, connaissances de la
prophylaxie des crises algiques, désirs d’information.
2.C.
Analyse
statistique
Les résultats de ces deux questionnaires ont été analy-
sés au plan statistique par les tests appropriés
(Chi-2,
corrélation linéaire,
ANOVA),
après saisie des données
daris
le logiciel Statview 4.5 (Macintosh).
Les résultats ont été exprimés soit en moyenne
*
écart
type, soit par une distribution en fréquence selon le cas,
18
Recherche en soins infirmiers
N” 48 -Mars
1937

L’ACCUEIL DU PATIENT DRÉPANOCYTAIRE EN CRISE ALGIQUE
soit en médiane et écarts extérieurs. Les différences ont
été considérées comme significatives pour un
p
infé-
rieur
à
0,05.
RÉSULTATS
1. Caractéristiques générales de la population
Cinquante et un patients ont été
évalu&
a
chacune des
deux parties de cette enquête. En raison d’une distribu-
tion bimodale de l’âge des patients, les résultats sont
présentés en médiane et valeur minimum-maximum.
La médiane de l’âge de la population est de 32 ans avec
des valeurs extrêmes de 16 et 48 ans. Les patients sont
de sexe féminin dans 75 % des cas .La drépanocytose
est une forme SS dans 90% des cas (46/51),
SI3
dans 4 %
des cas (2/51) et SC dans 6 % des cas (3/51). La forme
SS était significativement plus fréquente chez les fem-
mes
(95
%
versus 77
%,
p
=
0,04).
Le délai entre le début de la douleur et l’arrivée au
Centre varie entre 1 et 4 heures (pour 1 patient450 heures).
Cependant 57
%
(28/51
patients) se présentent moins
de 12 heures
apr&s
les premiers symptômes. Le délai
d’arrivée n’est pas significativement différent selon
le sexe des patients
(20,5
f:
25/5
heures versus
18,4
f
24,7 heures, p
=
OJO).
2. Douleur et thérapeutique
La douleur à l’arrivée est intense (EVA. 59
k
24 mm) et
diminue progressivement au cours des deux premières
heures pour se stabiliser autour de 25-30 mm. La ré-
duction de la douleur est significative dès la première
heure
(p
=
<
0,001) (figure 1).
La comparaison des scores douloureux et de leur évo-
lution montre une différence significative entre les
deux sexes
(p
<
0,001). En effet, la douleur est signifi-
cativement plus intense chez les femmes.
D’une façon générale, il existe une corrélation négative
entre l’intensité de la douleur et le délai d’arrivée.
En d’autres termes, plus la douleur est intense,
plis
le
patient se présente tôt au centre. Cependant, cette
relation n’est pas très importante
(r
=
0,09
; p
=
0,52).
II semble exister une relation entre l’importance de la
douleur initiale et le devenir du patient, en d’autres
termes, une crise douloureuse intense est plus souvent
10(
8C
60
40
20
0
E
l-
)-
Figure 1
VA (mm)
Arrivée
1 h-ure
2 heures 4 heures souvenir
-.
.
suivie d’une hospitalisation qu’une crise douloureuse
mineure. Cinq patients ont du être hospitalisés
(5/51)
soit 10 %. L’analyse statistique révèle que les femmes
sont moins hospitalisées que les hommes
(55
versus
90 %, p = 0,Ol) (figure 2).
Nous n’avons pas retrouvé de liaison significative entre
la forme génétique de drépanocytose et l’intensité de la
douleur
(p
=
0,06).
Cependant en raison du faible
effectif des groupes
SR
,SC, cette conclusion est à
vérifier.
Les infirmières ont évalué à chaque temps la douleur
des patients selon une description en quatre catégo-
ries : absence de douleur, douleur mineure, douleur
modérée et douleur intense. D’une façon générale et à
chaque temps, il existe une relation précise entre I’in-
tensité de la douleur évaluée par le patient et par
l’infirmière (figure 3).
Les distorsions enregistrées surviennent pour les dou-
leurs intenses et modérées pour lesquelles l’écart est
toujours dans le sens d’une sous-estimation.

Figure
2
100
EVA(mm)
60
0
EtO”r hospitalisation hospitalisation
au domicile
à
domicile
Figure 3.
Evaluation de la douleur par l’infirmière
Parmi les facteurs ayant permis le soulagement de la
douleur de la crise, les patients perçoivent l’efficacité
des médicaments administrés comme l’élément princi-
pal. En effet, 24/48 patients
(50
%)
considèrent que le
facteur de soulagement principal est l’administration
des antalgiques.
3. Evaluation rétrospective de l’intensité de la
crise algique
Lors du questionnaire réalisé à distance de la crise, la
valeur d’EVA donnée rétrospectivement par les patients
pour leur douleur à l’arrivée lors de la crise était de
65
2
24 mm. Cette valeur moyenne était non significa-
tivement différente de la valeur moyenne obtenue le
jour de la crise (59 k 24 mm). Cependant, la corrélation
linéaire entre ces deux valeurs montre une corrélation
modeste
(r
= 0,42 ; p =
0,031
avec une sous-estimation
de la douleur forte et une surestimation de la douleur
faible lors de l’évaluation rétrospective (figure 4).
La qualité du souvenir n’est donc pas excelleme, ou
peut-être faut-il chercher les composantes du souvenir,
autres que la seule intensité douloureuse.
100
20
0
:
C
Figure 4
0o o
ooa
x
0
0
0 0
I
020 40 60 80 100
Souvenir EVA (mm)
EVA
aride
(mm) =
28
+ 0.5
x
Souvenir EVA,
r
=
0.42
4) Données médicales au cours de la crise
algique
La fréquence cardiaque a diminué significativement
une heure après l’admission (p
<
0,OOOl) puis est restée
stable jusqu’à la sortie. Les variations de pression arté-
rielle n’ont pas été significatives au cours du traitement
(p=O,12).
La saturation artérielle en oxygène
(Sa021
a augmenté
significativement
(p
=
0,Ol) dès la première heure de
traitement puis est restée élevée et stable jusqu’à la
sortie (figure
5).
Recherche en soins infirmiers
No48
-
Mars
1997
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%