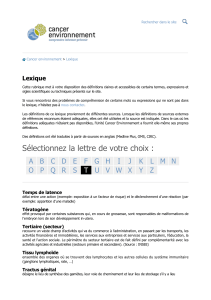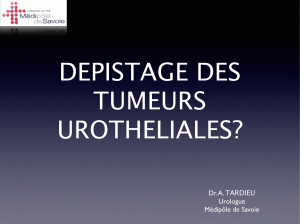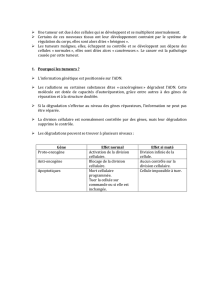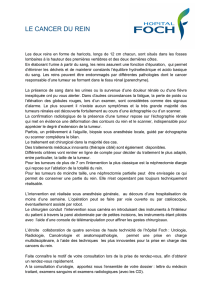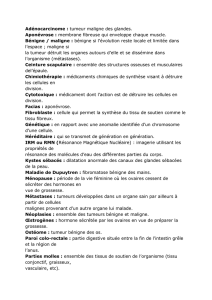5 Tumeurs du Larynx

Item 145
67
Item 145 : Tumeurs bénignes et malignes du
larynx
OBJECTIFS :
• savoir diagnostiquer une tumeur du larynx
• apprécier les signes de gravité et les facteurs pronostiques
• l'étudiant doit connaître les stratégies de prévention, de dépistage, de diagnostic
et de traitement des principales tumeurs bénignes et malignes afin de participer
à la décision thérapeutique multidisciplinaire et à la prise en charge du malade à
tous les stades de la maladie.
INTRODUCTION :
Les tumeurs du larynx ont en commun des signes de gravité liés à leur topographie. Le
principale risque est une asphyxie par obstruction de la filière laryngée. Les troubles de la
déglutition sont plus rares. Les tumeurs malignes sont les plus fréquentes. Le cancer du
larynx a un pronostic relativement bon mais le risque de deuxième localisation au niveau des
voies aérodigestives reste élevé (20%).

Item 145
68
Plan
1. Les points communs
1.1.Sémiologie topographique
1.1.1 Les tumeurs de l’étage sus-glottique
1.1.2. Les tumeurs de l’étage glottique
1.1.3. Les tumeurs de l’étage sous-glottique
1.1.4. La perte de la mobilité laryngée
1.2. Le diagnostic
1.3. Les signes de gravité
1.3.1. symptomatiques
1.3.2. évolutifs
2. Tumeurs malignes du larynx
2.1. Epidémiologie
2.2. Pathogénie
2.3. Clinique
2.3.1. Les symptômes
2.3.2. L’examen clinique
2.4. Les examens complémentaires
2.5. Le diagnostic
2.6. Le traitement
2.6.1 Les méthodes
2.6.2. Les indications
2.7 Evolution et surveillance
2.7.1. Les facteurs de pronostic
2.7.2. La surveillance
3.Tumeurs bénignes du larynx
3.1. Classification
3.2. Les tumeurs de l’étage sus-glottique
3.2.1. Les tumeurs nerveuses
3.2.2. Les tumeurs conjonctives
3.2.3. Les tumeurs glandulaires
3.2.4. Les angiomes et hémangiomes
3.3. Les tumeurs de l’étage glottique
3.3.1. Le papillome
3.3.2. Le myoblastome granulocellulaire ou tumeur d’Abrikossof
3.3.3. Les rhabdomyomes
3.4. Les tumeurs de l’étage sous-glottique
3.4.1. Les chondromes
3.4.2. Les angiomes
3.5. Le traitement
3.5.1. L’exérèse par les voies naturelles
3.5.2. L’exérèse par voie externe

Item 145
69
Les tumeurs du larynx sont dominées par les tumeurs malignes. Cependant quelque soit la
nature de la tumeur, la majeure partie de la symptomatologie et des risques qui en découlent
sont liés à sa topographie au niveau des différents étages du larynx.
1. Les points communs
1.1. Sémiologie topographique
1.1.1. Les tumeurs de l’étage sus-glottique
La symptomatologie de ses tumeurs est souvent très pauvre avec une discrète gène
pharyngée. Les modifications de la voix sont toujours tardives : la voix prend un caractère
étouffé si le volume tumoral est important, un enrouement est possible si la tumeur est
pédiculée et vient à tomber sur les cordes vocales. Si la tumeur est très volumineuse, c’est la
gène respiratoire sous la forme d’une dyspnée laryngée progressive qui attire l’attention.
1.1.2. Les tumeurs de l’étage glottique
La dysphonie est le premier symptôme. Elle s’aggrave progressivement et peut entraîner une
désonorisation complète voire une dyspnée si la lésion est volumineuse.
1.1.3. Les tumeurs de l’étage sous-glottique
Elles peuvent rester asymptomatiques si leur volume est faible. La dyspnée est le symptôme
le plus fréquent une fois que le volume de la tumeur réduit la filière aérienne. Une dysphonie
peut apparaître si la tumeur entrave la mobilité aryténoïdienne ou si elle gène l’arrivée de l’air
sur la partie muqueuse des cordes vocales.
1.1.4. La perte de la mobilité laryngée
Signe majeur de malignité, la perte de la mobilité laryngée dans le contexte d’une tumeur peut
être en rapport avec :
Une infiltration musculaire, nerveuse ou articulaire signant la malignité du processus,
Un phénomène de masse limitant l’amplitude des mouvements que la tumeur soit de nature
bénigne ou maligne.
Elle correspond à un signe de gravité dans la mesure où elle va conduire à une majoration de
la gène fonctionnelle, notamment respiratoire.
1.2. Diagnostic :
Le diagnostic repose sur l’examen laryngé avec la visualisation de la tumeur.
La laryngoscopie sous anesthésie générale permet de préciser l’aspect macroscopique et les
limites de la tumeur. La biopsie est toujours nécessaire car il est impératif d’affirmer ou
d’éliminer un cancer. Elle demande une attention particulière en cas de suspicion de tumeur
d’origine vasculaire (pince aspirante et coagulante à disposition).
Si la lésion est difficile à cerner à l’examen laryngé, un examen tomodensitométrique cervical
permet de déterminer les limites profondes de la lésion en apportant des arguments
étiologiques et précisant les possibilités thérapeutiques.
1.3. Les signes de gravité :
Les signes de gravité sont de deux ordres
1.3.1. symptomatiques
La dyspnée laryngée peut imposer en urgence la réalisation d’une trachéotomie en raison d’un
obstacle tumoral non franchissable.
Les troubles de la déglutition sont plus rares mais les tumeurs pharyngolaryngées peuvent
créer un obstacle au passage des aliments réalisant un tableau de dysphagie sévère imposant
une alimentation entérale ou parentérale

Item 145
70
1.3.2. évolutifs
Le caractère malin de la tumeur est bien sur au premier plan. L’immobilisation d’un
hémilarynx, la présence d’adénopathies font alors partis les facteurs de gravité.
Cependant, les tumeurs bénignes ou malignes ayant un potentiel à devenir volumineuses vont
entraîner à plus ou moins longue échéance des signes de gravité symptomatiques. Il en est de
même pour les tumeurs récidivantes malgré les traitements.
2. Tumeurs malignes du larynx
2.1. Epidémiologie
Le cancer du larynx représente environ 7.5% des causes de mortalité par cancer chez l’homme
entre 40 et 59 ans . Il survient dans 95 % des cas chez l’homme entre 45 et 70 ans.
Le tabac est le principal facteur prédisposant lié à des agents carcinogènes complets
(benzopyrène) , des agents irritatifs (goudron, particule), un effet thermique direct et chimique
(Ph de la fumée). Le rôle de l’alcool est également important . D’autres facteurs sont
soupçonnés : amiante , acide sulfurique . Des antécédents de radiothérapie cervicale
antérieure peuvent être également un facteur favorisant .
Des états précancéreux correspondent à certaines laryngites chroniques : laryngite
oedémateuse, pseumyxoedémateuse , papillomatose, kératosiques .
2.2. Pathogénie
De nombreuses formes histologiques sont décrites :
Le carcinome épidermoïde est la plus fréquente ( 90%) , il est plus ou moins différencié . les
autres formes sont le carcinome verruqueux , le carcinome à cellule fusiforme, les
adénocarcinomes .
La structure anatomique du larynx conditionne les modalités d’extension soit extralaryngée ,
principalement ganglionnaire ( étage sous et sus glottique ) soit intralaryngée ( extension en
hauteur entre les étages laryngés) .
Les métastases sont possibles surtout pulmonaires et osseuses . Leur incidence n’est pas
parfaitement connue .
2.3. Clinique
2.3.1. Les symptômes
Trois symptômes principaux sont habituels : dysphonie , dysphagie , dyspnée .
Leur présence est corrélée au volume et au siège tumoral.
Il est classique de différencier les cancer selon l’étage laryngé atteint en cancer sus glottique,
cancer glottique et cancers sous glottiques , les plus rares .
En pratique, une atteinte de plusieurs étages n’est pas rare.
La découverte du cancer par l’apparition d’une adénopathie cervicale est assez rare. C’est
parfois le cas des tumeurs sus-glottiques qui sont les plus lymphophiles.
2.3.2. L’examen clinique
L’interrogatoire recherche les facteurs de risque et les symptômes laryngés ; Une otalgie
réflexe est parfois présente dans les formes sus-glottiques ;
L’examen clinique est centré sur l’examen de la cavité buccale et du pharyngolarynx en
particulier par la laryngoscopie indirecte. La palpation cervicale vérifie la présence

Item 145
71
d’adénopathie cervicale le plus souvent sous digastriques , sauf dans les formes limitées à
l’étage glottique où elles sont exceptionnelles.
Le résultat de l’examen est reporté sur un schéma daté qui servira de base à la discussion du
protocole thérapeutique .
Les reste de l’examen concerne une évaluation de l’état général.
2.4. Les examens complémentaires
L’endoscopie des voies aérodigestives demeure l’examen indispensable qui permet de vérifier
le siège de la lésion , la présence d’une deuxième localisation ( 10 à 15% ) , la réalisation de
biopsie , la palpation de la tumeur éventuellement .
L’imagerie est dominée par la tomodensitométrie qui a pour avantage de préciser les
extensions sous muqueuse para glottique , de la loge hyo thyro épiglottique , de la
commissure antérieure par exemple . L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est de plus
en plus utilisé pour préciser certaines extensions en particulier sus glottique ou paraglottique .
La recherche de métastases ou d’un cancer concomitant (pulmonaire ou oesophagien) est
conduite en fonction des signes d’appel. Selon les équipes sont réalisés : une radiographie de
thorax ou un scanner thoracique, une échographie abdominale, une oesogastroscopie.
L’évaluation de l’état buccodentaire est systématique avant tout traitement afin de prévoir les
soins nécessaires.
2.5. Le diagnostic
A l’issue de ces explorations :
- la tumeur est typée sur le plan histologique, topographiée avec précision,
- les extensions régionales et métastatiques sont identifiées,
- l’état général du patient est évalué.
La tumeur est classée selon la classification de l’UICC ( union internationale contre le cancer
) selon trois paramètre la tumeur T , la présence de métastase ganglionnaire N ou de métastase
M.
Le dossier doit être présentée à l’unité de concertation pluridisciplinaire.
2.6. Le traitement
Elle dépend du siège et de l’extension de la lésion de sa nature histologique , de l’âge du
patient , et parfois de facteurs socioculturels ou professionnels.
2.6.1 Les méthodes
La radiothérapie peut être délivrée soit exclusivement soit en post opératoire voire plus
récemment en association avec une chimiothérapie radio sensibilisatrice .
La chirurgie comprend les laryngectomies partielle, subtotale ou totale. Selon la localisation
et l’extension elle peut être isolé ou associée à une radiothérapie post opératoire.
La chimiothérapie est proposée pour réduire le volume tumoral depuis plusieurs années mais
sa place reste encore à définir . Si elle semble éviter quelquefois le recours à une exérèse
laryngée totale, les études disponibles ne permettent pas encore une conclusion définitive et
indiscutable. Dans tous les cas , elle ne semble pas améliorer la durée de survie .
2.6.2. Les indications
La multiplicité des formes cliniques ne permet pas de dresser une liste exhaustive de ces
indications, néanmoins les grand lignes du choix thérapeutique sont :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%