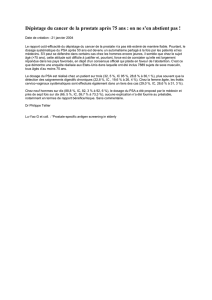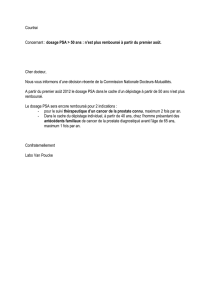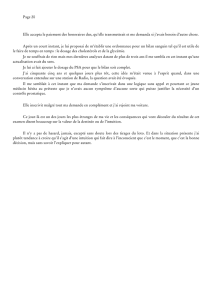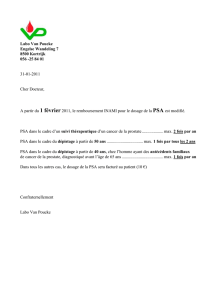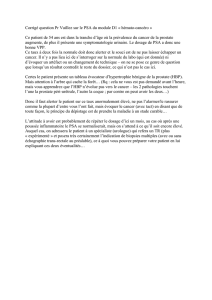Cancer de la prostate, le casse-tête du dépistage

Le Monde
Cancer de la prostate, le casse-tête du dépistage
25.08.2014 à 17h20 | Par Florence Rosier
C’est un sujet sensible : comment mieux dépister les cancers de la prostate, qui sont au
premier rang des tumeurs chez l’homme et au troisième rang de la mortalité masculine par
cancer ? Plus de 71 000 nouveaux cas annuels sont désormais enregistrés en France,
faisant 8 900 victimes.
L’enjeu est d’éviter deux écueils : passer à côté de cancers de la prostate qui vont se révéler
rapidement agressifs et diagnostiquer des tumeurs qui resteront inoffensives. Un
« surdiagnostic » qui génère de nombreux traitements inutiles et des effets indésirables
invalidants.
Tumorectomie de la prostate assistée par robot, le 10 Avril, à l'hôpital Edouard Herriot, de
Lyon. | AFP / JEFF PACHOUD
En 2009, un vif débat a opposé urologues et autorités sanitaires. Les premiers étaient
persuadés de l’intérêt d’un test généralisé par le dosage sanguin d’une petite protéine : le PSA
(antigène spécifique de la prostate). De son côté, la Haute Autorité de santé (HAS) a toujours
nié l’utilité d’un tel dépistage. Retour sur cette polémique et sur les pistes explorées pour en
sortir.
DOSAGE SANGUIN

Découvert dans les années 1980, le PSA est normalement produit par la prostate : il sert à
liquéfier le sperme. Quand la prostate développe un cancer, mais aussi quand elle
s’hypertrophie avec l’âge, elle libère davantage de PSA dans le sang. D’où les grandes études
lancées pour évaluer l’intérêt de son dosage sanguin.
Le 6 août, The Lancet a publié les données d’une de ces études : « The european randomised
study of screening for prostate cancer ». Huit pays européens ont rejoint cette cohorte, qui
regroupe plus de 162 000 hommes. Ceux-ci ont été tirés au sort pour faire partie d’un de ces
groupes : les hommes dépistés par un dosage du PSA (ceux qui sont âgés de 50 à 74 ans), et
ceux qui n’ont pas eu ce dépistage. Lorsque le taux de PSA dépassait 3 ng/ml, les hommes
étaient orientés vers une biopsie de leur prostate.
SÉQUELLES FRÉQUENTES
Après un suivi de treize ans, tous les hommes qui ont été dépistés par le PSA ont vu leur
risque de mourir de ce cancer réduit de 21 % par rapport aux hommes non dépistés. « Le
dépistage par le PSA permet une réduction notable de la mortalité par cancer de la prostate.
Cette réduction est similaire ou même supérieure à celle obtenue avec le dépistage du cancer
du sein [par la mammographie], analyse le professeur Fritz Schröder, du Centre médical de
l’université Erasmus (Pays-Bas). Pour autant, environ 40 % des cas détectés par ce dépistage
correspondent à un surdiagnostic. D’où un risque élevé de surtraitement, avec tous les effets
indésirables associés. » Les séquelles sont en effet fréquentes : en cas d’ablation totale de la
prostate, par exemple, l’incontinence urinaire touche 4 % à 39 % des hommes, et les troubles
de l’érection, 20 % à 80 % d’entre eux, en fonction des études.
« Le temps d’un dépistage en population générale [par le PSA] n’est pas encore venu, conclut
Fritz Schröder. Nous devons poursuivre les recherches en vue de trouver de nouveaux outils
pour réduire ce surdiagnostic, éviter les biopsies inutiles [des examens invasifs] et mieux
cibler les hommes susceptibles de bénéficier de ce dépistage. »
De fait, même les urologues, qui ont longtemps plaidé pour la mise en place d’un programme
national de dépistage organisé chez tous les hommes âgés de 50 à 75 ans, ne défendent plus
cette stratégie. « Le débat sur l’intérêt de ce dépistage organisé est désormais clos », tranche
Jean-Patrick Sales, de la HAS.
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MARQUEURS
Depuis 2010, l’Association française d’urologie (AFU) prône un dépistage individuel,
proposé par le médecin dans le cadre d’une consultation avec son patient. « Une détection
précoce du cancer de la prostate peut être proposée à titre individuel après information
objective pour ne pas méconnaître et laisser évoluer un éventuel cancer agressif de la
prostate. Cette détection repose actuellement sur un toucher rectal et un dosage du PSA total
chez les hommes à partir de 50 ans », indique l’AFU. « Il est essentiel d’informer les hommes
qui envisagent la réalisation d’un tel dépistage de toutes ses conséquences », insiste Jean-
Patrick Sales.
Mais que faire, chez les hommes qui ont un risque élevé de développer un cancer de la
prostate : les sujets qui ont des antécédents familiaux et les hommes d’origine afro-antillaise ?
« Ce dépistage pourrait être recommandé à partir de 45 ans chez ces hommes à haut risque »,

écrit l’AFU. De son côté, la HAS juge, depuis 2012, « qu’il n’existe pas de preuve de l’intérêt
de ce dépistage chez les hommes sans symptômes considérés comme à plus haut risque ».
« Dépister un cancer de la prostate ne veut pas dire qu’on va nécessairement le traiter, relève
le docteur Christian Castagnola, urologue, vice-président de l’AFU. Si le cancer est jugé peu
agressif, on peut proposer au patient une surveillance active, fondée sur le suivi de son
PSA. »
« NEZ ARTIFICIELS  » 
Pour sortir du débat, les espoirs se fondent sur deux pistes : le développement de nouveaux
marqueurs et les progrès des techniques d’imagerie, permettant de mieux définir l’agressivité
de ces cancers. Les médecins misent aussi sur une nouvelle génération de traitements focaux,
moins mutilants, pour les tumeurs peu évoluées.
Urologue à l’hôpital Tenon (AP-HP, Paris), le professeur Olivier Cussenot l’admet : « Le PSA
est un mauvais marqueur de dépistage : il génère trop de faux positifs. » Pour tenter de mieux
cerner le risque lié à ces cancers, les urologues peuvent doser plusieurs marqueurs sanguins
ou urinaires dont l’intérêt est à l’étude.
Le professeur Cussenot s’intéresse au dosage de molécules volatiles associées à ces cancers,
dans les urines ou dans l’air expiré. Des « nez artificiels » sont développés dans ce but,
notamment par l’université Technion, en Israël. Par ailleurs, le profil moléculaire des tumeurs
devrait permettre de mieux définir leur agressivité. Mais ce sont surtout les progrès de
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) qui, depuis deux ou trois ans, ont transformé la
donne. « L’IRM multiparamétrique permet de détecter des lésions de trois à cinq millimètres
et d’apprécier l’agressivité des tumeurs », se réjouit Olivier Cussenot.
1
/
3
100%