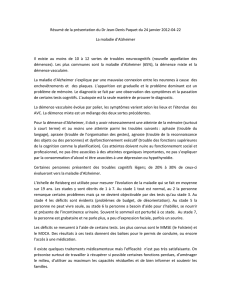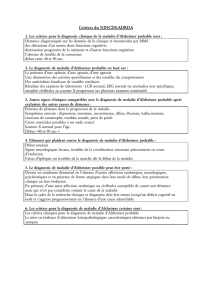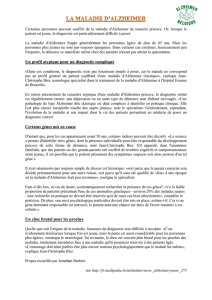Maladie d`Alzheimer - Psychologie

Maladie d’Alzheimer
P Davous
A Delacourte
Résumé.
–
D
epuis la précédente édition publiée en 1992, une somme considérable de
données nouvelles a contribué à préciser la physiopathologie de la maladie d’Alzeimer (MA),
à mieux en définir l’hétérogénéité et de nouvelles thérapeutiques sont apparues. Les
projections épidémiologiques pour les décennies à venir sont réellement alarmantes avec une
incidence possible en France de 100.000 nouveaux cas par an. Plusieurs gènes distincts ont
été identifiés dans les rares formes familiales à transmission dominante autosomique et
l’isoforme
ε
4 de l’apolipoprotéine E est un facteur de risque défini. Certaines protéines (bêta
amyloïde, tau) semblent jouer un rôle majeur dans des cascades d’événements associant
vraisemblablement des protéines de l’inflammation et des systèmes apoptotiques.
L’hypothèse cholinergique, sans être exclusive, reste d’actualité. Les critères de diagnostic
sont aujourd’hui bien définis et validés, mais restent insuffisants pour l’identification précoce
des malades. Le diagnostic, qui reste purement clinique faute de marqueurs biologiques
spécifiques, fait appel au début à une expertise neuropsychologique réservée à des centres
spécialisés. Les techniques de volumétrie hippocampique en imagerie par résonance
magnétique (IRM), de métabolisme en tomographie d’émission monophotonique peuvent
contribuer au diagnostic. L’étiologie de la maladie d’Alzheimer est toujours inconnue, mais la
plupart des modèles proposés la considèrent comme plurifactorielle. La thérapeutique reste
symptomatique, mais bénéficie de plusieurs drogues cholinomimétiques qui peuvent être
associées aux traitements des troubles psychocomportementaux. La prise en charge fait
appel à de multiples stratégies médico-psycho-sociales qui sont de mieux en mieux
structurées et contribuent à une meilleure qualité de vie des malades.
©
1999, Elsevier, Paris.
Introduction
La MAfut décrite en 1906
[2]
et individualisée quelques années plus tard par
Kraepelin comme une démence présénile. Une revue très complète de
l’évolution des idées, résultant des nombreuses études cliniques et
neuropathologiques entreprises entre 1920 et 1960, a été faite par Delay et
Brion
[34]
.En1976,Katzmanestimait quedeuxtiers descasde démencesénile
étaient des MA, et que la distinction entre les deux maladies n’était plus
justifiée. Cette évolution conceptuelle a conduit, au travers d’études
épidémiologiqueset detravauxà viséeétiopathogénique,àdéfinirdescritères
diagnostiques universellement reconnus, à développer des hypothèses
génétiques et biochimiques nouvelles, à entrevoir des perspectives
thérapeutiques
[28, 77]
. Il en est résulté une hétérogénéité génétique, clinique et
paracliniquequidevientdeplusenplusmanifesteavecledéveloppementdes
connaissances propres à chacun de ces domaines.
Épidémiologie, génétique et facteurs de risque
Épidémiologie
Dans le contexte du début du troisième millénaire, il est important de réaliser
l’augmentation considérable du nombre des sujets âgés de plus de 65 ans (en
France, de 14 % en 1990 à 20 % en 2015).Aux États-Unis, on estime que cette
population, actuellement de 35 millions, aura doublé d’ici environ 40 ans et,
parallèlement, le nombre de sujets déments. Pour l’ensemble des pays
développés, c’est une « épidémie » de 15 à 37 millions de cas de démence
attenduedesannées2000à2050, soitenviron10 à25millions decasdeMA
[71]
.
Patrick Davous : Chef de service, service de neurologie, centre hospitalier Victor-Dupouy,
69 rue du Lieutenant-Colonel-Prudhon, 95107 Argenteuil cedex, France.
André Delacourte : Directeur de Recherche, Inserm U 422 Lille, France.
Toute référence à cet article doit porter la mention : Davous P et Delacourte A. Maladie
d’Alzheimer. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Neurologie, 17-056-A-10, 1999, 15 p.
Les données épidémiologiques les plus reproductibles, issues de populations
européennes et américaines, sont aujourd’hui l’augmentation exponentielle
de prévalence et d’incidence avec l’âge, qui doublent par tranches de 5 ans
entre 65 ans et 85 ans, la plus forte prévalence féminine, la plus grande
fréquence des débuts précoces dans les formes familiales
[7, 26, 69, 75, 94, 101, 105]
.
Dans ces cohortes, la MAreprésente environ deux tiers des cas de démences
et seul le Japon fait exception avec une proportion de démences vasculaires
prochede 50 %.Certainesvariantes épidémiologiquespeuventêtre attribuées
à des facteurs ethniques.
La prévalence varie selon les pays entre 1 et 5,8 % d’une population âgée de
65ansetplus,cettevariation étantenpartie liéeàdes différencesdedéfinition
et d’identification des cas. Elle augmente considérablement avec l’ âge, pour
passer de moins de 0,1 % avant 50 ans à 1-2 % à 65 ans, et 10-30 % après
85 ans. En France, on estime la fréquence de la MA à environ 300 000 cas
dans la population âgée de plus de 65 ans
[4, 26, 101]
.
L’incidence, estimée en France à 1,17 % par an, ce qui représente près de
100 000 nouveaux cas chez les plus de 65 ans, augmenterait très fortement
avec l’âge, pour varier de 100 à 3 000 pour 100 000 habitants par an entre
65 et 95 ans
[7, 94]
. On peut donc estimer que la probabilité pour un individu
d’être atteint de MAvarie de3à30%entre 70 et 85 ans.
Dans les registres où l’affection « démence sénile et présénile » est la cause
principale du décès, le taux annuel de mortalité est de 4 pour 1 million aux
États-Unis,etaugmente régulièrementavecl’âge. Cetauxauraitété multiplié
par dix en 10 ans pour atteindre 4 pour 100 000 en 1987, tendance intéressant
les deux sexes mais touchant particulièrement les tranches d’âge
supérieures
[18]
.
L’influencede l’âge précoce de survenue de la maladie surson évolutivité est
controversée, mais plusieurs études ont conclu à une diminution de
l’espérance de vie dans les formes de MA à début précoce. Dans l’étude de
Rochester,lesfemmesatteintesde MAontuneduréedeviesupérieureàcelle
des hommes
[75]
.
La plupart des auteurs s’accordent pour distinguer deux formes de MA,
sporadiqueetfamiliale.Lesétudesde jumeauxsuggèrentque l’affectionn’est
pas expliquée par un seul gène à transmission dominante autosomique. Il a
été montré que le risque cumulatif, plus élevé chez les femmes, augmentait
defaçon exponentielle de 5 % à 70 ans à 40 %à 95 ans chez les apparentés au
premier degré
[79]
. Chez les individus ayant des antécédents familiaux de
17-056-A-10
ENCYCLOPÉDIE MÉDICO-CHIRURGICALE 17-056-A-10
© Elsevier, Paris

démence, le risque, toujours nettement supérieur aux sujets contrôles, est
estimé à 2-5 % à partir de 70 ans pour les parents au 1
er
degré, et atteindrait
prèsde50 % après 85ans
[15]
.Cerisque a étéassociéparcertainsà l’existence
de troubles du langage ou à un début précoce, mais ces résultats sont
controversés.
Génétique
Le tableau I résume les caractéristiques des principales formes de MA à
transmission génétique connues à ce jour.
Quatre gènes sont aujourd’hui impliqués dans le développement de la MA.
Trois semblent favoriser le développement précoce de la maladie chez des
sujets de moins de 60 ans :
– le gène de l’APP (amyloid precursor protein) lié au chromosome 21 ;
– le gène de la préséniline 1 (PS1) lié au chromosome 14 ;
– le gène de la préséniline 2 (PS2) lié au chromosome 1.
Le gène de l’APPest classiquement associé aux formes précoces de MAavec
sept mutations de pénétrance complète rapportées dans une vingtaine de
familles. Les gènes des présénilines sont associés à environ la moitié des
formes précoces de MAavec actuellement 54 mutations décrites pour PS1 et
seulementtroispourPS2. Environ 70 %desmutationsdesgènes présénilines
semblent génétiquement spécifiques à un individu ou une famille, ce qui rend
irréaliste tout dépistage systématique des formes précoces de MA
[11]
.En
France, on estime à environ 1000 le nombre des cas de MA précoce à
transmission dominante autosomique.
Le quatrième gène, lié au chromosome 19, détermine les trois isoformes e2,
e3,e4de l’apolipoprotéineE(apoE), protéineimpliquéedansle métabolisme
lipidique, dont l’allèle e4 est associé aux formes tardives de MA. L’allèle e4
est présent chez 45 à 60 % des MA contre 20 à 30 % dans la population
générale, et la forme homozygote dans 12 à 15 % contre2à3%,
respectivement
[11]
. Le risque de MA est plus élevé pour les homozygotes
E4E4 et varie pour certains en fonction de l’âge : plus élevé entre 60 et 69 ans
(x4) qu’avant 60 ans ou après 80 ans (x2). L’apoE4 n’étant ni nécessaire, ni
suffisant pour développer la MA, il n’est pas recommandé de l’utiliser à des
fins de dépistage diagnostique
[93]
, bien que le génotypage augmente la
sensibilité et la spécificité du diagnostic de MA chez les déments.
Contrairement aux précédents, le gène de l’apoE4 est considéré comme un
facteur de risque majeur de la maladie chez les Caucasiens, indépendant du
sexe, rendant compte d’une agrégation familiale importante. L’allèle e4
pourrait influencer la sévérité des troubles mnésiques, du déficit
cholinergique, de l’atrophie hippocampique, ainsi que la rapidité du déclin
cognitif
[22]
. Il pourrait aussi jouer un rôle dans la modulation de l’âge de
survenuedesformes génétiquement déterminées.L’allèlee2semble jouerun
rôle protecteur quels que soient les groupes ethniques, mais les populations
afro-américainesethispaniques auraient unrisqueaccrude MA, indépendant
du génotype de l’apoE. Dans la trisomie 21, le sexe mâle et la présence d’un
allèleapoE4favoriseraientundébutprécoce de la maladie
[106]
.Unautregène
de susceptibilité lié au chromosome 12 a été rapporté.
Cette hétérogénéité génétique indique que la MApeut découler d’anomalies
génétiques différentes selon les cas, qu’elle peut paraître génétiquement
simple ou complexe, qu’elle peut comporter des gènes déterminants et
d’autres de susceptibilité ou de protection. On ne peut donc exclure que la
MAsoit liée à plusieurs gènes, ou que l’expression de ce ou ces gènes et leur
pénétrance soient variables. On ne peut pas davantage écarter le rôle de
facteurs liés à l’environnement
[85]
.
Facteurs de risque
Comme nous l’avons vu précédemment, l’âge constitue le principal facteur
de prédisposition de la MA. Les facteurs génétiquement déterminés comme
les antécédents familiaux de démence et de trisomie 21, l’homozygotie E4E4
de l’apoE sont devenus des facteurs de risque établis. La prépondérance
féminine de l’affection est signalée dans de nombreux travaux mais non dans
tous, cette discordance reflétant probablement des biais de recrutement. On
retrouve la même discordance pour le rôle de l’âge de la mère à la naissance,
les antécédents de traumatisme crânien, de pathologie thyroïdienne,
dysimmunitaire, virale ou psychiatrique.
D’autres facteurs de risque, apparus ces dernières années, restent à évaluer
mais contribuent à donner à la MA une apparente hétérogénéité : ainsi le
niveau d’instruction et les conditions socioéconomiques, les facteurs de
risque vasculaires comme l’hypertension artérielle et l’athérosclérose, des
facteurs d’environnement ou de mode de vie comme les antécédents de
traumatisme crânien, les effets protecteurs éventuels du tabac ou du vin, le
rôle de certaines thérapeutiques prises au long cours comme les anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou les œstrogènes
[4, 26, 45, 86]
. Tous ces
facteurs, susceptibles d’être influencés par des caractères génétiques, n’ont
probablement pas la même signification mais leur polymorphisme apparent
obscurcit notablement une vision simple de la maladie.
Lésions cérébrales de la maladie d’Alzheimer
Le diagnostic clinique de MA est confirmé lorsque l’examen
neuropathologique permet de démontrer la présence de deux types de lésions
cérébrales : les plaques séniles et les neurones en dégénérescence
neurofibrillaire(DNF), enabondancedans lasubstancegrise dunéocortex
[65]
.
Ces lésions ont été identifiées au début du siècle, grâce aux techniques
histologiques d’imprégnation argentique
[2]
. La caractérisation
immunochimique de ces lésions, à partir des années 1984, permet de
distinguer deux processus dégénératifs distincts à l’origine de ces lésions :
l’amyloïdogenèse et la DNF. En parallèle à ces lésions, on peut observer
d’autres modifications cérébrales, macroscopiques (atrophie, dilatation
ventriculaire) et microscopiques (perte neuronale, réaction gliale et
microgliale, altération des microvaisseaux).
Amyloïdogenèse (fig 1)
Dans la substance grise du cortex cérébral des patients Alzheimer abondent
des dépôts de substance amyloïde, sphériques, plus ou moins compacts. Il
s’agit des plaques amyloïdes, très bien colorées par des colorants tels que le
rouge Congo ou la thioflavine (fig 1A). Les propriétés tinctoriales de la
« substance amyloïde » résultent de l’assemblage compact de protéines
dénaturées sous forme de feuillets âplissés. À l’échelle de la microscopie
électronique, la substance amyloïde est formée de filaments compacts, de 6 à
10 nm de diamètre, situés dans le domaine extracellulaire.
D’une manière générale, la nature des protéines formant la substance
amyloïde varie en fonction du type de pathologie (la plaque prion de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob est formée de protéines PrP ; la transthyrétine
peut s’accumuler dans le tissu nerveux périphérique sous forme de dépôts
amyloïdes, etc). Dans le cas de la MA, la substance amyloïde est constituée
d’un polypeptide de 39 à 43 résidus d’acides aminés, appelé peptide Aâ
(amyloïde bêta). Ce peptideAâest un fragment protéolytique d’une protéine
de grande taille nommée APP (amyloid protein precursor) (fig 2). Des
anticorps dirigés contre le peptideAâsynthétique détectent avec une grande
sensibilité les plaques amyloïdes, ainsi que des dépôts diffus nommés dépôts
préamyloïdes puisqu’ils ne possèdent pas encore les propriétés
physicochimiques de la substance amyloïde (fig 1B). Ces dépôts
préamyloïdes et amyloïdes envahissent la presque totalité du cortex cérébral
et diffusent essentiellement dans la substance grise corticale, et plus
particulièrement dans les couches néocorticales II et III. Ils sont également
présents dans la région hippocampique. Dans le cervelet, seuls les dépôts
préamyloïdessontobservés.LepeptideAâs’accumuleégalement, à des taux
variables, dans la paroi des artérioles et des capillaires pour former
l’angiopathie amyloïde
[16]
. L’utilisation combinée de techniques
histologiques et immunochimiques permet de distinguer des plaques
neuritiques,constituéesd’uneplaqueamyloïdeentouréeparune couronne de
neurites en DNF (fig 1C). L’utilisation histologique d’autres marqueurs
indique que les cellules microgliales, cellules similaires à des macrophages,
sont souvent au contact des plaques séniles, ainsi que des astrocytes
hypertrophiés.
À l’échelle moléculaire, on constate que d’autres protéines sont également
présentes dans les plaques séniles. Certaines sont les témoins d’une réaction
inflammatoire : il s’agit d’antiprotéases tels l’α1-antichymotrypsine, des
facteurs du complément (C1q, membrane attack complement ou MAC). Une
trentained’autres composésontété décrits,enparticulierlaprotéineamyloïde
P, la protéine présynaptique NACP nommée également α-synucléine, des
héparanes sulfates protéoglycanes, l’apoE, etc,
[116]
.
Enfonction detousces éléments,onpeutproposerunscénariosurlacinétique
de formation et de catabolisme des plaques séniles : le peptide Aâs’agrège
progressivementdans le domaine extracellulaire sous forme de dépôts diffus,
avec une prédominance du peptide Aâ1-42. Puis ces dépôts deviennent de
plusen pluscompacts,pour formerdesplaques amyloïdesdenses,constituées
dupeptideAâmajoritairement1-40.Enfin,autourdecesplaques« matures »
sont observés des neurites en DNF, formant la plaque sénile telle que décrite
parAlzheimer (fig 1C). Ces plaques seront « digérées » progressivement par
les cellules microgliales et les astrocytes, tandis que d’autres plaques se
formeront en parallèle. Un point important reste à élucider, qui fait l’objet de
controverses intenses : la relation entre la formation des dépôts de Aâd’une
part, et la dégénérescence neuronale ou la mort neuronale d’autre part. Ce
point sera abordé après la description du deuxième type de lésion : la DNF.
Tableau I. – Facteurs génétiques et maladie d’Alzheimer.
Gène APP PS1 PS2 APOE
Chromosome 21 14 1 19
Transmission AD AD AD+/- POLY
Mutation (N) 7543 -
Âge de début 40-65 30-55 40-90 >40
Fréquence (N familles) > 20 > 100 < 10 (Volga)
AD : Autosomique dominant
MALADIE D’ALZHEIMER Neurologie17-056-A-10
page 2

Dégénérescence neurofibrillaire (fig 3)
La DNF peut être visualisée par les techniques d’imprégnation argentique,
mises au point au début du siècle (fig 3A) et utilisées par Alzheimer dans sa
description princeps. La DNF correspond à une accumulation intraneuronale
de fibrilles formées de filaments très caractéristiques, appelés les paires de
filamentsappariéesen héliceouPHF (pairedhelicalfilaments).Cesfilaments
pathologiques sont d’excellents marqueurs ultrastructuraux du processus
dégénératif de type Alzheimer (fig 3B). Les PHF sont également observés
dans les neurites en dégénérescence qui abondent dans le neuropile et à la
périphérie des plaques séniles. Les protéines microtubulaires Tau sont les
constituants majeurs des PHFs. Dans le neurone normal, ces protéines
stabilisent les microtubules qui sont des filaments du cytosquelette jouant un
rôle prépondérant dans les mécanismes de transport intraneuronal
[32]
.Au
cours de la MA, les protéines Tau s’agrègent sous forme de PHF. Ces
protéinessontanormalement phosphorylées surquelquessites.Des anticorps
dirigés contre ces sites de phosphorylation anormale permettent une
visualisation et une quantification spécifiques de la DNF sur les plans
histologiques (fig 3D, E) et biochimiques. Au total, les protéines Tau sont
d’excellents marqueurs immunochimiques du processus de DNF.
L’observation histologique des régions cérébrales de patients Alzheimer
montrequelaDNFaffecte principalementlarégion hippocampique—cortex
entorhinal(fig 3C),en particulier le champ CA1 de l’hippocampe (fig 3D) —
1Immunohistochimie des plaques amyloïdes. Coupes de cortex cérébral d’un patient
atteint par la maladie d’Alzheimer.
A. Plaques amyloïdes colorées par la thioflavine (fluorescence jaune). Certaines pla-
ques ont un cœur dense de substance amyloïde.
B. Coloration immunochimique des dépôts amyloïdes avec un anticorps antipeptide
amyloïde Aâ. Noter la disposition laminaire des dépôts. Certains dépôts sont diffus. Il
s’agit de la substance préamyloïde (flèche).
C. Plaque sénile révélée par une double coloration. Le dépôt amyloïde central est
marqué par la thioflavine. Les neurites dystrophiques périphériques sont immunomar-
qués par un anticorps dirigé contre les protéines tau-PHF.
AB
C
2
Protéine APP (
amyloid protein precursor
) et peptide amyloïde
Aâ.
Protéine APP : le gène de l’APP, d’une taille de 400 kb, est situé sur le
chromosome 21 21->21q22.1. Il comporte 18 exons. Suite à un épissage
alternatif, plusieurs ARN messagers de la protéine APP sont exprimés
dansles neurones.Les isoformesde l’APP contiennent 365à770 acides
aminés. La forme longue de la protéine APP est représentée ici. Sont
représentées les différentes régions fonctionnelles de l’APP, ainsi que la
séquence du peptide Aâ, partiellement ancrée dans la membrane. La
partie N-terminale de l’APP est située dans le domaine extracellulaire
lorsque l’APP est ancrée à la membrane cytoplasmique. L’APPse trouve
égalementancréeauxmembranesvésiculaires,aveclapartieN-terminale
dirigée vers la partie intérieure. Les mutations pathologiques directement
responsables de formes familiales autosomiques dominantes portent sur
des changements d’acides aminés situés dans la région du peptide Aâ
(flèches). L’α-sécrétase est une activité protéolytique qui libère la partie
extracellulairede l’APP,nomméesAPP(
solubleAPP
).Plusieursrégions
delasAPPpossèdentuneactiviténeurotrophique.Ilyaégalementdes
régions d’interaction potentielle avec le cuivre (Cu), le zinc (Zn), l’hé-
parine,lecollagène(COL).DanslapartieC-terminale,ilyaunerégion
d’interactionpotentielleavecuneprotéineGo.Cecisuggèrequel’APP
pourrait être un récepteur couplé aux protéines G.
P
eptideAâ: la région de l’ARN messager qui code pour le peptide Aâest
située à cheval sur les exons 16 et 17. Les mutations pathologiques
situées dans la région codante deAâsont indiquées. La région protéique
du peptide Aâest partiellement ancrée dans la membrane. Suite à une
coupure enzymatique par des bêta et gamma-sécrétases, le peptide Aâ
est libéré. Il est constitué de 39 à 43 acides aminés. Le peptide amyloïde
de4,2 kDa estun produitnormal du métabolismecellulaire. Ilexiste deux
formes majeures : le peptide 1-40 et le peptide 1-42. La production de la
forme 1-42 est augmentée dans les formes familiales de la maladie
d’Alzheimer.LepeptideAâcomporte une région13-16(HHQK)qui estun
domaine d’interaction avec les cellules microgliales et les héparanes
sulfate.
MALADIE D’ALZHEIMERNeurologie 17-056-A-10
page 3

et les grandes cellules pyramidales des couches II, III et V de la substance
grisecorticale(fig 3C). Lesrégionscérébrales lesplusaffectées sontlarégion
hippocampique, le cortex temporal et les régions polymodales associatives
(cortex préfrontal, cortex temporal supérieur, cortex pariétal), c’est-à-dire
celles qui intègrent les informations venant de tous les territoires cérébraux
(fig 2). Les régions les moins affectées sont sensitives ou motrices (cortex
occipital visuel, cortex frontal moteur)
[41]
.
La DNF est un processus dégénératif qui s’installe progressivement dans les
différentes aires cérébrales, selon une séquence et une hiérarchie qui ont été
précisées par les neuropathologistes
[5, 41]
. Tout d’abord, la DNF est un
processus qui semble lié à l’âge et à la région hippocampique (cortex
transentorhinal, entorhinal et CA1 de l’hippocampe). Des neurones en DNF
peuventêtrevisualisés parfoisdèsl’âge de50anset lesontsystématiquement
dans la population normale à l’âge de 75 ans
[14]
. Il existe une phase
infraclinique de la MA avec une extension de la DNF dans les régions
temporales(pôletemporal, temporalinférieur,temporalmoyen)
[33]
.Laphase
clinique correspond à la présence de la DNF dans les régions corticales
associatives (temporal supérieur, pôle frontal, cortex pariétal)
[41]
. Aux
derniers stades de la maladie, la DNF peut envahir la totalité des aires
cérébrales et de nombreux noyaux sous-corticaux (fig 4).
Les anticorps anti-Tau permettent également de révéler une signature
biochimique de la DNF et d’en établir une cartographie biochimique
cérébrale
[114]
.Latechniquedesimmunoempreintesmet enévidenceun triplet
de protéines Tau pathologiques dans la MA (Tau 55, 64, 69). L’approche
biochimique permet de distinguer 10 stades qui correspondent à 10 régions
cérébrales qui sont touchées successivement par la DNF au cours de la MAet
dedistinguertrois groupes :levieillissement« normal »(stadesS0à S3)avec
une atteinte systématique de la région entorhinale pour les témoins non
déments âgés de plus de 75 ans (S1 à S3) ; une phase infraclinique allant
jusqu’au stade S6, pour les patients qui possèdent de nombreuses plaques
amyloïdes, et une phase clinique (stages7à10)
[33]
(fig 4).
3Aspectshistologiquesetimmunochimiquesdeladégénérescenceneurofibrillaire(DNF).
A. Coloration du tissu cérébral par une imprégnation argentique. Coloration des neuro-
nes en DNF et des plaques neuritiques (flèche).
B. Paires de filaments en hélice (PHF) de la DNF. Observation en microscopie électro-
nique. Noter la périodicité des hélices (têtes de flèches). Les filaments appariés ont un
diamètre de 10 nm.
C. Immunomarquage du cortex entorhinal par un anticorps contre les protéines Tau
pathologiques (PHF-tau).
D. Immunomarquage avec le même anticorps dans la région CA
1
de l’hippocampe
(flèches).
De nombreuses cellules pyramidales, ainsi que des plaques neuritiques sont immuno-
marquées.
E.Mêmeimmunomarquagedanslarégionfrontaleducortexcérébral.Onpeutobserver
un réseau de neurites en DNF, ainsi que des corps cellulaires marqués et quelques
plaques neuritiques.
AB C D
E
4Distribution des lésions de la maladie d’Alzheimer au cours
du vieillissement cérébral et de la maladie d’Alzheimer.
Au cours du vieillissement cérébral normal, le processus de
dégénérescence neurofibrillaire (DNF) s’installe dans la région
hippocampique.Ilestsystématiquementprésent,maisàdestaux
variables, à l’âge de 80 ans.
Au cours de la maladie d’Alzheimer, les dépôts de substance
amyloïdediffusentd’unemanièrehétérogènedanslesdifférentes
régions corticales, bien avant les manifestations cliniques. En
revanche, le processus de DNF progresse dans les régions cor-
ticalesselonuncheminprécis,selon6ou10 stades
[33]
.Jusqu’au
stade 6, la DNF peut rester asymptomatique. Le stade 7 corres-
pond à l’atteinte simultanée de nombreuses régions associati-
ves ;ilesttoujoursassociéàdestroublescognitifs.Lestade9est
hétérogène, avec une atteinte du cortex moteur (S9a) ou du
cortexoccipital(S9bet c). LaDNFpeutenvahirtouteslesrégions
corticales au dernier stade de la pathologie.
MALADIE D’ALZHEIMER Neurologie17-056-A-10
page 4

Perte neuronale
Elle est, pour diverses raisons méthodologiques, difficile à quantifier.
L’épaisseur du cortex est peu modifiée, ce qui suggère qu’il y a plutôt
disparition de colonnes corticales et une diminution de la longueur du ruban
cortical
[42]
. L’examen histologique ne donne qu’une vue très imparfaite de la
perte neuronale, puisque l’on voit ce qui reste, plutôt que ce qui a disparu. Il
n’en demeure pas moins que la souffrance neuronale est souvent extrême,
visualisée par la DNF qui affecte les réseaux neuronaux dans de nombreuses
aires cérébrales, et par une diminution importante de la concentration en
terminaisons synaptiques.
Gliose réactionnelle
Une réaction gliale importante est observée parallèlement à la perte
neuronale. Elle est visualisée sur coupe histologique par la présence
d’astrocytes hypertrophiques, et démontrée biochimiquement par
l’augmentation considérable des taux de GFAP (glial fibrillary acidic
protein),protéine debasedesfilaments gliaux.Lerôle desastrocytesaucours
de la gliose est principalement de phagocyter les neurones morts. On observe
également une importante concentration de cellules microgliales, qui ont un
rôle de phagocytose des lésions cérébrales et participent à la réaction
inflammatoire.
Systèmes de neurotransmetteurs
Système cholinergique
C’estlesystème quiestatteintle plus précocement.L’activitédel’enzyme de
synthèse de l’acétylcholine, la choline-acétyltransférase (ChAT), est
anormalement basse dans le cerveau des patientsAlzheimer, surtout dans les
régions affectées par la maladie comme l’hippocampe et le cortex cérébral.
Les neurones cholinergiques sont situés essentiellement dans le septum, avec
des projections vers l’hippocampe et le noyau basal de Meynert, avec des
projections diffuses vers le cortex. Les biopsies corticales pratiquées au stade
précoce de la MA ont révélé essentiellement un déficit cholinergique.
L’acétylcholinestérase (AchE) dégrade l’acétylcholine au niveau de la fente
synaptique (fig 5). Les molécules qui inactivent cette enzyme augmentent les
taux d’acétylcholine, avec un effet bénéfique sur la stimulation des fonctions
cognitives, voire comportementales, des patients Alzheimer. Ces molécules
(tacrine, rivastigmine, donepezil) sont la base des traitements
symptomatiques actuels contre la MA
[55]
. Cette action bénéfique est possible
parce que les récepteurs muscariniques situés sur les neurones
postsynaptiques sont relativement épargnés. Les récepteurs muscariniques
sont liés aux protéines G. Ils jouent un rôle important dans la mémoire de
travail. Les récepteurs nicotiniques sont des canaux ioniques, situés
essentiellement du côté présynaptique, avec une action sur le relargage
d’acétylcholine.Lesagonistesmuscariniquesetnicotiniques pourraientavoir
une activité pharmacologique intéressante
[76]
, en cours d’exploration
actuellement.
À noter qu’il semble exister un lien entre le métabolisme de l’APP et de
l’acétylcholine, qui fonctionne dans l’un des deux sens suivants :
– laproduction d’Aâbloquelafonction cholinergique :lepeptideAâsoluble
semblebloquer lerelargagedel’acétylcholinetandis quelepeptideAâagrégé
bloque le transport des lipides et le flux de choline
[6]
;Aâpeut jouer
également une action neurotoxique sur les cellules cholinergiques ;
– inversement, la stimulation des récepteurs muscariniques M1 augmente la
libération de sAPP et diminuerait la production de Aâ; la partie soluble de
l’APP(sAPP), libérée dans le domaine extracellulaire après coupure par l’α-
sécrétase (fig 2, 5), stimule l’acétylcholine-transférase et exerce son action
neurotrophique.
Autres systèmes de neurotransmetteurs
La DNF va s’étendre rapidement à de nombreuses régions corticales et sous-
corticales, ce qui explique que de nombreux systèmes de neurotransmetteurs
soient atteints. À vrai dire, aucun système ne semble épargné, qu’il soit
glutamatergique, monoaminergique ou GABAergique.
Les neurones corticaux pyramidaux de projection (projections
corticocorticales ou sous-corticales) synthétisent des aminoacides
excitateurs, comme le glutamate ou l’aspartate, qui leur servent de
neurotransmetteurs. Les grandes cellules pyramidales atteintes par la DNF
sont glutamatergiques.
Parmi les systèmes de neurones corticaux intrinsèques, plusieurs catégories
semblentatteintes,comme lesneuronessynthétisantdes neuropeptides telsla
somatostatine ou le CRF. Les neurones GABAergiques les plus atteints sont
ceux qui contiennent de la somatostatine
[12]
.
Il existe un déficit des systèmes monoaminergiques dont les corps cellulaires
d’origine sont situés dans le tronc cérébral (systèmes noradrénergiques ou
sérotoninergiques). Ces systèmes appartiennent, comme les voies
cholinergiques, à la catégorie des systèmes à projections diffuses. En effet,
ces réseaux neuronaux innervent de vastes régions du cerveau, dont le cortex
et l’hippocampe. Leur atteinte semble moins constante que l’atteinte des
systèmes cholinergiques, et peut être limitée aux formes à début précoce,
toujours sévèrement affectées. Les taux de noradrénaline sont abaissés dans
le cortex et il existe une perte neuronale variable, parfois importante dans le
locus coeruleus, où sont situés les corps cellulaires d’origine des voies
noradrénergiques. Cette perte neuronale a été corrélée avec l’existence
clinique d’une dépression. De même, une perte neuronale dans les noyaux du
raphé entraîne une baisse de taux de sérotonine dans le cortex.
Au total, on observe un effondrement progressif des systèmes de
neurotransmetteurs qui suit la progression du processus dégénératif. Cette
progressions’effectue enfonctionde lavulnérabilitédecertaines populations
neuronales (cortex entorhinal, hippocampe, amygdale et noyau basal de
Meynert), selon des voies corticocorticales puis cortico-sous-corticales
[91]
.
Physiopathologie
Deux sources importantes d’informations, génétiques et anatomocliniques,
permettent de préciser la cascade d’événements qui vont provoquer la
destruction de nombreux réseaux neuronaux et l’atteinte des fonctions
intellectuelles.
5Relation entre le métabolisme de la protéine APP et le
système cholinergique.
Le métabolisme de l’acétylcholine est régulé par deux enzymes:
l’acétylcholine-transférase(ChAT)quipermetsasynthèseàpartir
de la choline et de l’acétylcoenzyme-A, et l’acétylcholinestérase
qui coupe la molécule en acétate et choline. Les anticholinesté-
rasiques (tacrine, ENA713, donepezil, metrifonate, etc) inhibent
le catabolisme de l’acétylcholine, et augmentent les concentra-
tions d’acétylcholine dans la fente synaptique.
L’acétylcholine active les récepteurs muscariniques et nicotini-
quesdesneurones postsynaptiques
[76]
.Cetteactivation semble
interférer sur le métabolisme de l’APP, en favorisant la libération
de sAPP dans le domaine extracellulaire. La sAPP possède des
domaines à activité neurotrophique (cf fig 3) et active la ChAT.
Lorsque le métabolisme de l’APP provoque la libération du pep-
tideAâen excès, une action négative est observée au niveau du
catabolismedel’acétylcholine :ilyainhibitiondurelargaged’acé-
tylcholine,diminutiondutransportdeslipidesetdufluxdecholine,
ainsi qu’une neurotoxicité probable vis-à-vis des neurones choli-
nergiques.
MALADIE D’ALZHEIMERNeurologie 17-056-A-10
page 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%