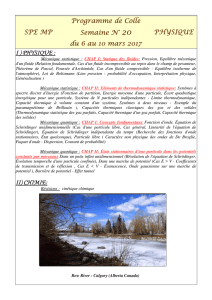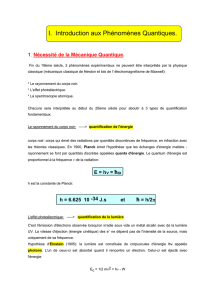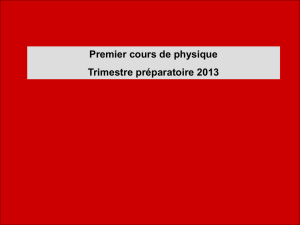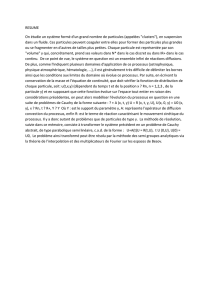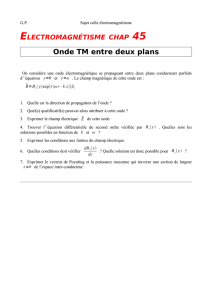PHYSIQUE QUANTIQUE ET STATISTIQUE PHYS-H-200

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
Faculté des sciences appliquées
Bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil
Deuxième année
PHYSIQUE QUANTIQUE ET STATISTIQUE
PHYS-H-200
Daniel Baye
revu par Jean-Marc Sparenberg
2011-2012

Avant-propos
Le cours de physique quantique et statistique, de même que les notes correspon-
dantes, est divisé en deux parties. La première partie constitue une introduction rel-
ativement étendue à la physique quantique, c’est-à-dire la branche de la physique qui
tente de décrire le monde microscopique. Les notions de base y sont présentées, puis
complétées par des exemples d’applications à la physique atomique, à la physique
moléculaire, à la physique du solide et à la physique nucléaire. La seconde partie con-
stitue une brève introduction à la physique statistique, c’est-à-dire la branche de la
physique qui tente de déduire les propriétés des systèmes macroscopiques de celles
de leurs constituants microscopiques. Les notions de base de la physique statistique
d’équilibre y sont présentées, puis complétées par des applications aux systèmes macro-
scopiques les plus simples, à savoir les gaz. Dans cette seconde partie, afin de donner
un maximum de cohérence au cours, un accent particulier est mis sur les liens en-
tre physique quantique et physique statistique. Ce choix est relativement atypique, la
plupart des cours de physique statistique se basant sur la mécanique classique.
Conseils pour le travail de l’année
Les principales difficultés liées à ce cours sont
– la quantité de matière, très ambitieuse au vu du nombre d’heures, liée au fait
qu’il s’agit du seul cours de « physique moderne » pour la plupart des étudiants
en sciences appliquées ;
– le niveau d’abstraction des concepts physiques, spécificité de ces disciplines assez
éloignées du sens commun et de l’intuition;
– les mathématiques, qui font appel à des notions parfois avancées d’analyse, d’algè-
bre, de géométrie et de statistique.
Le cours oral introduit la matière de manière synthétique, avec un accent partic-
ulier sur la compréhension des concepts physiques les plus subtils et des calculs les plus
complexes. Il se veut didactique, autonome et enthousiasmant, les physiques quantique
et statistique étant des disciplines extrêmement fascinantes, en particulier de par leur
caractère récent et encore inachevé. Des diapositives, disponibles sur le site de l’uni-
versité virtuelle une semaine avant le cours oral, sont projetées en support de celui-ci.
Elles sont essentiellement destinées à être imprimées sur des demi-pages et à servir de
support à la prise de notes écrites durant le cours. La fréquentation assidue et attentive
du cours, avec prise de notes, est évidemment chaudement recommandée.
i

Les syllabi constituent un complément indispensable au cours oral, leur lecture
permettant d’approfondir la compréhension de la matière, en particulier des calculs,
à un rythme personnel. Le texte est divisé en chapitres et en annexes. Le contenu
des chapitres, proche du cours oral, fait partie de la matière d’examen, sauf mention
explicite au cours oral. Les annexes contiennent soit des compléments mathématiques,
soit des applications physiques importantes qu’il n’est pas possible de voir pendant
les leçons, soit des explications un peu plus difficiles ou trop longues pour être vues
en détails au cours oral. Sauf mention explicite au cours oral, ces annexes ne font pas
partie de la matière à étudier et sont essentiellement destinées à servir de référence ou de
complément d’information aux étudiants les plus intéressés. La lecture approfondie des
syllabi, avec établissement rigoureux des étapes de calculs intermédiaires, est également
chaudement recommandée.
Enfin, les séances d’exercices sont essentielles pour la compréhension de cette matière
peu intuitive. Elles suivent le cours de près et sont en grande partie destinées à cla-
rifier des concepts ou des formules qui ne sont pas faciles à comprendre pendant un
cours ex cathedra. La matière abordée lors de ces séances fait également partie de la
matière d’examen. Une participation active et personnelle aux exercices est une façon
assez simple et très efficace d’améliorer ses chances de réussite. Recopier la solution
d’un autre étudiant ou lire un corrigé donnent le plus souvent une fausse impression
de compréhension.
En cours d’année, des questions peuvent être posées tant au titulaire (par exemple à
l’issue d’un cours) qu’aux assistants (par exemple au cours des séances d’exercices). Par
ailleurs, un forum de discussion, tenu à jour par ces mêmes personnes, est disponible sur
l’université virtuelle. Son utilisation est fortement encouragée car les réponses qui y sont
formulées sont accessibles à l’ensemble des étudiants. Pour les questions également, un
travail continu tout au long de l’année est préférable à un travail précipité à l’approche
de la session. Comprendre prend du temps !
Conseils pour l’étude et l’examen
Un premier test des connaissances est organisé en janvier, au terme de la première
moitié du cours théorique. Ce test, obligatoire, intervient dans la note finale ; il est
destiné à faciliter la participation aux exercices du second semestre. Les examens de juin
et d’aout comportent une partie écrite et une partie orale, toutes deux obligatoires pour
tous les étudiants. La partie écrite consiste en la résolution d’exercices du type de ceux
réalisés lors des séances et en la restitution rigoureuse et complète de démonstrations
théoriques présentées dans le cours oral et dans les syllabi. La partie orale consiste en
un court examen (20 minutes par étudiant, sans préparation) au cours duquel deux
brèves questions de restitution sont posées. Pour chaque question, l’étudiant fait un
bref exposé au tableau, au cours duquel sont évalués sa connaissance du cours et son
esprit de synthèse ; s’ensuit une courte discussion au cours de laquelle est évaluée sa
compréhension des concepts présentés et du cours dans son ensemble. Les examens
écrits se font sans note, alors qu’un syllabus vierge de toute note manuscrite est mis à
disposition pour l’examen oral.
ii

La pondération de ces différentes épreuves dans la note finale est la suivante :
– en première session : 20% pour le test de janvier, 50% pour l’écrit de juin, 30%
pour l’oral ;
– en seconde session : 70% pour l’écrit, 30% pour l’oral.
La meilleure manière d’aborder ces épreuves est d’étudier ce cours (comme probable-
ment la plupart des cours) avec une approche « horizontale » en « couches successives »,
c’est-à-dire en commençant par les principes généraux de l’ensemble du cours (s’aider
en particulier de la table des matières), puis en passant progressivement à des niveaux
de moins en moins généraux (s’aider en particulier des diapositives), pour finir par les
détails (s’aider en particulier du syllabus). Cette approche s’oppose à l’étude « page
par page » qui est déconseillée. Détaillons les étapes de ce processus d’apprentissage :
1. Apprendre quels sont les grands thèmes du cours, chapitre par chapitre. (Puis-je
les expliquer simplement ? Puis-je définir les principales notions : un atome ? une
molécule ? un postulat ? la physique statistique ? etc.)
2. Identifier les concepts importants et les formules importantes ; comprendre leur
but et éventuellement leur représentation graphique. (Est-ce que je connais la
définition précise des différentes grandeurs apparaissant dans cette formule ? leurs
dimensions et unités ? Est-ce que je connais les grandeurs portées en abscisse et
en ordonnée dans ce graphique ? leurs unités ? Dans quel cas puis-je utiliser cette
formule ?). Connaitre les définitions et valeurs des constantes fondamentales du
cours (avec unités !). Être capable de donner un exemple illustrant une définition
ou un exemple d’application d’une formule.
3. Comprendre et retenir le principe du raisonnement qui conduit à une formule :
hypothèses de départ, méthode de calcul utilisée, astuces éventuelles. Être capa-
ble de porter des résultats d’un calcul en graphique (La fonction est-elle positive ?
monotone ? quelle est sa valeur à l’origine ? à l’infini ?) et de faire des commen-
taires sur ces résultats. Comprendre les buts et le principe des expériences décrites
(Est-ce que j’en comprends le schéma ? Suis-je capable de refaire ce schéma ?).
4. Étudier les calculs dans les démonstrations. Ceux-ci doivent être refaits par écrit,
si possible assez longtemps avant l’examen. (Ai-je compris le passage d’une équa-
tion à l’autre ? Sinon, ai-je posé la question sur le forum « cours » de l’université
virtuelle ?). Enfin, étudier les détails ou cas particuliers qui sont donnés.
Il est enfin conseillé de faire un résumé personnel. Rédiger le résumé forme l’esprit
de synthèse et aide la mémorisation. Le résumé d’un autre n’a pas ces deux avantages.
Les deux premières étapes ci-dessus complétées par certains schémas constituent le
contenu typique d’un bon résumé.
Votre avis nous intéresse
Tant le titulaire que ses assistants sont intéressés par l’avis et les critiques construc-
tives des étudiants sur le cours, les exercices et les examens, aussi bien au niveau du
fond que de la forme et de l’organisation. Ce retour peut être transmis lors de la prise
des avis pédagogiques, qui sont particulièrement appréciés, ainsi que sur l’université
virtuelle où un forum de discussion anonyme est disponible à cet effet.
iii

Table des matières
I Physique quantique 1
1 Introduction 2
1.1 Fondements microscopiques de la physique . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 L’espace-temps et la relativité restreinte . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Le modèle standard des particules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 Les quatre interactions fondamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5 Loisdeconservation ............................ 12
1.6 Mécanique quantique non relativiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2 Les origines de la physique quantique 16
2.1 Les spectres atomiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2 LaconstantedePlanck........................... 18
2.3 Particules de lumière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4 Ondesdematière.............................. 21
2.5 Dualité onde-particule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Annexe 2A : Effet photoélectrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Annexe2B:EffetCompton ........................... 29
3 L’équation de Schrödinger 32
3.1 Origine.................................... 32
3.2 Équation d’onde d’une particule libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3 Particule dans un puits de potentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.4 Équation de Schrödinger stationnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Annexe 3A : Propriétés d’un paquet d’ondes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Annexe 3B : Étalement d’un paquet d’ondes gaussien . . . . . . . . . . . . . 42
Annexe 3C : Formalisme de Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Annexe 3D : Méthode de séparation des variables . . . . . . . . . . . . . . . 45
4 Principes de la mécanique quantique 46
4.1 Introduction................................. 46
4.2 Propriétés mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.3 Postulat sur l’état d’un système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.4 Postulats sur les mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.5 Postulat d’évolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.6 Règle de correspondance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.7 Principe de superposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.8 Relations d’incertitude de Heisenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
iv
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
 296
296
 297
297
 298
298
 299
299
 300
300
1
/
300
100%