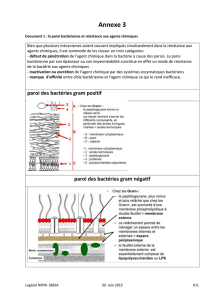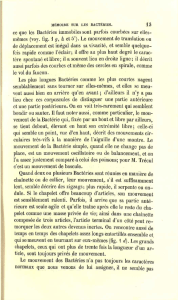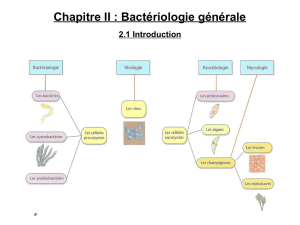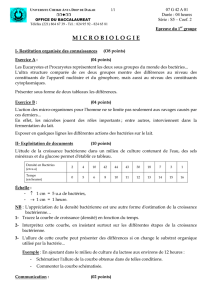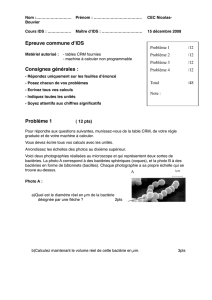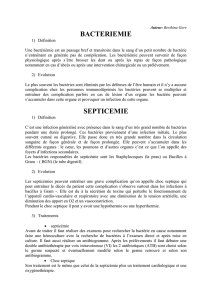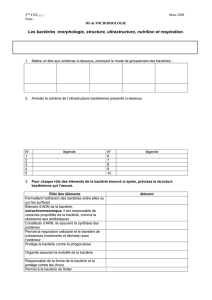UE 2 C 3 UE 2.10 intervenant: Dr ROUGIER I. DEFINITION Les

UE 2
C 3 UE 2.10
intervenant: Dr ROUGIER
I. DEFINITION
Les bactéries:
Les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires, de petite taille (1µ de diamètre)
Ce sont des cellules Procaryote c'est à dire des cellules qui ne possèdent qu'un seul chromosome et
qui sont dépourvu de membrane nucléaire.
La bactérie est également dépourvu d'appareil mitotique, n'a pas de mitochondrie, pas de réticulum
endoplasmique et pas d'appareil de golgi.
Par contre la plupart des bactéries possède un constituant qui leur est spécifique: le peptidoglycane
II. L'ANATOMIE
A. LES ENVELOPPES
1. Le Glycocalyx
C'est un feutrage, un ensemble de fibres qui entoure les bactérie et qui permet d'adhérer a un
support.
2. La Capsule
Constituant superficiel. Il n'existe que chez certaines bactéries. Donc ce n'est pas
indispensable a la survie de la bactérie. Si capsule = bactérie plus virulente.
3. La paroi
Enveloppe rigide qui va assurer la forme de la bactérie. C'est un élément essentiel. Elle va
donc classifier les bactéries.
–Bactéries sphériques: cocci / coques
–bactéries allongées: bacilles
–bactéries de formes spiralées
C'est la paroi qui contient le peptidoglycane. Et en fonction de sa quantité dans la paroi ça va
définir un autre mode de classement. Le GRAM + / GRAM -
–beaucoup de peptidoglycane: GRAM + (rose foncé)
–peu de peptidoglycane: GRAM - (rose clair)
c'est le site d'action des pénicilline (casser la paroi)
1
BACTERIOLOGIE

4. La membrane cytoplasmique
Situé à l'intérieur, sous la paroi, va présenter des invaginations dont le mésosome. Elle est
importante car elle va avoir le même rôle que les mitochondries dans les cellules eucaryotes. De très
nombreuses enzymes: donc rôle très important. C'est elle qui va avoir tout le système de transport
des acides aminés.... c'est elle aussi que va déclencher la division bactérienne: SCISSIPARITE ( 20
MIN pour se diviser ).
B. LES CONSTITUANTS INTERNES
1. Le cytoplasme
Mélange de substances nutritives ,de déchets et de Ribosomes (soupe)
2. Le chromosomes
filament d'adn, bicaténaire, 1000 fois plus long que la bactérie elle même. C'est lui qui porte
toute l'information génétique de la bactérie. Avant la division, synthèse d'1 2ème chromosome
identique
3. L'ADN extra chromosomique
On l'appelle aussi plasmide. C'est une molécule d'ADN cytoplasmique qui n'es pas présent
chez toutes les bactéries et qui va avoir une capacité de réplication autonome. Cet ADN est une
molécule bicaténaire, circulaire. C'est eux qui porte la résistance aux antibiotiques.
C. LES APPENDICES EXTERNES
éléments facultatifs.
1. Les flagelles
va assurer la mobilité des bactéries, se déplacer.
2. Les pilis
on différencie:
–Les pilis communs: un élément qui va permettre aux bactéries d'adhérer au supports
–Les pilis sexuels: creux à l'intérieur, c'est eux qui vont faire passer les plasmides
D. LA SPORE
Dans certaines conditions très défavorable la bactérie se transforme en spore. Elle va se
protéger en formant une coque.
2

III. PHYSIOLOGIE ET CROISSANCE ACTERIENNE
A. NUTRITION
Elle a des besoins élémentaires (oxygène, carbone, hydrogène, fer, calcium, magnésium...)
et des besoins énergétiques (glucose).
Besoins spécifiques.
Dans un milieu où il n'y a rien pour répondre à leurs besoins, elles ne se multiplient plus, et
attend puis dès qu'elles trouvent un milieu favorable avec les éléments dont elles ont besoin, elles
reprendre la reproduction.
B. LES CONDITIONS PHYSICO-CHIMIQUES DE CROISSANCE
1. La température
Les bactéries dites pathogènes pour l'homme préfère 37°. Y'en a certaines qui préfèrent des
températures plus faible ou plus élevées.
2. Le pH
Aime les pH neutre ou alcalins. Mais exceptions pour certaines bactéries
3. La pression osmotique
En fonction des pressions, les bactéries tolèrent beaucoup de chose. En général elles se
débrouillent partout
4. La pression partielle en oxygène
Mode de classification
–bactéries aérobies
–bactéries anaérobies: dont l'oxygène est toxique
–bactéries aéroanaérobie: supportent l'oxygène et peuvent vivre sans également
–bactérie microaérophile: besoin d'un certain niveau d'oxygène.
5. Les radiations
Sensibles aux UV, aiment pas du tout les rayons X et n'aime pas la lumière
6. Les substances anti-bactérienne
On se débarrasse des bactérie avec des antibiotiques et des antiseptiques
C. CROISSANCE DES BACTÉRIES
1. en milieu solide
On utilise en général des boîtes de pétries ( gélatine avec toutes les substances qui vont
permettre de développer les bactéries).
3

2. en milieu liquide
En tube (hémoculture)
IV. RELATIONS HOMME-BACTERIES
A. DEFINITIONS
Bactéries saprophytes: bactéries qui vivent dans le milieu extérieur (air, eau, sol, végétaux) qui se
développent dans la nature au dépend des déchets organiques et dont la vie et la multiplication sont
totalement indépendantes des organismes animaux et humains. Ces bactéries interviennes dans les
grands cycles de dégradation de la matière. Normalement, elles n'ont aucune pathogénicité mais
peuvent être présentes transitoirement chez l'homme.
Bactérie commensales: bactéries qui vivent sur la peau et sur les muqueuses de l'homme sans nuire
à l'être humaine qui les héberge. Elles ne peuvent vivre qu'au contact des cellules humaines
auxquelles elles sont accolées et se nourrissent des déchets rejetés par ces cellules. Les bactéries
commensales constituent la flore résidente de l'homme. Souvent l'homme n'en tire aucun bénéfice.
Parfois, elle en tire un certain avantage: la symbiose (ex: Synthèse vitaminique, barrière vis à vis
des bactéries pathogènes).
Bactérie pathogène: bactéries responsables des maladies infectieuses. On distingue
–les bactérie pathogène spécifique: bactérie qui quand elles sont présentent chez l'homme,
entrainent toujours une maladie
–les bactéries pathogènes opportunistes: bactéries le plus souvent commensales parfois
saprophytes qui à l'occasion d'une diminution des défenses immunitaires de l'homme devienne
pathogènes.
Les infections à bactéries opportunistes sont surtout observées en milieu hospitalier: chez les
malades de réa, Les K, les leucémiques, les cirrhotiques, les brulés..
B. LES FLORES NORMALES DE L'HOMME
–Les bactéries commensales constituent les flores normales de l'homme. Où se trouvent les flores
normales? Au niveau de la peau. Au niveau nu tube digestif plus la bouche, au niveau du nez et
du pharynx, au niveau des oreilles, au niveau vaginal, au niveau de l'urètre de l'homme
–Par contre, il existe des régions chez l'homme qui sont stériles c'est à dire où ne doit pas
retrouver des bactéries:
–le sang
–les urines
–le LCR et le cerveau
–le tractus respiratoire inférieur c'est à dire la trachée, les bronches et le poumon
–l'appareil génital (utérus, testicule)
V. DIAGNOSTIC BACTÉRIOLOGIQUE
–Prélèvement (cutanés, crachat, selle, urine, LCR, hémoculture)
–Transport au laboratoire (le plus rapidement possible, milieu de transport)
–Examen direct (cocci gram + ou -, bacilles gram + ou -)
–ensemencement (mise en culture / milieu aérobie -anaérobie)
4

–identification ( au bout de 24h, mise en évidence: de la flore commensale (présence ou non), de
la flore pathogène)
–Antibiogrammes (Sir) sur les germes accusés de l'infection, résultat définitif au bout de 48h
VI. LES ANTIBIOTIQUES
–On appelle antibiotiques toute substance chimique quelque soit soin origine capable d'inhiber ou
de détruire les bactéries. Aucun Ab n'est efficace contre toutes les bactéries. Certain n'agissent
que sur un petit nombre d'espèces bactériennes. D'autres ont par contre un large spectre d'action
–il est défini 10 famille d'Ab (structure chimique). A l'intérieur, on retrouve différentes molécules
chimiques. Pour une molécules chimiques, différents noms pharmaceutiques.
–Le choix d'un Ab va être basé sur
–son action sur le germe
–son action sur le site de l'infection
–Molécule le moins toxique possible
–Facilité d'administration
–coût modéré
A. MECANISMES D'ACTION DES Ab
Les Ab agissent à un niveau bien précis de la bactérie appelé site d'action ou cible et
perturbent ou inhibent certaines biosynthèses essentielles à la vie bactérienne
–Ab qui détruisent la paroi bactérienne
–Ab qui détruisent la membrane bactérienne
–Ab qui inhibent la synthèse des protéines
–Ab qui inhibent la biosynthèse des Ac nucléiques (réplication de l'ADN)
B. MECANISMES DE RESISTANCES AUX Ab
–une souche bactérienne résiste à un Ab quand elle peut se développer en présence d'une
concentration élevée de cet Ab
1. résistance naturelle
–cette résistance naturelle affecte toutes les espèces d'une même bactérie. On définit ainsi le
spectre des Ab
–Ex: bg négatif et pénicilline G
2. résistances acquise
–s'il n'existant que des résistances naturelles, il n'y aurait pas besoin d'ATB. Connaissances
médicales. En fait, on s'aperçoit que certaines bactérie résistent à des Ab alors qu'elles devraient
être sensibles.
–Cette résistance peut être due:
–soit à la production d'enzyme que détruit l'Ab
–soit à une modification de la pénétration de l'Ab dans la bactérienne. Soit à une modification
de la cible. L'Ab ne peut plus se fixer sur son site d'action
–comment la bactérie devient-elle résistante?
–Mutation chromosomique: modification de l'ADN chromosomique, rare
–présence dans la bactérie d'un plasmide, plus fréquent
5
1
/
5
100%