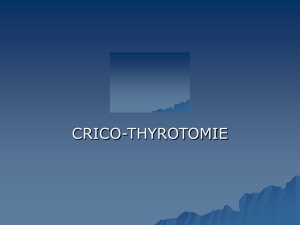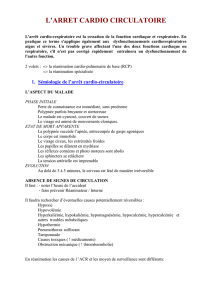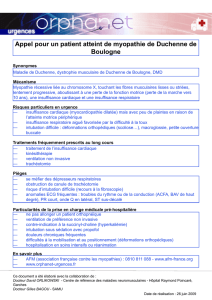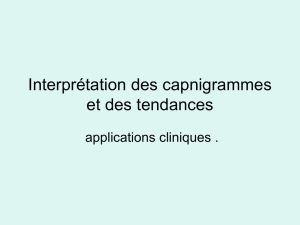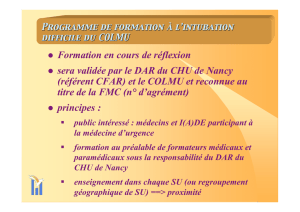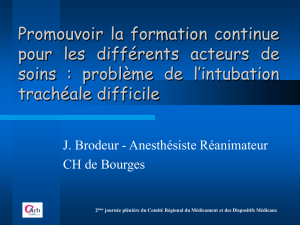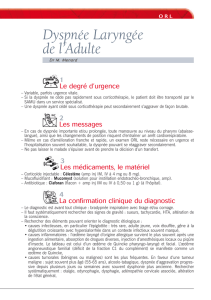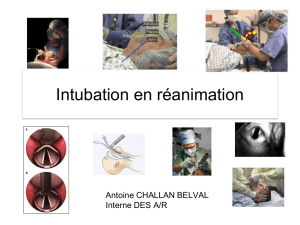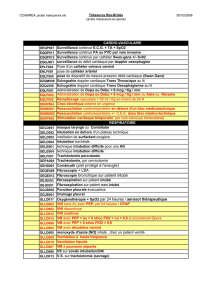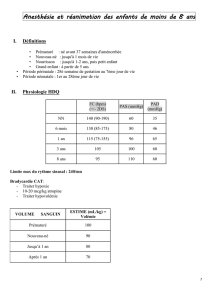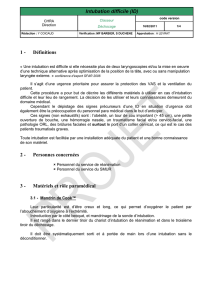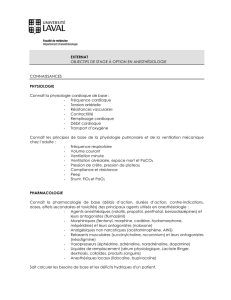intubation endotracheale en urgence

Urgences 627
INTUBATION ENDOTRACHEALE EN URGENCE
F. Adnet, SAMU 93, Hôpital Avicenne, 93009 Bobigny Cedex, France.
INTRODUCTION
Le contrôle des voies aériennes représente un des principaux objectifs de la réani-
mation cardiorespiratoire préhospitalière. En effet, la maîtrise des voies aériennes
intéresse la perméabilité de l’arbre respiratoire, les aspects mécaniques de la venti-
lation et les échanges gazeux aux niveaux alvéolaires et cellulaires. De nombreuses
situations de détresses s’accompagnent d’une altération d’un ou de plusieurs de ces
paramètres. Sans remonter jusqu’aux expériences des siècles passés, l’évolution des
connaissances et des techniques en matière de contrôle des voies aériennes a été du
ressort quasi exclusif de l’anesthésiologie à partir du XIXe siècle. La nécessité de
recourir à une perte de conscience avec ses effets délétères sur la ventilation et l’obliga-
tion de protéger les voies aériennes ont permis l’émergence de techniques de suppléance
et la mise au point de matériels prothétiques. Le développement de la réanimation et de
la médecine d’urgence permettant la prise en charge de patients en états critiques d’étio-
logies variées a nécessité l’adaptation des procédures en dehors des blocs opératoires et
plus récemment en milieu extrahospitalier dans le cadre de l’activité des SMUR.
1. INDICATIONS
Les situations cliniques nécessitant une intubation en urgence peuvent être séparées
en deux grandes catégories : l’intubation «de sauvetage» et l’intubation en «urgence
différée». L’intubation de «sauvetage» est définie comme une situation où tout retard à
l’instauration d’une ventilation invasive entraîne le décès du patient. Cette situation
regroupe essentiellement les arrêts cardiorespiratoires (ACR) et les détresses respira-
toires avec présence de signes d’épuisements majeurs annonçant l’imminence d’un arrêt
ventilatoire puis cardiaque. L’intubation en «urgence différée» est indiquée essentiel-
lement chez les patients présentant soit un risque majeur d’inhalation du contenu gastrique
soit une détresse non menaçante à très court terme. Il s’agit le plus souvent de comas.
2. PRINCIPES GENERAUX
L’intubation d’un patient en situation d’urgence doit obéir à certaines contraintes
qui conditionneront la nature des protocoles ou des conduites à tenir. L’intubation en
urgence doit toujours être considérée comme une intubation d’un patient à estomac

MAPAR 2001628
plein, en conséquence toutes les pratiques et techniques doivent minimiser le risque
d’une inhalation pulmonaire per-intubation. Le principal déterminant de la survenue
d’une inhalation semble être la durée du geste d’intubation et sa difficulté. Les moyens
d’optimiser la procédure seront donc des techniques et des aides qui :
1- permettront de minimiser le temps nécessaire à l’insertion de la sonde dans la
trachée et ;
2- diminueront la difficulté du geste.
3. PREPARATION DU PATIENT
La position du malade a une importance de tout premier ordre. Cette position doit
permettre d’aligner les axes du larynx avec l’axe de visualisation de l’opérateur. L’axe
visuel peut être matérialisé par une droite passant par l’extrémité inférieure des inci-
sives supérieures et le rebord postérieur des cartilages aryténoïdiens. L’extension du
cou ainsi qu’une avancée en avant du massif facial rapproche les axes laryngé et visuel
(Figures 1A et 1B).
Cette configuration de la tête est appelée la position dite du «renifleur» ou «sniffing
position». Cette position a été décrite par analogie à celle adoptée pour sentir un
parfum. Lors de la mise en décubitus dorsal, la pose d’un coussin sous la nuque ainsi
qu’une extension de la tête (environ de 20°) permettent d’obtenir cette configuration
(position amendée de Jackson).
Figure 1 : Modification de l’angle entre l’axe laryngé et l’axe visuel grâce à la posi-
tion amendée de Jackson.
A : Positon neutre ; l’angle entre l’axe visuel et l’axe laryngé fait 40
°
.
B : Position amendée de Jackson ; l’angle entre l’axe visuel et l’axe laryngé diminue
(20
°
), permettant une meilleure visualisation de la glotte.
A
B

Urgences 629
4. SEDATION POUR L’INTUBATION EN URGENCE
La sédation doit être administrée par voie parentérale avec une durée d’installation
rapide, réversible et associée à un minimum d’effets indésirables. L’intubation en
séquence rapide (ISR) répond à ces critères. C’est ce type de sédation qui est recom-
mandé par la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) [1].
5. INTUBATION EN SEQUENCE RAPIDE
5.1. INTRODUCTION ET PROTOCOLE
L’intubation en séquence rapide (ISR) a été introduite en 1970 pour éviter le
risque d’inhalation consécutif à l’intubation des patients à estomac plein. La séquence
ISR est le type de sédation standard utilisé dans les pays anglo-saxons [2]. Ce protocole
comprend généralement une préoxygénation puis l’injection de l’agent hypnotique
immédiatement suivie de l’administration de succinylcholine. Une compression cricoï-
dienne est alors appliquée et l’intubation rapidement pratiquée.
5.2. CHOIX DES PRODUITS
5.2.1. HYPNOTIQUES
Actuellement, les effets hémodynamiques délétères du thiopental font préférer l’éto-
midate. L’étomidate est un hypnotique intraveineux d’action rapide et brève. A la dose
de 0,3 mg.kg-1, le sommeil débute au bout de 30 secondes et dure entre 3 et 6 minutes.
La durée du sommeil est dose dépendante. L’étomidate, à la posologie de 0,3 mg.kg-1,
ne produit pas d’effets hémodynamiques délétères même en cas d’instabilité cardio-
vasculaire [8, 9]. Par contre, administré seul, l’étomidate a été associé à de mauvaises
conditions d’intubation rendant l’association d’un myorelaxant indispensable [10-12].
5.2.2. CURARES
Le curare utilisé dans une séquence ISR est le suxaméthonium. Cette molécule,
utilisée en situation d’urgence, est associée à une faible morbidité. La complication la
plus fréquente est le trouble du rythme transitoire qui apparaît dans 4%à16% des
cas [3]. L’effet secondaire le plus redoutable est le choc anaphylactique. Lors d’enquê-
tes répétées, ce produit s’est avéré responsable de la majorité des chocs anaphylactiques
dus aux curares lors d’anesthésies réglées (24 % à 54 % des accidents) alors qu’il
représente moins de 10 % des ventes de cette classe médicamenteuse [4, 5]. Le risque
de choc allergique a été estimé à environ 1 pour 1 600 utilisations [6]. Les autres effets
secondaires (augmentation de la pression intracrânienne, hyperthermie, hyperkaliémie)
ne semblent pas aggraver la morbidité dans les conditions de l’urgence. L’utilisation du
suxaméthonium doit donc être envisagée en respectant scrupuleusement les contre-
indications de cette molécule (Tableau I) [7].
5.3. MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre d’une ISR suit un ordre chronologique bien précis : (1) préoxygé-
nation, (2) injection d’un hypnotique, (3) injection d’un curare d’action ultrarapide, (4)
compression cricoïdienne ou manœuvre de Sellick, (5) intubation endotrachéale. Ce
protocole est représenté dans le Tableau II.
5.3.1. PRE-OXYGENATION
La préoxygénation est probablement le temps fondamental de l’ISR. Elle permet
d’éviter une hypoxie durant les manœuvres d’intubation, en substituant l’azote de l’air
ambiant par de l’oxygène. Cette dénitrogénation permet un temps d’apnée théorique
d’environ 5 minutes pour un patient aux poumons sains. La technique de la préoxygé-
nation doit être rigoureuse ; le patient doit ventiler spontanément dans un masque relié

MAPAR 2001630
à une source d’oxygène à haut débit afin de maintenir une FiO2 de l’ordre de 100 %. Le
masque doit être appliqué en minimisant les fuites. La dénitrogénation est atteinte en
moins de 3 minutes lorsque la technique est parfaite. Dans le contexte de l’urgence, la
dénitrogénation doit durer de 3 à 5 minutes avec une surveillance continue de la satura-
tion pulsée en oxygène bien que sa valeur ne soit pas corrélée aux taux de dénitrogénation.
5.3.2. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Le patient étant monitoré et la voie d’abord vérifiée et sécurisée, l’intubation débute
dès l’arrêt des fasciculations provoquées par l’injection du suxaméthonium. L’association
médicamenteuse préconisée dans la majorité des situations est représentée par l’étomida-
te (0,3 à 0,5 mg.kg
-1
IV) immédiatement suivi par du suxaméthonium (1 mg.kg
-1
IV), les
deux produits étant administrés rapidement.
• Atteinte musculaire squelettique d’origine congénitale.
• Syndrome de dénervation étendu survenant en règle une semaine après la
constitution d’une paraplégie ou d’une tétraplégie et persistant environ
6 mois.
• Brûlés graves durant la phase de réparation.
• Polytraumatisés avec atteinte musculaire durant les premiers jours.
• Notion de déficit congénital homozygote en pseudocholinestérases
plasmatiques.
• Plaie du globe oculaire.
• Antécédents d’allergie au suxaméthonium.
• Antécédents personnels ou familiaux d’hyperthermie maligne.
Tableau I
Contre-indications à l’utilisation du suxaméthonium
Tableau II
Exemple de protocole de sédation par une induction en séquence rapide pour
l’intubation en urgence dans des conditions préhospitalières
Equipement prêt à l’emploi et vérifié
Matériel de ventilation et d’aspiration.
Monitorage cardiovasculaire incluant oxymétrie, capnographe.
Techniques alternatives à la laryngoscopie directe.
Préoxygénation
Faire ventiler le patient en FiO2=100% dans le masque relié à une source d’oxygène à
haut débit. Assister le patient le moins possible. Contrôler l’absence de fuite. Durée
3 minutes.
Induction
Etomidate (Hypnomidate®) 0,3 à 0,5mg.kg-1 en IVL immédiatement suivie par suxa-
méthonium (Célocurine®) 1mg.kg-1 IVD.
Manœuvre de Sellick
Appliquer une pression cricoïdienne (manœuvre de Sellick) dès la perte de conscience
du patient. Cette pression doit être maintenue jusqu’à ce que le ballonnet de la sonde
endotrachéale soit gonflé.
Intubation endotrachéale
Procéder à l’intubation endotrachéale par voie orale sous laryngoscopie directe juste
après la fin des fasciculations. Ventiler le patient manuellement à l’aide d’un ballon
connecté à la sonde d’intubation avec un haut débit d’oxygène. Vérifier la bonne
position de la sonde par la courbe de capnographie ou le test à la seringue. Déceler
une intubation sélective par l’auscultation pulmonaire. Raccorder le patient à un dispo-
sitif de ventilation mécanique après avoir fixé la sonde.

Urgences 631
5.3.3. MANŒUVRE DE SELLICK
La manœuvre de Sellick est appliquée dès la perte de conscience du patient, elle est
maintenue jusqu’au gonflement du ballonnet. Cette manœuvre consiste en une
compression antéro-postérieure du cartilage cricoïde [13].
Cette manœuvre protégerait contre l’inhalation du contenu gastrique par régurgi-
tation passive. Les contre-indications de la manœuvre de Sellick sont la présence de
vomissements actifs et la notion d’un traumatisme rachidien cervical. Pour être effi-
cace, la force exercée doit être au moins de 30 Newtons. La manœuvre de Sellick a été
à l’origine de complications rares mais graves, essentiellement des ruptures de l’œso-
phage et des fractures du cartilage cricoïdien.
6. VERIFICATION DE LA POSITION ENDOTRACHEALE DE LA SONDE
La non détection d’une intubation œsophagienne accidentelle peut avoir des consé-
quences graves en termes de mortalité immédiate. Une mesure d’une pression partielle
en CO2 expiré (PETCO2) dans la sonde d’intubation confirme sa bonne position. En
effet, lorsque la perfusion pulmonaire est correcte, le gaz expiré contient 5 % de CO2.
L’air de la cavité gastrique ne contient pas, normalement, de CO2. L’analyse de la
courbe de PETCO2 permet donc de différencier une intubation endotrachéale d’une
intubation œsophagienne. Il existe des faux négatifs avec cette technique lors par exemple
d’une réanimation d’un arrêt cardiaque où la PETCO2 est variable et en général basse
lorsque le capteur est en position intra-trachéale. D’autre part il existe des faux positifs
lors de distension gastrique due à l’inhalation d’air après une ventilation forcée au
masque, mais dans ce cas le signal diminue très rapidement. Une autre technique
consiste à relier une seringue à l’extrémité distale de la sonde et à aspirer brutalement
de l’air (test de pression négative). La présence d’une résistance à l’aspiration manuelle
indique une intubation œsophagienne, son absence une intubation endotrachéale. Cette
résistance est due au collapsus des parois de l’œsophage lors d’une dépression, ce
collapsus ne pouvant se produire dans la trachée. La seringue utilisée est une seringue
de 60 mL à gros embout pour aspiration gastrique, connectée à la sonde d’intubation
sans raccord conique. Une revue de la littérature a montré qu’il existerait environ 6 %
de faux positifs (résistance à l’aspiration alors que la sonde est en position trachéale)
mais aucun faux négatif n’a été décrit avec cette méthode [14]. Les faux positifs se-
raient dues au positionnement de l’extrémité distale de la sonde d’intubation contre la
paroi de la trachée. Le test d’aspiration à la seringue est la méthode recommandée lors
d’une conférence d’experts récente sur l’abord trachéal en urgence [15].
7. COMPLICATIONS DE L’INTUBATION EN MEDECINE D’URGENCE
L’intubation endotrachéale est rattachée à une morbidité non négligeable. On peut
classer l’ensemble des complications, en complications immédiates ou tardives. Ces
complications vont du simple traumatisme dentaire jusqu’à l’arrêt cardio-respiratoire
dont l’incidence est loin d’être négligeable. Globalement, le taux de complications
immédiates varie de 9,3 % à 61 % [16]. Ces pourcentages en situation d’urgence sont
toujours supérieurs à ceux qui sont constatés au bloc opératoire. Les complications
tardives et la morbidité hospitalière rattachées à l’intubation trachéale constituent un
problème majeur et dépendent souvent des conditions d’intubation initiales. L’autre
déterminant semble être la durée de ventilation, la gravité des complications à long
terme étant probablement liée à la longueur de ventilation mécanique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%