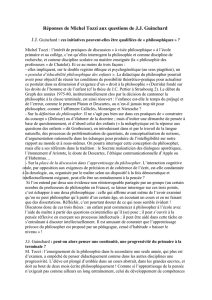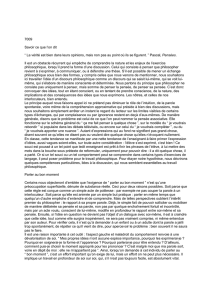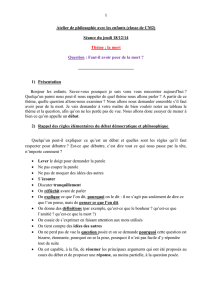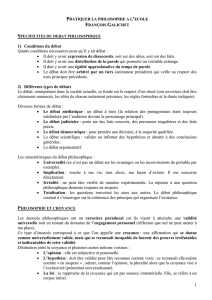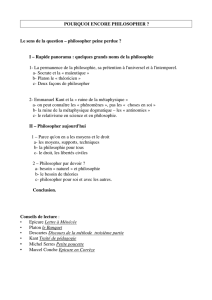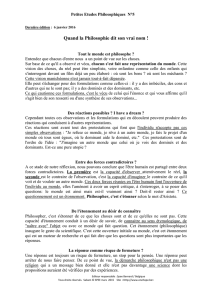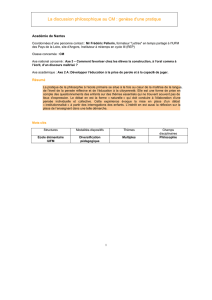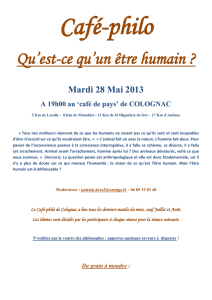Philosopher et pensée philosophique

S
ciences-
C
roisées
Numéro 13 : Contributions libres
Philosopher et pensée philosophique :
la question de leur apprentissage
Pierre Usclat
Université Catholique de l'Ouest
Département des Sciences de l’éducation ; EA 2661 - PESSOA
pierre.usclat@ uco
. f
r
PHILOSOPHER ET PENSÉE PHILOSOPHIQUE :
LA QUESTION DE LEUR APPRENTISSAGE
Résumé
Apprendre à philosopher, est-ce la même chose qu’apprendre la pensée
philosophique ? C’est à cette question que nous nous attelons dans la réflexion
conduite ici. Actant d’une équivalence au regard des pratiques innovantes et
émergentes de philosophie à l’école primaire, nous dépasserons celle-ci en
raison d’une historicité critique de la pensée philosophique. Fort de cette
dernière, nous entreverrons une antécédence de l’apprentissage de la pensée
philosophique sur l’apprentissage du philosopher. Pour autant, en revenant sur
la forme discussionnelle des pratiques émergentes dont nous serons parti, nous
tenterons de relier ces apprentissages en raison du principe d’universalisation
U tel que le propose à notre réflexion J. Habermas.
Mots clés : Pensée philosophique – philosopher – apprentissage – philosophie
à l'école primaire – discussion – principe d'universalisation
- 1 -

Introduction
Pensée philosophique et philosopher est-ce la même chose ?
Apparemment oui, puisque philosopher pourrait se définir par l’exercice d’une
pensée philosophique.
Pour autant, force est de constater que chacun déborde l’autre. La
pensée philosophique peut aussi être le patrimoine légué par les philosophes
au travers de leurs œuvres, c’est-à-dire ce qui a déjà été pensé par d’autres et
qui peut constituer une connaissance philosophique à laquelle le philosopher
peut se référer. Dans le même temps, il n’est pas illusoire de penser que
philosopher peut se réaliser en dehors de tout accès, voire de tout ancrage, à
l’histoire constituée de la pensée philosophique. En effet, comment ignorer
que toute réflexion d’un homme lui permettant d’assumer et de prendre à sa
charge les grandes questions qui taraudent l’humanité en faisant montre de
sagesse, et cela bien au-delà de sa singularité mais dans un effort tendu vers
l’universalité afin que ce qu’il pense puisse être reconnu par tous, soit qualifié
de philosophique ?
Constatons même que cette question s’opacifie quelque peu lorsque
nous relevons que la pensée philosophique peut renvoyer à un état de fait
constitué alors que philosopher pourrait davantage ressortir d’un processus
dynamique. Á ce titre la pensée philosophique pourrait s’enseigner puisqu’il
s’agirait de transmettre ce qui pré existerait au philosopher.
Mais la pensée philosophique peut-elle s’enseigner sans apprendre à
philosopher ? Si tel est le cas, quel intérêt y a-t-il à encore la qualifier de
pensée philosophique puisqu’elle ne porterait pas la vitalité d’une pensée
appelée à constamment se renouveler ? Tout autant, si tel n’est pas le cas, quel
est le garant de ne pas philosopher en versant dans l’opinion quand la
puissance des productions jalonnant la pensée philosophique peut laisser en
chemin nombre de sujets pensants ?
C’est alors sur ce nœud que nous allons nous attarder dans les
développements qui vont suivre. Á cela la raison est très aisément accessible :
il porte l’état le plus initial de la première relation de chacun avec l’un et avec
l’autre, et nous permet ainsi d’approcher quelque chose d’original voire
d’originel. Pour ce faire nous commencerons par explorer ce qui se trame
quand développer un exercice de pensée philosophique peut être envisagé
comme le fait d’apprendre à philosopher. Nous considérerons ensuite que la
structuration et la pérennisation de cette équivalence ne peut s’effectuer que
dans le fait de savoir se situer, ce qui nous entraînera à envisager une
prééminence de la pensée philosophique, en tant que point de repère, sur le
philosopher. Enfin, nous tenterons de montrer que ce repérage ne peut avoir
pour vocation de baliser les chemins parcourus mais de rendre possibles les
cheminements à parcourir, ce qui nous mènera à envisager les rapports entre
pensée philosophique et philosopher sous la modalité de la discussion.
- 2 -

1. Apprendre la pensée philosophique est-ce apprendre à philosopher ?
Une réponse à la question que nous posons dans le titre de cette partie
est à l’évidence affirmative si nous suivons l’équivalence première que nous
avons ébauchée dans notre introduction. Et cette équivalence est d’ailleurs
pleinement prise en charge par des pratiques scolaires qui, dès l’école primaire
en France (et à des niveaux d’âge similaires dans de nombreux systèmes
scolaires étrangers), entendent permettre au jeune enfant de développer et
structurer une pensée qui soit de facture philosophique, et ce bien avant la
fameuse classe de terminale lors de laquelle il est appelé à entrer de plain-pied
dans cet univers sans guère y avoir été préparé jusqu’alors.
Pour y parvenir, ces pratiques s’appuient sur une approche didactique
du philosopher développée par un universitaire français, M. Tozzi. Pour ce
dernier, penser philosophiquement c’est mobiliser trois processus réflexifs à
l’occasion d’interrogations ayant une forte résonance existentielle et
anthropologique. Et ces trois processus de pensée ne sont rien d’autre que la
problématisation, l’argumentation et la conceptualisation, chacun étant à
comprendre pour son propre compte mais aussi en interrelation forte les uns
avec les autres.
Effectivement dans la ligne tozienne de ces innovations, leur
expression essentielle se trouve dans une
« tentative d’articuler, dans le mouvement et l’unité d’une pensée impliquée
dans un rapport à la vérité, sur des questions et des notions fondamentales
pour l’élucidation de notre condition (exemple : qui suis-je ? Que puis-je
connaître ? Que dois-je faire ?...), des processus de problématisation
d’affirmations et de questions, de conceptualisation de notions et de
distinctions conceptuelles, d’argumentation rationnelle de thèses et
d’objections » (Tozzi, 2005, p. 100).
Soulignons alors avec insistance qu’aux yeux de M. Tozzi,
l’apprentissage du philosopher, en raison même de sa didactisation, se love au
plus intime de l’articulation des trois processus. Chacun atteste bien d’une
spécificité et marque une posture réflexive particulière. Ce qui ressort quand
nous définissons la problématisation par la capacité à « interroger, questionner
les fondements, formuler des problèmes » (Tozzi, 2002, p. 147), la
conceptualisation par « le cheminement par lequel on cherche à définir
philosophiquement une idée » (Tozzi, p. 144), et, enfin, l’argumentation
comme étant « la construction des raisons permettant de justifier
philosophiquement une thèse » (Tozzi, p. 162). Toutefois, la dynamique
profonde de leur mobilisation est d’entretenir des rapports les uns avec les
autres voulant que s’engager dans l’un, c’est s’appuyer corrélativement sur les
deux autres.
De fait, conceptualiser ne peut s’entrevoir que dans une
complémentarité avec la problématisation et l’argumentation. Pourquoi ? Tout
- 3 -

simplement parce qu’il n’y a d’éclairage du sens d’une notion et d’une idée
que par la remise en cause des représentations initiales, ce en quoi consiste
précisément la problématisation. Or cela requiert aussi justification et étayage,
c’est-à-dire ce que porte l’argumentation.
De la même manière, la problématisation témoigne de ses relations
profondes avec la conceptualisation et l’argumentation. Car pour
problématiser, encore faut-il argumenter le problème posé et être au clair sur
les notions et idées en jeu comme le permet la conceptualisation.
Parallèlement, le fait d’argumenter ne peut se comprendre qu’au titre
d’un cheminement réflexif en passant par le crible de la critique, et donc de la
problématisation, ainsi que par l’accord sur la signification des propos
échangés. Signification que permet de construire la problématisation
Á partir de là, en raison même de ce qui structure didactiquement le
philosopher tel que nous venons de l’expliciter, sa mobilisation par les jeunes
publics scolaires valant construction et élaboration d’une pensée
philosophique ne peut que relever de la mise en place de dispositifs de classe
permettant la convocation conjointe et simultanée de ces processus. Cela à une
condition : éviter leur travail sous forme d’exercices séparés mais bien au
contraire organiser la situation à investir par les élèves pour que tout en ayant
le droit de dire ce qu’ils pensent, ils éprouvent la nécessité de penser ce qu’ils
disent.
Dans cette veine, de tels dispositifs s’articulent essentiellement autour
de situation de débats oraux organisés en classe. Débats régulés au cours
desquels, alors que les élèves se sont préalablement mis d’accord sur une
question philosophique à propos de laquelle ils souhaitaient échanger
ensemble, les prises de parole se font en obéissant à des règles portant la
nécessité de s’écouter, de prendre en compte ce qui a été formulé
précédemment et de proposer une extension, un développement, une
ouverture, et, pourquoi pas, une réorientation de la réflexion alors conduite.
Dans ce cadre, le rôle de l’enseignant est ordinairement d’intervenir
non pas pour faire entendre ce qu’il pense mais pour faire repérer aux enfants
les conceptualisations, les problématisations et les argumentations produites
ainsi que pour formuler des interrogations afin d’étayer et éprouver les
réflexions élaborées. Comme le stipule A. Delsol, il s’agit en fait d’organiser
« les interactions entre les élèves par le jeu de contraintes produites par un
dispositif afin de mettre à l’épreuve leur attention et leur compréhension avant
d’éprouver leur intelligence » (Delsol, 2013).
Si, comme l’écrit C. Menasseyre alors doyenne de l’Inspection
Générale de philosophie, l’émergence et le fort développement de ces
pratiques à l’école primaire, bien qu’elles ne bénéficient pas d’ancrage dans
les programmes officiels, participent de la reconnaissance « qu’il y a chez tous
un besoin de philosopher, comme le dit Hegel » (Menasseyre, 2004, p. 92), il
n’en demeure pas moins qu’elles ne prennent peut-être pas suffisamment à
leur compte la question, pourtant centrale, des conditions d’élaboration d’une
pensée philosophique. Comme elle le formule encore, « il faut du temps pour
- 4 -

penser, il faut du temps pour rendre réelle la liberté » (Menasseyre, p. 95).
Ainsi, ces pratiques ne souffriraient-elles pas de précocité desservant
finalement la lente maturation d’une pensée autorisant l’enfant, appelé à
grandir, à oser, quand le moment sera venu, un philosopher dont il pourrra se
rendre responsable ? Nous acceptons l’interrogation et c’est d’ailleurs dans
cette direction que nous allons engager notre réflexion maintenant.
2. Quand philosopher commence par l’accueil de la pensée philosophique.
Á assimiler apprendre à philosopher et apprendre la pensée
philosophique, nous avons peut-être trop rapidement occulté que ce qui
s’apprend effectivement n’est pas suffisamment discriminé pour pouvoir sans
aucune ambiguïté s’inscrire dans le champ de la philosophie. Pour nous en
convaincre, remarquons premièrement que poser que ce qui s’apprend lors de
telles pratiques serait philosophique parce qu’il convoquerait des processus
réflexifs philosophiques au sujet de réflexions engagées sur des sujets
philosophiques revient à une tautologie.
Certes, cela n’expose pas au risque de l’erreur. Dire de A qu’il est A
parce qu’il est A est vrai. Pour autant cela n’apporte aucune avancée
significative devant la question qui ne manque pas de se poser, à savoir
qu’est-ce que la philosophie ?
Pour nous sortir de ce mauvais pas, nous pourrions placer la focale sur
les processus de pensée que nous avons exposés et poser qu’ils sont en
eux-mêmes philosophiques. Mais alors cela signifierait que dans nul autre
champ scolaire nous les trouverions mobilisés. Force est de constater
immédiatement qu’une position de cette nature n’est pas tenable. De fait,
conceptualiser, problématiser et argumenter sont bien nécessaires à tout le
moins en mathématiques, mais certainement aussi dans d’autres disciplines
comme les sciences de la vie et de la terre et tant d’autres.
Il resterait alors à envisager que c’est très précisément par la nature des
questions abordées que de telles pratiques assurent un réel apprentissage de ce
qui relève de la philosophie. Et s’il est évident que ce qui tourne autour, à titre
d’exemples, de la mort, du pouvoir, de l’amour, de dieu, etc. ne laisse pas
indifférent la philosophie, il est corrélativement incontestable que tout ceci
intéresse au premier chef d’autres domaines de pensée et de connaissance.
Référons nous pour nous en convaincre à l’économie, à l’anthropologie, à la
psychologie, etc.
Que reste-t-il alors pour tenir qu’apprendre à philosopher et apprendre
la pensée philosophique sont équivalents en ce sens que veulent établir les
pratiques émergentes dont nous faisons état ? Seulement que ce serait
immédiatement en lui-même et de lui-même que cet ensemble d’idées que l’on
partage lors des débats réalisés est de la philosophie. Mais alors cela
équivaudrait à dédouaner ce qui se pratique de toute évaluation, voire de toute
- 5 -
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%