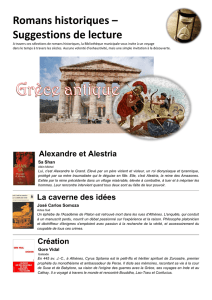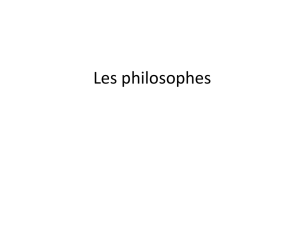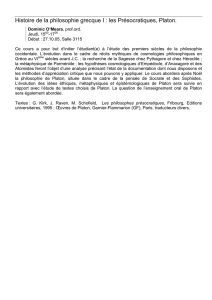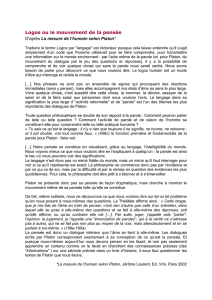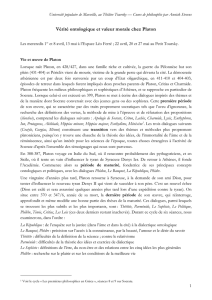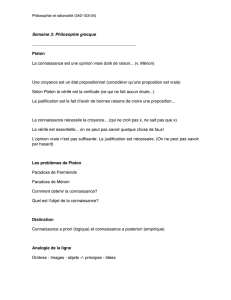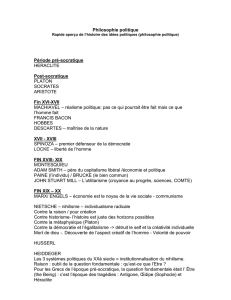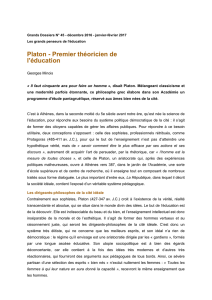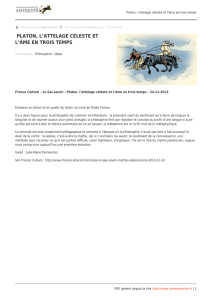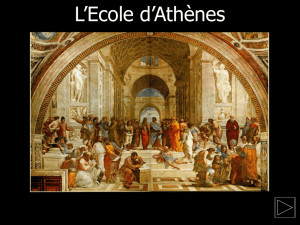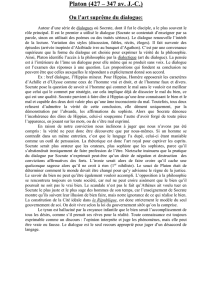Platon - République - Commentaire Livre V, VI, VII

PASCAL DUPOND
PLATON
République
COMMENTAIRE DES LIVRES V, VI ET VII

Philopsis éditions numériques
http://www.philospis.fr
Les textes publiés sont protégés par le droit d’auteur. Toute reproduction intégrale ou par-
tielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illi-
cite.
© Pascal Dupond - Philopsis 2013

SOMMAIRE
!"#$%&#& '&
(")*+)",-&.*&!"#$%&#& '&
"/&'012&3&'042&5&%6+7%-&.%&!+&8$%7"%$%&2,-.")",-&.%&!+&9*()"2%&.+-(&!+&2")%&5&
%:+!")%&.%(&;,77%(&%)&.%(&<%77%(=&"-)%:$+)",-&.%(&<%77%(&+*&2,$8(&.%(&
:+$."%-(&>8$%7"%$%&#+:*%?& @&
""/&'042&3&'412&5&%6+7%-&.%&!+&(%2,-.%&2,-.")",-&.%&!+&9*()"2%&.+-(&!+&2")%&5&!+&
2,77*-+*)%&.%(&<%77%(&%)&.%(&%-<+-)(&A&%6+7%-&.%(&+#+-)+:%(&.%&2%))%&
2,77*-+*)%&>(%2,-.%&#+:*%?B&11&
!"#$%&#"&CD&
8!+-&.*&!"#$%&CD&
"/&'@'&+&3&'@4&+&5&!%&8;"!,(,8;%&%()&!%&8!*(&+8)%&+&:,*#%$-%$&CD&
""/&'@4E&F&0GD2&5&,E9%2)",-&.H+."7+-)%&5&!%(&8;"!,(,8;%(&8+$+"((%-)&"-*)"!%(&+*&
(%$#"2%&.%(&2")%(&%)&"!(&,-)&*-%&$%8*)+)",-&.%8!,$+E!%B&$%8,-(%&.%&(,2$+)%&C4&
"""/&0GD2&F&<"-&.*&!"#$%&#"&5&!H%.*2+)",-&.%(&:,*#%$-+-)(&'4&
!"#$%&#""&IC&
"/&"-)$,.*2)",-&3&!H+$)"2*!+)",-&.%(&!"#$%(&#"&%)&#""&5&!":-%&."#"(%%&%)&+!!%:,$"%&
.%&!+&2+#%$-%&IC&
""/&01'&+&F&014&+&5&!H+!!%:,$"%&.%&!+&2+#%$-%&I0&
"""/&0D1230C1.&5&!+&<,$7+)",-(&J&."+-,%)"K*%&L&.*&8;"!,(,8;%&:,*#%$-+-)&>!%(&
2"-K&(2"%-2%(&8$,8%.%*)"K*%(?& 4M&
"#/&0CD+30'1E&5&!%&)%$7%&.%&!H%.*2+)",-=&!+&."+!%2)"K*%&@C&
E"E!",:$+8;"%&(*22"-2)%&MC&
© Pascal Dupond - Philopsis
3

PLATON, REPUBLIQUE – COMMENTAIRE LIVRES V, VI ET VII
LIVRE V
SITUATION DU LIVRE V
Au moment où s’ouvre le livre V, plusieurs positions ont été acquises.
1/ Le souci de Socrate est de conduire les interlocuteurs vers l’orientation
juste dans la question de la justice. Céphale est le premier interlocuteur de Socrate.
Il donne une première définition (extensionnelle) de la justice par l’énumération
d’actions justes (dire la vérité, rendre le dépôt qui a été confié, etc.). Puis, au mo-
ment où l’insuffisance de la définition extensionnelle devient évidente, Polémarque
prend le relais en cherchant ce qui pourrait être le principe commun de toutes les
actions justes ; il se réfère au poète Simonide : la justice consiste à rendre à chacun
ce qu’on lui doit. Les difficultés rencontrées dans cette première voie exigent une
inflexion et une inflexion qui va commander toute la suite du dialogue : la justice
doit être cherchée dans l’âme plutôt que dans l’action, elle consiste dans une cer-
taine disposition de l’agent, une certaine excellence de l’âme, qui est recherchée
pour elle-même autant que pour ses conséquences et qui donne le bonheur (fin du
premier livre). Tout le chemin qui suit ne sert qu’à reprendre, éclaircir, justifier,
fonder cette position fondamentale, jusqu’à sa formulation la plus précise en 443c-
d.
Pour mesurer l’originalité de cette compréhension de la justice, la comparai-
son avec Aristote est éclairante : Aristote ne néglige certes pas la justice de l’âme
(la justice fait partie des vertus éthiques), mais il entre dans la réflexion sur la jus-
tice par l’action (le juste, c’est, dit-il, le légal et l’égal) ; Platon entre dans la ré-
flexion sur la justice en abandonnant le plan de l’action. Cela ne veut assurément
pas dire que la justice ne s’exprimerait pas par des actes ; cela veut dire que la pen-
sée est mise sur le chemin de l’essence de la justice quand elle s’intéresse à la
source des actes, l’âme, et aux conditions qui en font la « bonté », c’est-à-dire une
certaine éducation.
2/ Mais cette première position est ébranlée, dès le début du second livre, par
un soupçon dont la figure symbolique est le mythe de Gygès, le soupçon selon
lequel l’homme juste ne serait jamais juste que par crainte des conséquences de son
injustice (358a) : tout homme, même celui qui passe pour le plus juste, deviendra
inévitablement injuste, s’il est dans la même situation que Gygès. D’où le défi lan-
cé à Socrate : prouve nous que l’homme le plus heureux n’est pas l’homme le plus
injuste, quand il reste impuni, prouve-nous que la justice doit être cherchée comme
le bien de l’âme et non pas comme un moindre mal et qu’il y aurait des raisons
d’être juste, même si on possédait l’anneau de Gygès.
3/ Pour relever ce défi, Socrate va s’engager dans une voie indirecte : cette
voie indirecte consiste à rechercher la justice dans la cité (où elle est écrite en plus
gros caractères que dans l’âme), puis à appliquer à l’âme le résultat de cette re-
cherche en se fondant sur une analogie. Et pour chercher où se trouve la justice et
l’injustice dans la cité (369 a), Socrate va se demander quelles sont les conditions
nécessaires pour qu’une multiplicité d’individus constituent une cité, il va chercher
quelle est la nature d’une cité et, à cette fin, faire naître sous nos yeux une cité.
Cette cité est d’abord une sorte de cité minimale, une cité qui se contente de satis-
faire les besoins naturels des hommes selon le principe de spécialisation des fonc-
tions ; puis, à partir de 372d (« si tu mets sur pieds une cité de pourceau… »), nous
voyons la cité s’amplifier, s’enfler, jusqu’à comprendre ceux qui produisent les
© Pascal Dupond - Philopsis
4

PLATON, REPUBLIQUE – COMMENTAIRE LIVRES V, VI ET VII
objets de luxe, les imitateurs (373b), les médecins, et enfin une armée, c’est-à-dire
des gardiens de la cité.
Ainsi peuvent apparaître les trois fonctions fondamentales de l’Etat, qui vont
permettre de penser les vertus de la cité, puis celles de l’âme individuelle : produc-
teurs, guerriers, gardiens proprement dits. Le terme « gardiens » désigne d’abord,
sans distinction, ceux qui défendent et dirigent la cité. Mais la classe des gardiens
est ensuite divisée et Platon distingue alors les gardiens proprement dits, c’est-à-
dire ceux qui dirigent la cité et les auxiliaires des gardiens, c’est-à-dire les guer-
riers.
Pour introduire les questions concernant la nature et l’éducation des gar-
diens, Platon esquisse d’abord une cité minimale ou minimaliste, qui est appelée
« la cité véritable » (372e) ou bien « la cité saine » (373b) mais qui n’est assuré-
ment pas une cité idéale : on peut y trouver en effet l’injustice comme la justice
(371e) et en outre, faute de conduire assez loin la spécialisation des fonctions, elle
ne permet pas aux aspects les plus élevés de l’œuvre humaine <ergon> de se déve-
lopper. Puis, à la demande de Glaucon qui juge cette cité saine peu différente
d’« une cité de pourceaux » le cité s’enfle, et cette cité qui s’enfle et qui recherche
le luxe, qui a une armée, qui éventuellement cherche à s’étendre par la conquête,
elle va permettre d’apercevoir (mieux que ne le pouvait la « cité saine ») la nais-
sance de la justice et de l’injustice [« c’est peut-être en examinant une cité de ce
genre que nous pourrons saisir comment la justice et l’injustice prennent racine
dans les cités à un moment donné »]. Et dès lors l’attention va se porter, se focali-
ser sur ce qui permet à la cité d’être juste et au premier rang sur la nature, les fonc-
tions et l’éducation des gardiens. Et la cité dont va alors parler Socrate, ce ne sera
plus exactement celle dont il vient d’être question, la cité qui s’enfle et où l’on peut
voir naître la justice et l’injustice, ce sera plutôt la cité correctement fondée ou
« fondée en accord avec la nature » (428e), c’est-à-dire la cité sage, modérée, cou-
rageuse et juste.
D’où l’examen de la nature de ces quatre vertus qui font la « bonne cité ».
Les trois premières vertus sont d’abord des vertus d’une partie de la cité et
ensuite des vertus de la cité entière. La justice est d’emblée une vertu de la cité
entière.
a/ La sagesse des gardiens rend la cité prudente et sage dans ses délibéra-
tions et ses décisions (428d). La sagesse est donc à la fois le savoir des gardiens (la
connaissance du Bien commun, c’est-à-dire de l’intérêt de la cité dans son en-
semble) et la qualité de la cité que dirige la sagesse des gardiens. Il ne suffit pas
qu’il y ait des hommes sages dans une cité pour que cette cité soit sage : pour que
le cité soit sage, il faut que des hommes sages la dirigent.
b/ Le courage des auxiliaires rend la cité courageuse. Même situation : le
courage de la cité, c’est le courage d’une fraction de la cité, non pas de n’importe
quelle fraction, mais des auxiliaires, le courage que Platon appelle « politique » en
430c, c’est-à-dire la fermeté, l’invariance du jugement sur les choses qu’il faut
craindre, qui sont elles-mêmes déterminées par la loi (430b).
c/ La modération <sophrosunè> exprime un rapport entre les trois classes:
elle se trouve là où le plus élevé (de l’individu ou de la cité) domine le moins éle-
vé, là où (431d) « les désirs de la foule ordinaire sont dominés par les désirs et la
sagesse qui résident dans la minorité de ceux qui sont le plus respectables » (sur le
thème de la domination de l’inférieur par le supérieur, voir 590c). Elle consiste
dans un accord concernant ceux qui doivent diriger (432a, fin). Elle se trouve donc
à la fois dans ceux qui dirigent et dans ceux qui sont dirigés (elle est de ce point de
vue, d’emblée, coextensive à la cité), mais on peut dire aussi qu’elle est par excel-
lence la vertu des dirigés, c’est-à-dire des producteurs, car s’il y a une vertu à re-
© Pascal Dupond - Philopsis
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
1
/
94
100%