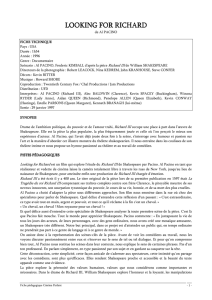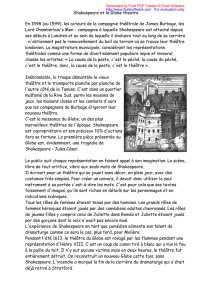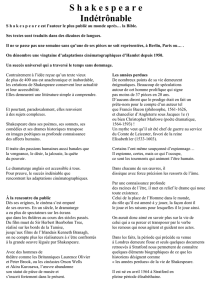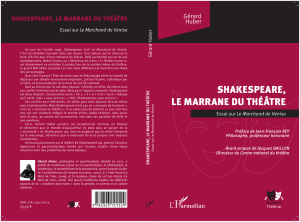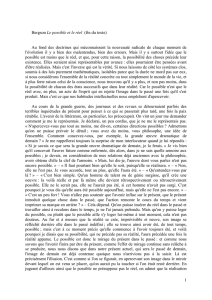À voir - Espace Culture - Lille 1

46
LNA#56 / à voir
à voir / LNA#56
47
On connaît peut-être moins Al Pacino, producteur,
scénariste et réalisateur d’un lm qui questionne la
relation des Américains au théâtre de Shakespeare, des gens
de la rue, à New-York, des spectateurs, mais aussi des acteurs
de théâtre. Et qui questionne cette pièce, Richard III, «une
pièce plus jouée qu’Hamlet», «la pièce la plus populaire de
Shakespeare», dit le lm, une pièce aussi où l’on peut se
perdre, dans les personnages et les méandres de cette histoire
de lutte pour le pouvoir, dans l’Angleterre du XVème siècle,
dans les conséquences de la Guerre des deux Roses entre les
York et les Lancaster.
Puissant de son montage, le lm repose sur un ensemble
de tensions, à commencer par la tension entre une enquête
(«question») et une quête («quest») portées par un groupe
«double» qui – autour de Al Pacino, lui-même non seulement
double (Al Pacino acteur du lm, Al Pacino réalisateur du
lm), mais triple (Al Pacino acteur de la pièce, jouant le
rôle de Richard dans Richard III) – mène le projet d’un lm
documentaire et le projet d’une mise en scène, pour le lm,
de Richard III:
- l’enquête sur cette relation des gens à Shakespeare («des
gens» car on comprend bien que, nalement, cette enquête
sur les new-yorkais vaut pour tous, à commencer par ceux
qui, spectateurs du film, hors Amérique, découvriront
Looking for Richard en y étant davantage attirés par la notoriété
d’Al Pacino que par celle de Richard III),
- la quête sur les ressorts de la pièce Richard III.
Dans les rues de New-York, le lm va jouer avec l’éventail
des réponses à la question «Connaissez-vous Shakespeare?»,
réponses qui vont de l’ignorance de celui qui, de Shakespeare,
ne retient que le «to be or not to be, that is the question», à
l’intelligence de cet ouvrier, noir, qui déclare si bellement
qu’ «il faudrait que Shakespeare soit présent dans notre ensei-
gnement, pour que les jeunes aient du sentiment (…) car si on
ne met pas du sentiment dans les mots, on dit des choses qui ne
signient rien».
Ce philosophe du peuple ajoutera, dans une autre séquence
du lm, que quand on dispose de ce «sentiment», et donc
de ce «sens», donné par les mots, la violence recule: pensée
forte quand on la réfère à la violence que déploient les pièces
de Shakespeare, et notamment la violence nue de ce
RichardIII. Violence nue qu’Al Pacino sait, avec maîtrise,
traiter, quand il le faut, par l’ellipse comme dans la
séquence du meurtre des deux enfants de la veuve du roi,
dans la tour où ils sont enfermés par Richard.
Le spectre des réponses, à cette enquête dans la rue, est
d’autant plus large qu’«il arrive, avec Shakespeare, qu’on
confonde les pièces».
Mais c’est aussi l’enquête auprès des gens de théâtre, à partir
de l’hypothèse que ce n’est pas seulement le public américain
qui est «intimidé par Shakespeare» mais les acteurs améri-
cains également: «Qu’est-ce qui se met entre Shakespeare et
nous, et qui fait que nos meilleurs acteurs sont bloqués pour
jouer Shakespeare?» (Al Pacino, dans le lm).
Pour lepublic, qui peut être conduit à penser que «les
mots, ça embrouille les gens» (sur les mots des pièces de
Shakespeare, un homme, dans la rue, à New-York), et qui
se demandera ce que peut bien vouloir dire «l’ hiver de notre
déplaisir est changé en glorieux été, sous le soleil d’York»,
on ouvrira la question: «faut-il comprendre tout ce qui est
dit?», dès lors qu’on peut se laisser porter par la poésie du
texte de Shakespeare.
Pour les acteurs américains, embarrassés par la diction du
texte shakespearien, car impressionnés par la gure de maî-
trise, en la matière, des acteurs anglais, on lèvera les secrets
du pentamètre iambique.
Alors, il convient pour le réalisateur d’organiser le lm
autour d’une tension entre Amérique et Angleterre:
aller questionner (avec sérieux) les shakespeariens «cano-
niques», comme John Gieguld, Vanessa Redgrave, Kenneth
Branagh…, aller (avec autodérision) visiter la maison natale
de Shakespeare, se demander si aller jouer une scène,
particulièrement dicile, de la pièce sur le lieu même où
elle fut jouée à Londres, au éâtre du Globe, trois cents
Trois Al Pacino pour un « Richard III »
(«Sors-moidecedocumentaire,jeveuxêtreroi!»)
Maître de conférences,
Institut de sociologie et d’anthropologie, Université Lille 1
Par Jacques LEMIÈRE
On connaît bien Al Pacino, acteur. Al Pacino, new-yorkais, né en 1940, élevé (par sa mère) dans le Bronx, qui suit les
cours de l’Actor’s Studio, en gagnant sa vie comme ouvreur de théâtre, puis qui joue Shakespeare avec la Compagnie
de théâtre de Boston. Et qui ne débute que plus tard, en 1969, comme acteur de cinéma, où il a tourné avec Lumet
(Serpico, 1973; Un après-midi de chien, 1975), Coppola (la série des troisLe Parrain, de 1972 à 1990), Pollack
(Bobby Deereld, 1977), De Palma (Scarface, 1983), Beatty (Dick Tracy, 1990).

46
LNA#56 / à voir
à voir / LNA#56
47
ans plus tôt, inspire davantage des acteurs américains. Avec
autodérision, encore, mais, comme à Stratford-on-Avon
dans la séquence précédente, cette posture n’empêche
pas, chemin faisant, le travail documentaire du lm de
s’accomplir sur la manière dont les Anglais entretiennent
la mémoire nationale de Shakespeare: non seulement la
conservation de la maison natale de Stratford, mais la
reconstitution du éâtre du Globe au cœur de Londres. La
musique du lm sera donc jouée par le London Philarmonic
Orchestra.
Et l’on pourra aussi mettre en scène, en passant, la tension
entre les universitaires érudits de Shakespeare et les gens
de théâtre, acteurs et dramaturges, qui se confrontent aux
énigmes de la pièce: pourquoi la «science» des premiers
serait-elle plus légitime que la pensée pratique des seconds?
–ce qui est une manière, drolatique dans le traitement
qu’en fait le film d’Al Pacino, de poser la très sérieuse
question des diérents statuts de la pensée, pensée dans la
science, certes, mais pensée dans l’art: pensée à l’œuvre au
cœur du travail théâtral.
Car, en même temps que la caméra à l’épaule suit Al Pacino
et ses copains dans le processus de l’enquête, un autre «work
in progress» s’est organisé: la mise en scène de Richard III,
avec toutes ses étapes, constitution du groupe qui va prendre
en charge la réflexion dramaturgique, recrutement des
acteurs, lectures du texte, attribution des rôles, recherche
des lieux, répétitions, jeu et tournage de ces scènes.
À ce public qui est susceptible de «s’embrouiller dans les
mots de Shakespeare» (hors ce lumineux shakespearien du
peuple noir de New-York, que nous avons distingué), et qui
est au risque d’en «confondre les pièces», on va expliquer la
structure de Richard III et le contexte historique de l’his-
toire que la pièce raconte et, au-delà des mots, l’illustrer
aussi, puisque Al Pacino, découvrant un ouvrage portant
le titre de Shakespeare illustré, lance: «Ce que j’aime, dans
Shakespeare, ce sont les illustrations».
Le montage du lm va organiser la tension entre les supposés
ou réels hésitations, incidents et aventures du tournageet le
cheminement de la mise en scène de la pièce: «On ne nira
jamais ce lm! C’est dans sa structure!», fait dire Al Pacino
à un membre de l’équipe du tournage. «C’est ni, j’espère»,
ajoute un technicien, «car s’il (Al Pacino) apprend qu’il reste
dix bobines de pellicule, le malheur, c’est qu’il va vouloir les
utiliser».
Tension, donc, entre le théâtre et le cinéma, repérable dans
l’allure prêtée par le lm au groupe des dramaturges, plongé
dans les livres, très «intellectuel de Brooklyn à bicyclette»,
et à l’équipe du lm documentaire, tirée vers le look à «cas-
quette de réalisateur». D’un côté, le groupe des gens
de théâtre, qui se pose des questions de théâtre, qui s’inter-
roge: «Pourquoi veut-on tellement faire du théâtre, et pas du
cinéma?»; de l’autre, l’équipe de réalisation du lm, qui
s’inquiète: «Ce n’est plus un documentaire, il n’y en a plus
que pour la pièce».
C’est que la mise en scène de la pièce Richard III est en train
de prendre le pouvoir, en termes d’occupation de l’écran,
au fur et à mesure de l’avancée du lm. La mise en relation,
motrice de la dynamique du lm, à la fois confusion et
séparation, entre le processus de type documentaire et le
processus de la mise en scène des extraits de la pièce, laisse
chaque fois davantage de place au résultat du travail de mise
en scène.
Alors Al Pacino/Richard est de plus en plus présent à l’écran,
sans jamais cesser d’être confronté à Al Pacino/acteur du lm,
sous le regard de Al Pacino/réalisateur (Al Pacino/l’homme,
qui porte tout le projet): un des points culminants de cette
confrontation est l’insert des plans montrant Al Pacino dans
un jardin de New York («Je l’aurai»!) dans le montage des
scènes jouées de la «conquête» de la belle Ann par Richard.
Cette confrontation culmine à la n du lm, quand nous
photo : DR

48
LNA#56 / à voir
libres propos / LNA#56
49
est livrée la mise en scène du dernier acte: «Il faut que tu me
sortes de ce documentaire, qui est allé trop loin. Sors-moi de ce
documentaire, je veux être roi!», ou encore: «Quand vais-je
mourir? Je veux le savoir».
Looking for Richard est un lm moderne, en tant qu’il orga-
nise la confrontation de ces matériaux divers (l’enquête do-
cumentaire, la mise en scène de la pièce, le lm en train de
se faire) dans des modalités qui laissent en permanence au
spectateur une possibilité de distance, une place de liberté.
Il y a des lms qui atteignent cette émancipation du regard
du spectateur par des moyens tout à fait opposés à ceux du
lm d’Al Pacino, qui pratique la prise caméra à l’épaule et
le découpage extrême. Pensons au chef d’œuvre de Manoel
de Oliveira, Amour de Perdition, dont les quatre heures et
demie donnent à entendre la totalité du texte du roman de
Camilo Castelo Branco dans une modalité où le lm «est
simultanément peinture (tableaux qui nous donnent l’ image
visuelle que le livre ne peut nous donner), théâtre (action dra-
matique conduite par les dialogues) et narration romanesque
(succession temporelle de ces tableaux et de cette action, et leur
enchaînement) » 1. Dans la démarche d’Oliveira, c’est la
procédure de la «théâtralisation», à l’œuvre dans de longs
plans séquences qui atteignent souvent à la xité de la pein-
ture, au point qu’on peut parler de «picturalisation», qui,
«adaptant le cinéma au texte d’un roman, et non pas adaptant
d’un roman au cinéma» 2 donne au spectateur cette place
émancipée.
Un grand mérite de Looking for Richard est que rapidité du
découpage et toute-puissance du montage n’empêchent nul-
lement Al Pacino de parvenir à construire une telle position
pour le spectateur, bien que par de toutes autres voies, qui
sont, sous ce critère, généralement plus périlleuses: c’est, ici,
toute la force du dispositif qui consiste à déployer… trois Al
Pacino pour un Richard III.
1João Bénard da Costa, écrivain et critique, qui fut président de la Cinémathèque
Portugaise, dans un texte donné pour accompagner la projection à Lille d’Amour
de Perdition le 7 novembre 2004 dans le cadre de Citéphilo (thème «L’Europe,
un lieu commun?»), pour un cycle cinématographique «Oliveira et Syberberg»,
consacré à deux lms géants pour deux cinéastes (européens) géants: le lm
d’Oliveira était projeté au Palais des Beaux-Arts de Lille; celui de Syberberg,
Hitler, un lm d’Allemagne (plus de 8 heures de projection), avait fait salle
comble, de 10 h du matin à 22 h, débat compris, un samedi de novembre, dans
l’auditorium de l’Espace Culture de l’Université Lille 1.
2Denis Lévy, dans son article sur Amour de Perdition, n° 21-22-23, « Manoel de
Oliveira» (automne 1998) de la revue «L’art du cinéma».
Y a-t-il lm plus subtil, c’est-à-dire à la fois intelligent et
drôle, libre et émancipateur du regard, pour servir, par les
moyens du cinéma, la cause de Shakespeare et, partant,
celle du théâtre? Et pour rendre hommage, comme il est dit
dans Looking for Richard, au «langage de Shakespeare qui est
le langage de la pensée».
Looking for Richard (118 minutes) est édité en DVD, depuis mars 2005,
en format PAL, par Fox Pathé Europa.
1
/
3
100%