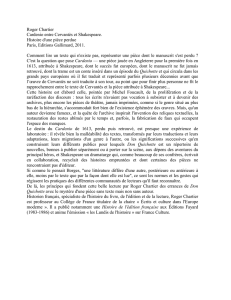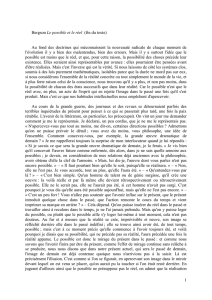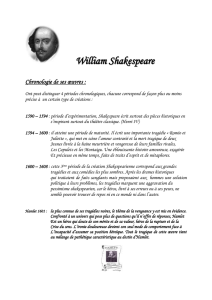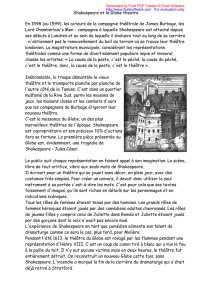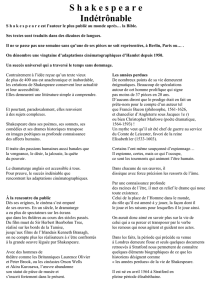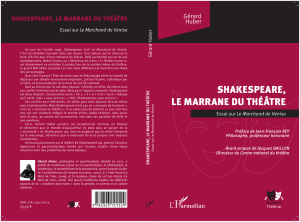Télérama, 05.07.2015

Avignon : Thomas Ostermeier transcende “Richard III” jusqu'à la folie
Fabienne Pascaud Publié le 05/07/2015.
Jonglant avec maestria entre séduction et épouvante, le metteur en scène allemand ose
tout. Et donne à la pièce de Shakespeare une puissance étourdissante.
C'est une pièce de jeunesse. Elle en a la fougue, l'énergie, le goût du jeu et la rosserie.
Shakespeare s'amuse. Comme un sale gosse qui jouit des héros démoniaques qu'il
s'invente et qui le vengent de tout. Quand, en 1592, il raconte les méfaits et les ruses
de cet authentique souverain anglais (historiquement plutôt meilleur roi que ce qu'il
en dit), il a 28 ans. A 46, le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier, patron
depuis 1999 de la Schaubühne de Berlin — vénéré bastion du théâtre européen
contemporain —, s'amuse lui aussi.
Symphonie du mal
Après Le Songe d'une nuit d'été, Hamlet, Othello, Mesure pour mesure, admirés à
Paris ou Avignon, c'est la cinquième fois qu'il s'attaque à Shakespeare. Avec dans le
rôle-titre son acteur fétiche, qui fut déjà un inconcevable Hamlet : le très étonnant
Lars Eidinger, bouffon et effrayant à la fois, drôle et mélancolique, d'une solitude
tragique. Pour nous régaler au plus près de cette caracolante symphonie du mal sur
fond de course au trône, Ostermeier a d'abord imaginé de reconstituer sur scène un
superbe espace métallique en demi-cercle et plusieurs niveaux, qui évoque le théâtre
originel où Shakespeare fit représenter la plupart de ses pièces : le Globe de Londres,
créé en 1599, accidentellement brûlé en 1613 et aujourd'hui reconstruit à l'identique.
La grande proximité de la scène et de la salle y favorisait alors une relation
exceptionnelle avec un public tout contre les acteurs, tout contre leur frénésie, leur
folie.
Rock
Même si côté droit du plateau, une batterie rock tonitruante accompagne le spectacle,
pas la moindre folie pourtant chez ce Richard-là. Couvert d'un casque-masque de cuir
pour dissimuler on ne sait quelle malformation faciale, ne pouvant s'exprimer
vraiment qu'avec un micro qui tombe des cintres et auquel il s'accroche parfois tel un
singe, celui qui n'était qu'un lointain prétendant à la couronne d'Angleterre calcule au
contraire avec une intelligence diabolique comment, contre toute attente, devenir ce
roi auquel personne jamais ne désobéira. Il part de loin.
Bossu
De moins loin certes que le général Macbeth dont Shakespeare contera (treize ans
après) une accession au trône plus désenchantée et noire encore, et cette fois proche
de la folie. Mais loin dans la solitude, la détresse d'une enfance mal-aimée, le rejet de
la mère, des pairs. Bossu sous son tee-shirt blanc et marchant mal avec ses lourds
croquenots noirs, Richard-Lars Eidinger reste une sorte d'adolescent traqué et

inconvenant dans une société aristocratique mondaine et chic — ici en tenues de
soirée modernes noir et blanc — où il fait tache, comme un vilain petit canard. Ou un
taureau de corrida. C'est le génie de Richard qui seul le sauve. Et séduit. Car
l'ambitieux forcené est forcené séducteur.
A chaque instant, il trouve la faille par où plaire. Le rejeton méprisé par sa mère
connaît comme nul autre la vie et ses souffrances, ses frustrations et ses manques. Il
saura même faire succomber la belle lady Anne sur le cercueil de l'époux qu'il a fait
massacrer. « Je l'ai eu, je l'ai eu », se réjouira-t-il haut et fort après qu'elle l'aura
embrassé sur la bouche, et qu'il aura pleuré...
Don Quichotte maléfique
Comme Richard, Ostermeier ose tout. L'excès, les blagues de potache, une reine jouée
en travesti, du sang à flots, des images vidéo de nuages sur le fond de scène, allumer
soudain la salle façon Brecht, déshabiller Richard, ou le maquiller à la fin comme un
acteur du nô, le faire pendre, aussi, comme un lamentable morceau de viande. Tout
passe. Y compris le comique. Car Lars Eidinger dans sa dégaine de don Quichotte
maléfique fait rire le public. Sa cruauté infernale et toujours recommencée, son art du
pire, sa science du trop, du jusqu'au bout finissent par émerveiller.
La puissance de ce spectacle teigneux, pas une seconde ennuyeux, vif comme le feu —
ou le rock qui le baigne — est en effet comme toujours chez Ostermeier de déplacer
les frontières. Entre le bien et le mal, la séduction et l'épouvante, la réalité et le
théâtre. A la manière de Shakespeare, justement, qui plut tant aux romantiques du
xixe siècle parce qu'il mêlait les styles, les catégories morales, philosophiques,
esthétiques, la grande histoire et la fiction dans un maelström étourdissant.
Oui, ce Richard III, drôle et démoniaque, est séduisant ; si le mal ne l'était pas nous
en serions débarrassés depuis longtemps. Oui, il reste une victime malgré lui et
mourra comme un cheval de boucherie, alors qu'il était prêt à renoncer à tout pour
survivre : « Mon royaume pour un cheval... » Si Ostermeier a beaucoup coupé le
texte, il lui a aussi redonné nerf. C'est qu'il aime et soigne ses personnages, croit aux
acteurs, dont on sent bien à travers ses mises en scène si charnelles, si incarnées qu'il
les écoute et les suit.
Les dimensions psychologiques du jeu, les détails concrets du plateau ne lui font pas
peur, ne lui semblent ni archaïques ni démodés. Voilà pourquoi, il fait mouche à
chaque création : il surprend par sa radicalité humaine, chahute, émeut. Il sait
admirablement faire théâtre de la réalité, et réalité du théâtre. Sans qu'on voie les
limites d'un travail scénique jamais totalement réaliste, jamais totalement stylisé non
plus. Thomas Ostermeier a la bosse théâtrale. Comme Richard III.
Thomas Ostermeier recolle les morceaux « Le succès que j'ai à l'étranger est
lié, je crois, à mon mode de narration... Je suis, si l'on veut, le petit frère des
déconstructivistes ; mes grands frères ont tout fait voler en éclats, alors il faut bien
quelqu'un pour rassembler les morceaux et les recoller - c'est ce que je fais. Mais dans
l'espoir de rendre visibles les points de raccord. La culture japonaise a une expression
pour cela : kintsugi. Un objet en céramique n'atteint la perfection de sa beauté qu'une
fois qu'il a été cassé puis recollé. Le but de cette esthétique est de donner à voir les
lignes de fracture. Je ne déconstruis pas, je reconstruis. Je raconte à nouveau des
histoires. »
1
/
2
100%