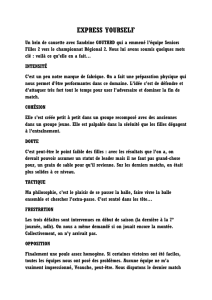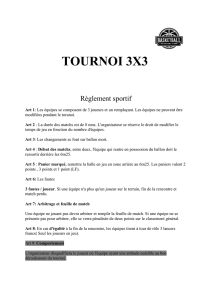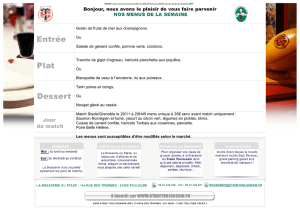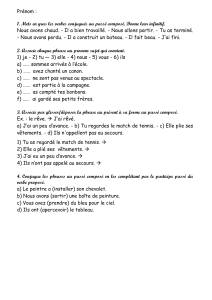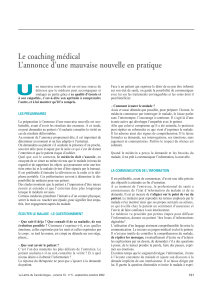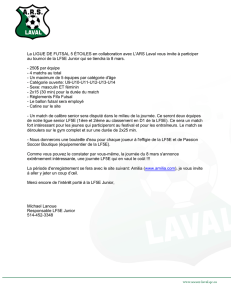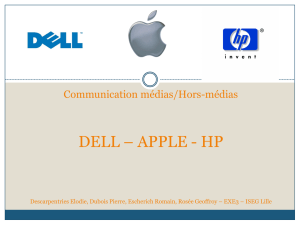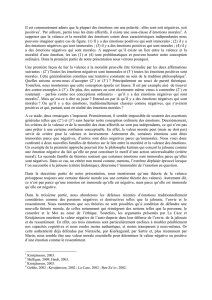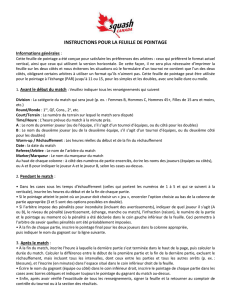Exercice 1

Exercice 1
On souhaite comparer l’état psychologique de salariés avant et après une formation contre le
stress. Le questionnaire de Karasec permet de mesurer cet état et on suppose le score obtenu
suit lors des deux dates de passation une loi normale d’écart-type 8 (points de stress).
On pense que la formation va permettre en moyenne d’observer une réduction du stress de 4
points et qu’il y aura une corrélation proche de 0.3 entre les scores de stress des deux dates.
a. Quel test d’hypothèses employer pour tester la réduction ?
b. Quelles hypothèses précisément ?
c. Déterminer la taille d’effet.
d. Si 42 salariés sont concernés, quelle est la puissance de cette expérience ?
Exercice 2
On s’intéresse à la relation entre la fréquence cardiaque maximum (nombre de battements du
cœur en une minute à la suite d’un exercice physique intense) et l’âge des individus.
Questions :
o On suppose que l’on souhaite démontrer que l’importance de cette relation mesurée
par le coefficient de corrélation linéaire est de r=0.7. En supposant que =0.05,
combien d’individus faut-il mesurer pour atteindre une puissance satisfaisante ?
o Quelle valeur de la puissance correspond à un équilibre entre le risque de première
espèce et le risque de seconde espèce ? Calculer alors le nombre d’individus à mesurer
dans ce cas ?
o On va supposer que r peut varier de 0.3 à 0.8. Représenter sommairement sur votre
copie le graphe de la relation entre r (en abscisses) et la puissance (en ordonnée) pour
25 individus mesurés. Expliquer le résultat obtenu.
o Pourquoi une approche par les tests paramétriques et l’analyse de puissance n’est pas
forcément adaptée pour déterminer la taille d’échantillon lorsque le coefficient de
corrélation linéaire r est supposé élevé (mettons r=0.9). Que faut-il donc mieux faire
dans ce cas ?
Exercice 3
Le rugby est un sport de contact où de nombreuses émotions (peur, anxiété, colère, joie…)
peuvent être vécues pendant une compétition. On relève suite à des interviews si un joueur a
vécu de telles émotions pendant une partie du match et on lui demande de les classer alors
comme positives ou négatives. Le joueur peut revoir les vidéos pour soutenir ses souvenirs.
On souhaite comparer les dix premières minutes d’un match avec les dix dernières minutes et
montrer que les émotions négatives augmentent en fin de match. Une étude précédente sur 17
joueurs et plusieurs matchs a montré 46 émotions négatives sur 64 vécues en début de match
et 116 émotions négatives sur 145 vécues en fin de match. Cette étude n’a pas conclu à un
résultat significatif
1. Les données vont-elles dans le sens de l’hypothèse à démontrer ?
2. Expliquer les raisons de l’échec de ce test.
3. Comment s’assurer du succès d’une prochaine étude ?
1
/
1
100%