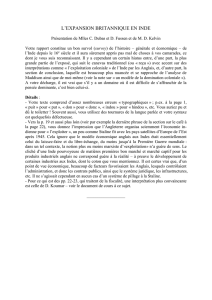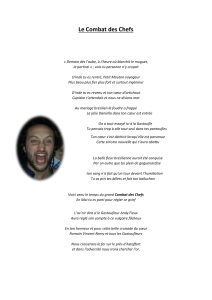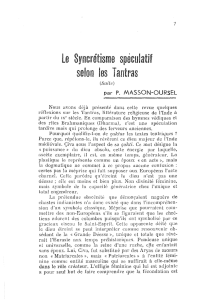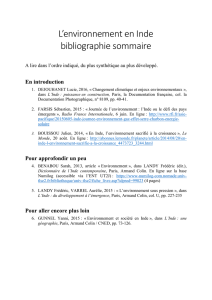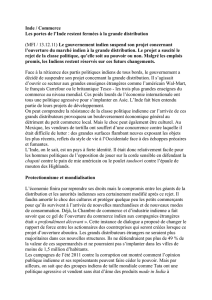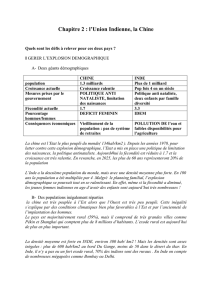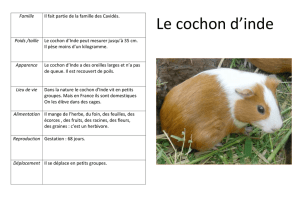Histoire des Indes

Histoires des Indes
Michel Angot

Table des matières.
Le milieu naturel
Histoire et Inde
De l'histoire des Indes à l'histoire de l'Inde : les trois composantes de l'Inde contemporaine.
Avant les empires : la culture harappéenne ou civilisation de l'Indus (vers 2500-1700 AEC).
L'aryanisation, la composition du Veda et la seconde urbanisation (c. 1800 AEC-350 AEC).
Les empires et les royaumes avant l'islamisation.
- Le temps des empires (de 313 av. J.-C. à 650 env.)
- Le temps des royaumes (650-1200)
Les cycles de conquête.
- Le sultanat de Delhi
- L'empire de Vijayanagar
- Les Moghols.
Musulmans et hindous du 11e au 18e siècle.
L'art de vivre indo-persan.
Les religions
- Les religions védiques.
- Le brahmanisme.
- Principautés et communautés hindouistes
- L'hindouisme (19e-21e siècles).
- Le bouddhisme indien.
- Le jaïnisme.
- Le sikhisme.
- Le christianisme, l'islam et les religions non indika.
- Le christianisme.
- Le mazdéisme des parsis.
- L'islam.
Les sociétés.
La conquête britannique (1740-1799).
La victoire britannique et le contrôle des Indes (1799-1857)
L'invention et la représentation britanniques des Indes et des Indiens.
L'invention de l'Inde par les Indiens.
Vers l'indépendance et la partition ; le mouvement national indien.
Problèmes historiques contemporains.
- Les frontières.
- L'Inde au féminin.
- La question linguistique.

Le milieu naturel
Un coup d'œil sur le globe montre que l'espace indien contemporain est grossièrement à la latitude
du Sahara, le centre de l'Inde actuelle se situant au niveau de La Mecque et du Soudan. Comme
l'Égypte est un don du Nil, l'Inde est un don de la mousson : sans elle, le désert sévirait.
Régulièrement, mais avec des aléas, le ciel déborde : la mousson d'été vient frapper en juin les côtes
occidentales, et à partir du Golfe du Bengale, chargés d'humidité les vents canalisés par l'Himælaya
remontent la vallée du Gange. Plus la mousson s'avance vers l'ouest, plus les pluies régressent : au
pied des Monts Suleiman qui séparent la plaine de l'Indus et le plateau irano-afghan, c'est déjà le
désert. L'eau du ciel n'y est guère présente, à part quelques rares et violentes pluies d'orage ; l'Indus
et ses affluents himælayens y charrient les eaux de fonte des neiges et des glaciers, s'ils ne se perdent
pas dans les sables. Par ailleurs, les moussons ne pénètrent guère le plateau du Deccan parce que
sur les côtés de la péninsule elles se heurtent à des barrières montagneuses, les Ghâts 'Marches' : les
déluges d'eau qui peuvent s'abattre sur Mumbai (Bombay) ne franchissent que difficilement les
Ghâts. Il y a donc une diagonale sèche qui depuis l'extrême nord-ouest (désert du Sindh) pénètre,
entre les deux Ghats, jusqu'au sud de la péninsule. À côté de la mousson, altitude et latitude
interviennent également pour diversifier l'espace indien. L'extrême Sud tend à être équatorial tandis
que l'extrême Nord, proche de l'Himælaya, connaît de véritables hivers, froids et humides.
Au total, le climat du subcontinent est excessif, d'une extrême violence. Il faut avoir vu la nature
abattue en mai-juin quand hommes et bêtes écrasés par la chaleur errent sur une terre sèche, sous
un soleil ardent ; on peine à dormir parce que même la nuit la température ne descend guère. Puis
vient la mousson, des pluies, des cascades parfois ; la température baisse et les fleuves se gonflent
jusqu'à devenir des monstres aquatiques. Cette eau que tout le monde attend peut venir trop tard,
trop tôt, insuffisamment ou excessivement. On se souvient encore du doji-bara 'famine des crânes'
qui frappa le centre de l'Inde en 1790-1792 : la sécheresse fut extrême, ses conséquences atroces. Les
moussons (d'un mot arabe signifiant 'pluie') rythment donc le temps indien péninsulaire : l'année se
mesure en varÒa 'pluie' en sanskrit. Ces pluies dictent le rythme des activités humaines. Quand il
pleut, on circule mal, voire pas du tout : le commerce est ralenti, les guerres impossibles. C'est le
moment où, avec les grenouilles, les brahmanes reprennent leurs psalmodies ; c'est le temps pour
les moines bouddhistes de rentrer dans leur grottes et leurs monastères pour y méditer et travailler.
Bien entendu les pluies dictent le rythme des activités agricoles et le niveau des récoltes. C'est aussi
le temps des fièvres paludéennes et de l'eau abondante, mais polluée. La vie se déploie, violemment,
spasmodiquement, après deux ou trois mois de chaleur intense. La belle saison est l'automne quand,
après les pluies, la nature reverdit et que les organismes s'épanouissent à nouveau vigoureux, sous
un ciel plus serein.
Bæbur, le fondateur de l'empire moghol, un bon œil et une bonne plume, perçoit bien en quoi les
terres qu'il conquiert relèvent successivement de l'espace jaune et sec des steppes parcourues par les
chevaux des guerriers et les caravanes de dromadaires des marchands, puis de l'espace vert et
humide des forêts que l'on parcourt à dos d'éléphant. On peine à reconnaître le même pays tant
l'opposition entre ces deux temps de sécheresse et d'humidité marque profondément le paysage.
Aucun des éléments de ce milieu naturel n'a constitué une limite culturelle. À partir de son milieu
d'origine, la moyenne vallée du Gange, le bouddhisme et d'autres religions d'origine indienne ont
essaimé sur les plateaux de l'Afghanistan, du Tibet et du Deccan, dans les plaines de Birmanie, les
îles indonésiennes ; l'islam s'est répandu pareillement. Les barrières naturelles comme le formidable
Himælaya n'ont pas été des limites pour les cultures, les langues ou les religions.
L'Inde contemporaine n'occupe qu'une partie restreinte de l'espace de la culture indienne : pour
éviter l'emploi du mot indien, circonscrit par des considérations politiques ou géographiques
contemporaines, on nomme cet espace « cosmopolis sanskrite » ; il s'inscrit grossièrement dans le
triangle Bamiyan-Angkor-Borobudur. On voit que cette culture s'étend sur des terres aux climats et

altitudes tout à fait variés, de la forêt équatoriale jusqu'aux déserts d'altitude alternativement
brûlants et glacés. L'Himælaya 'Séjour des neiges' ou 'Séjour du froid', un topos idéologique, en fait
partie sur ses marges. Géographiquement, il n'a été pénétré par la civilisation indienne que
récemment à travers la colonisation britannique qui par la force a intégré dans l'Inde des parties de
l'espace himalayen.
La cosmopolis est donc un espace culturel marqué par la langue et l'impact de la pensée des
brahmanes et des ‡ramanes et non d'un espace naturel. En son sein se sont développées des
sensibilités religieuses importantes, mais marginales : christianisme, islam, etc. Dans le passé
millénaire, son identité a donc été culturelle, jamais naturelle, politique ou ethnique. Ce n'est que
depuis peu que, sans perdre pour autant leur pluralité, les Indes se morcellent en espaces singuliers.
L'Inde veut affirmer sa singularité, mais a largement hérité de ses origines plurielles.

Histoire et Inde.
Entreprendre l'histoire de l'Inde n'est possible que si l'Inde est disponible comme objet et sujet
d'histoire. Il en va de même de l'histoire de France. Quand devient-il possible de faire l'histoire de
France ? La réponse tient évidemment à l'existence d'une France, en fait à l'existence du royaume de
France qui rencontre le regard des autres aussi bien que sa propre appréciation, et à l'existence de
l'histoire comme pratique appréciée. C'est parce que la France existe qu'en 1572 les Turcs ottomans
rédigent une Histoire des padishahs de France, un ouvrage qui vise à faire connaître le royaume et les
rois de France à la Sublime Porte, car depuis peu le Grand Turc a les rois Très chrétiens pour alliés. 1
À la même époque, une telle réalisation serait peut-être possible « aux Indes » si elle venait de la
cour moghole car Akbar (règne : 1556-1605) et les Moghols sont curieux des autres. Pourtant, c'est
un fait qu'ils n'ont rien entrepris de semblable : leur curiosité s'arrête aux autres, très nombreux, qui
vivent à leur cour. Ils font rédiger des chroniques de leur temps et de leur propre histoire, le
Bæburnâma, l'Akbarnâma, l'Histoire de Bæbur, l'Histoire d'Akbar, mais ignorent les autres, voisins ou
lointains. L'Hindoustan où ils règnent, ce qui est l'au-delà oriental de l'Indus, est le cadre spatial,
géographique si l'on veut, où s'inscrit leur propre histoire, rien de plus. Venant des brahmanes, ceux
qui pensent le monde hindouiste aux multiples variétés (peut-être les trois quarts de la population à
l'époque), une telle initiative est simplement impossible et même impensable. Les brahmanes n'ont
pas l'idée de l'Inde : à cet égard ils sont comme les Moghols. En outre, ils n'ont pas l'idée de
l'histoire. Ils ne peuvent ni faire l'histoire de l'Inde, ni l'histoire de l'Inde. Quant à l'histoire des
autres... Ils n'ont aucun intérêt envers les autres. Quels autres ? La culture brahmanique,
fondamentalement autiste, ne connaît pas l'autre, mais seulement des inférieurs auxquels il est
urgent de ne pas s'intéresser.
Nous faisons l'histoire de peuples et de pays qui jusqu'au 18e siècle ont tout ignoré de l'Inde et
dont beaucoup ont ignoré l'idée même de l'histoire. En 1810 P. Sonnerat voulait faire publier son
ouvrage « pour faire connaître l'Inde dont on n'a vraiment en Europe aucune idée » : ce constat
s'appliquait aux Indes mêmes2.
1. À la recherche de l'Inde dont on fait l'histoire.
En 1947, quelques heures avant la " partition ", M. Jinnah est en position de nommer le nouveau
pays qu'il va diriger. Pourquoi pas India ou (H)industan ? Non, car ces noms lui apparaissent comme
ce qu'ils sont, étrangers et coloniaux ; il préfère le pieux acronyme Pakistan3. Il pense que, pour les
mêmes raisons, Nehru, Gandhi etc. feront de même et choisiront pour leur pays un nom national,
comme Bharat, vieux nom sanskrit d'un clan transformé en nom de pays à la fin du 19e siècle.4 Mais,
surpris et furieux, Jinnah constate que le nom colonial India a été adopté par Nehru et ses amis : il
pense à juste titre que cette annexion du nom annonce celle du passé « indien » auquel le Pakistan
pouvait aussi prétendre légitimement. Alors que le Pakistan a tout pour devenir l'Inde (notamment
le fleuve Indus), India, nom étranger, mais connu en Occident, est dès lors dévolu au pays de
Gandhi. Voilà bien l'ironie et la chance au chevet d'une Inde dont le nom même semble acquis dans
l'urgence et le hasard. Cet épisode oublié montre combien l'histoire de l'Inde risque toujours de
nous échapper : alors que l'Inde d'aujourd'hui prétend à l'antiquité, à l'origine, voire à l'éternité, elle
aurait pu être un autre pays. De nos jours, tout le monde ignore que le nom Inde aurait pu, voire
aurait dû, être adopté par le Pakistan, et les Indiens sont persuadés de l'antiquité de leur Inde. La
confiscation du nom Inde par un des états issus de la partition s'avère lourde de conséquences :
l'Inde annexe le passé indien et le Pakistan est condamné à l'année 0, à un zéro historique ;
aujourd'hui, il n'y a même plus à apprendre aux Pakistanais qu'ils ne sont pas des Indiens; quant à
l'Inde, elle le serait quasi naturellement.
C'est ainsi que l'objet de l'histoire des Indes ou de l'Inde doit constamment et soigneusement être
défini. Il y a à cela de multiples raisons. La première, insuffisamment soulignée, c'est donc que
l'objet Inde n'existe que depuis peu. C'est peut-être quand les insurgés de 1857 proclament Bahadur
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
 296
296
 297
297
 298
298
 299
299
 300
300
 301
301
 302
302
 303
303
 304
304
 305
305
 306
306
 307
307
 308
308
 309
309
 310
310
 311
311
 312
312
 313
313
 314
314
 315
315
 316
316
 317
317
 318
318
 319
319
 320
320
 321
321
 322
322
 323
323
 324
324
 325
325
 326
326
 327
327
 328
328
 329
329
 330
330
 331
331
 332
332
 333
333
 334
334
 335
335
 336
336
 337
337
 338
338
 339
339
 340
340
 341
341
 342
342
 343
343
 344
344
 345
345
 346
346
 347
347
 348
348
 349
349
 350
350
 351
351
 352
352
 353
353
 354
354
 355
355
 356
356
 357
357
 358
358
 359
359
 360
360
 361
361
 362
362
 363
363
 364
364
 365
365
 366
366
 367
367
 368
368
 369
369
 370
370
 371
371
 372
372
 373
373
 374
374
 375
375
 376
376
 377
377
 378
378
 379
379
 380
380
 381
381
 382
382
 383
383
 384
384
 385
385
 386
386
 387
387
 388
388
 389
389
 390
390
 391
391
1
/
391
100%