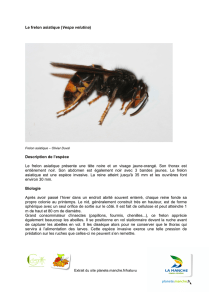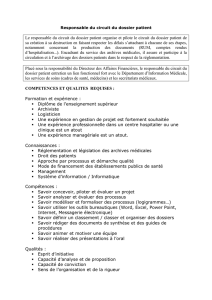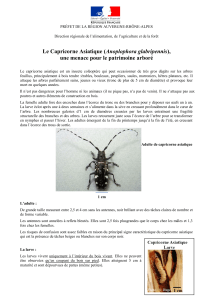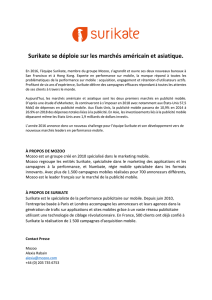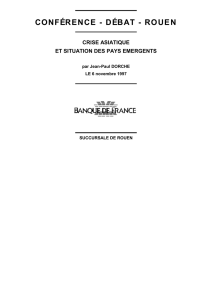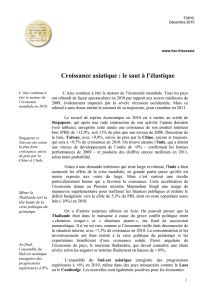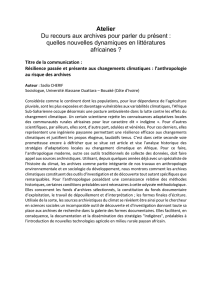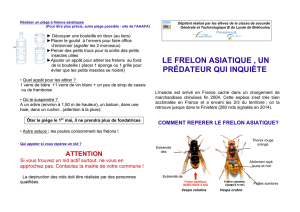La Société asiatique, une société savante au cœur de l`orientalisme

Les Nouvelles de l’archéologie n° 110 – Novembre 2007 51
l’Éfa, afin de disposer de descriptions des lieux de trouvaille.
Elle a pu ainsi réévaluer le contexte archéologique et appré-
cier la place et l’importance de ces objets dans d’un ensemble
mobilier plus large. Il s’agit de comprendre la situation sociale
et l’arrière-plan culturel des occupants des maisons où ont
été retrouvées ces figurines. Non seulement les archives ont
permis de localiser la provenance jusque-là inconnue de figu-
rines, mais aussi de préciser certaines localisations demeurées
trop vagues dans la publication pour être utiles au projet
de recherche. Souvent, les archives indiquent dans quelle
pièce les figurines ont été retrouvées – même s’il ne faut pas
confondre lieu de découverte et lieu d’usage –, voire précisent
le contexte stratigraphique. Enfin, elles fournissent aussi la
liste du matériel associé.
La conclusion du chercheur résume assez bien l’apport des
archives en la circonstance :
these objects do not seem to have been localized in any
single area of the city, nor do they appear associated only
with other Egyptian artifacts. Instead, they appear to have
been absorbed completely and seamlessly into the religious
life of the community, used by people from a wide variety of
origins rather than Egyptian expatriates alone. This evidence
of widespread religious syncretism testifies not only to the
cosmopolitanism of late-Hellenistic society on Delos, but
also to the inestimable value of the excavation notebooks in
the EFa archives as research tools. Through my use of these
archival materials to recover data on the archaeological
context of the figurines, I hope to pay tribute to the authors
of these notebooks : the skilled École française archaeo-
logists whose meticulous recording and careful work have
made it possible to reconstruct so much information about
the life of the late-Hellenistic Delian community.
(Rapport remis à l'Éfa Par c. Ellis Barrett)
Il ne fait pas de doute que le signalement de ces archives et la
mise en évidence de leur concours au progrès de la recherche
favoriseront leur utilisation accrue dans les années à venir. En
ce sens, la politique de valorisation doit aller de pair avec une
extension des surfaces dévolues à cette documentation.
La Société asiatique, une société savante
au cœur de l’orientalisme français
Annick Fenet*, Pierre-Sylvain Filliozat** et Ève Gran-Aymerich***
En 1821, un prospectus circulant auprès des savants parisiens appelait à la création
d’une société consacrée aux études orientalistes :
Faire composer ou imprimer des grammaires, des dictionnaires ou d’autres livres
élémentaires reconnus utiles ou indispensables à l’étude des langues ensei-
gnées dans les chaires publiques ; [...] acquérir des manuscrits asiatiques ou faire
copier en tout ou en partie ceux qui existent en Europe [...], en faire faire des
traductions ou des extraits [...] ; procurer aux auteurs d’ouvrages utiles sur la
géographie, l’histoire, les sciences ou les arts des contrées orientales les moyens
de faire jouir le public du fruit de leurs veilles ; appeler, par la publication d’un
recueil périodique consacré à la littérature asiatique, l’attention du public sur
les productions scientifiques, littéraires ou poétiques de l’Orient et sur celles du
même genre qui verront le jour en Europe, sur les faits qui pourront y être rela-
tifs, sur les découvertes et les travaux de toute espèce dont les peuples orientaux
pourront devenir le sujet : tels sont les objets que se propose la Société asiatique.
L’année suivante, cette institution voyait le jour avec le baron Silvestre de Sacy à sa
tête et créait sa propre revue, le Journal asiatique. Depuis lors, la Société asiatique n’a
pas failli à sa mission, œuvrant non seulement dans les domaines littéraires et philo-
logiques mais aussi dans la découverte de l’histoire et des religions des civilisations
orientales. Dès sa création, son implication dans les missions archéologiques menées
en Perse et en Mésopotamie en fait d’emblée l’élément incontournable de l’orienta-
lisme français, aux côtés de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, mais aussi un
acteur essentiel au niveau international (Gran-Aymerich 1998/2007). Sa bibliothèque
et ses archives témoignent de cent quatre-vingt-cinq années d’activité d’études orien-
tales, de son rayonnement à l’étranger, de la variété de ses centres d’intérêt. En effet,
les collections de la Société asiatique se sont enrichies au fil des générations de dons
et legs faits par certains de ses membres. Parmi eux, le programme Area « Archives de
l’archéologie européenne » s’est intéressé aux archives de l’indianiste Alfred Foucher
(1865-1952) qui, par ses travaux sur le bouddhisme, a jeté un pont entre l’Occident
et l’Orient, entre la Grèce, l’Asie centrale et l’Extrême-Orient.
* Area, chargée du fonds A. Foucher,
umr 7 041, annick.fenet@mae.u-paris10.fr,
** Membre de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres,
vice-président de la Société asiatique,
*** Chercheur auprès de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres,
Pour le sommaire complet ou la commande du numéro
cliquez ici: www.nda.msh-paris.fr

Dossier Archives de l’archéologie européenne (Area)
52 Les Nouvelles de l’archéologie n° 110 – Novembre 2007
La Société asiatique, la Perse
et la Mésopotamie :
philologie, archéologie et politique
Lorsque, le 1er avril 1822, la Société asiatique tient sa première
réunion, la Perse et la Mésopotamie, tout autant que l’Égypte,
concentrent depuis plusieurs décennies les efforts des savants
européens attachés au déchiffrement des écritures orien-
tales anciennes. Quelques mois plus tard, le 27 septembre,
J.-F. Champollion fait lecture, devant l’Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, de sa fameuse « Lettre à M. Dacier » et
fournit les clefs du déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens.
La philologie appliquée aux langues orientales prend son essor
en Europe, alors que se fait progressivement jour la nécessité
de conduire des recherches sur les territoires mêmes qui ont
produit les inscriptions : l’expédition de Bonaparte, en révélant
les sites et les monuments de l’Égypte ancienne, a déclenché un
nouveau processus de recherche historique associant, désor-
mais la philologie à l’archéologie (Gran-Aymerich 1998 : 63-
107). La Société asiatique joue un rôle de premier plan dans ce
phénomène et préside à la naissance de l’archéologie orientale,
qui voit le jour à Khorsabad en 1842, lorsque le consul français
à Mossoul entreprend l’exploration du palais de Sargon.
En Mésopotamie comme en Égypte, les conditions qui
s’imposent pour la mise en œuvre de l’exploration archéo-
logique des sites – moyens matériels et financiers considé-
rables, présence prolongée sur le terrain – impliquent la prise
en compte des données d’ordre politique : l’égyptologie se
constitue à la faveur d’une expédition militaire organisée
pour contrarier les plans de la Grande-Bretagne lancée dans
la réalisation du Great Game, pour s’assurer la suprématie
sur les régions comprises entre la Méditerranée et l’Inde. La
Perse et la Mésopotamie entrent ainsi dans le cadre de la poli-
tique orientale de la France et de l’Angleterre, dont la rivalité
retentit sur les conditions d’étude des civilisations orientales.
Au moment même où se forme à Paris la première Société
asiatique d’Europe, la présence britannique en Perse et en
Mésopotamie est garantie par les agents dont la Compagnie
des Indes orientales dispose à Bagdad et à Bassorah ; par
ailleurs, la nomination de Claudius James Rich (1787-1821)
au poste de résident de la Compagnie à Bagdad en 1808,
puis à celui de consul général en 1815, donne une impulsion
considérable aux recherches sur les grandes cités mésopota-
miennes – Babylone et Ninive – et, tout en assurant la supré-
matie britannique dans ces régions, attise l’intérêt des savants
européens pour les études orientales. En prenant connaissance
du récit que fait Rich de son séjour dans la région de Mossoul
(Rich 1836), Jules Mohl (1800-1876), secrétaire adjoint de
la Société asiatique, envisage la possibilité pour la France
de procéder à la résurrection de Ninive, en fouillant les tells
proches de Mossoul : la solution la plus simple pour assurer
la continuité de travaux de longue haleine est d’en confier la
responsabilité à un diplomate nommé à un poste de consul
créé en 1842 à Mossoul pour P.-E. Botta (1802-1870). Dès
lors, l’engagement de l’État dans les entreprises scientifiques
s’impose au même titre que celui de l’Académie des inscrip-
tions et belles-lettres et de la Société asiatique : à la demande
de J. Mohl, l’Académie obtient du gouvernement l’octroi d’une
subvention importante pour les fouilles de Botta à Khorsabad
et leur publication aux frais de l’État, alors que la Société
asiatique et son Journal assurent immédiatement la diffusion
des lettres que Botta adresse à Mohl pour l’informer de l’avan-
cement des travaux. En 1842, ce dernier obtient par ailleurs
la création, au sein du ministère de l’Instruction publique, du
Bureau des missions auquel sont dévolus l’organisation et le
financement des entreprises scientifiques officielles.
En Perse et en Mésopotamie, l’archéologie orientale fran-
çaise se développe selon deux modes distincts et complémen-
taires : celui de l’expédition scientifique inspirée du modèle
de l’expédition d’Égypte est appliqué en 1839 à l’occasion
de l’ambassade de Sercey en Perse, à laquelle est associée la
mission d’exploration et de relevé des monuments confiée à
E. Flandin (1803-1876) et P. Coste (1787-1879) ; l’autre option
– celle du consul archéologue qui conjugue en sa personne
les compétences politiques et scientifiques – connaîtra une
faveur particulière au Proche-Orient, où les diplomates sont à
l’origine des plus grandes découvertes.
Ces circonstances expliquent la complexité des rela-
tions qu’entretiennent les savants anglais et français,
jusqu’à la fermeture des chantiers mésopotamiens en 1855 :
A. H. Layard (1817-1894) et H.-C. Rawlinson (1810-1895) sont
partagés à l’égard de P.-E. Botta et de V. Place (1818-1875)
entre les témoignages de sympathie et les exigences de la
gloire nationale, qui exacerbent les rivalités. Cependant, la
Société asiatique de Paris et sa consœur de Londres, née deux
ans plus tard, garantissent la collaboration internationale
et le progrès du déchiffrement des langues, qui demeure le
souci principal de la communauté scientifique européenne.
Entre les orientalistes des deux sociétés s’établissent des
échanges généreux et constructifs, dont le réseau de relations
d’E. Burnouf (1801-1852) offre un exemple remarquable :
sa correspondance avec les savants européens confirme la
réalité des transferts qui s’opèrent entre Français, Anglais
et Allemands à l’occasion du déchiffrement des inscriptions
persanes du Mont Elvend et du rocher de Behistun ; les sociétés
de Londres et de Paris permettent la communication des résul-
tats obtenus par lui, son ami le Danois C. Lassen (1800-1876)
et H.-C. Rawlinson ; à son initiative, ces deux derniers sont
admis comme membres de la Société asiatique parisienne.
Le même esprit anime J. Mohl lorsqu’il assure la publica-
tion immédiate des Lettres de Botta sur ses découvertes à
Khorsabad, d’abord dans le Journal asiatique, puis par l’Im-
primerie nationale (1845), pour mettre à la disposition de tous
le matériel épigraphique recueilli dans le palais de Sargon. La
collaboration franco-britannique culmine en 1857, lorsque la
Royal Asiatic Society organise le test de la traduction multiple
et concordante d’une inscription de Tiglatpileser I trouvée à
Qalaat-Shergat, auquel se prêtent les Anglais Rawlinson et
Hincks et le Français J. Oppert.
Ainsi, dès sa création, la Société asiatique, par les liens
qu’elle instaure entre les orientalistes européens, favorise la
collaboration internationale et, grâce à son statut ambivalent
de société née de l’initiative privée mais reconnue par les plus
hautes instances officielles, elle parvient à concilier intérêts

Annick Fenet, Pierre-Sylvain Filliozat et Ève Gran-Aymerich | La Société asiatique
Les Nouvelles de l’archéologie n° 110 – Novembre 2007 53
scientifiques et politiques dans le souci affirmé par son secré-
taire Jules Mohl de contribuer à la connaissance de l’Orient
ancien dans le respect de l’Orient moderne.
La Société asiatique et ses archives,
du XiXe au XXe siècle
Le prestige de la Société asiatique s’est accru au cours des ans,
survivant aux changements politiques, aux guerres de 1870
et de 1914-1918, et à la formidable évolution du monde dans
la première moitié du xxe siècle (Filliozat 2003). Parmi les
présidents qui succèdent à S. de Sacy, citons Jules Mohl qui
œuvre beaucoup pour l’institution et le Journal asiatique, en
particulier dans le troisième quart du xixe siècle, Ernest Renan
– qui occupe diverses fonctions au sein du Conseil à partir
de 1860, y compris celle de bibliothécaire entre 1863 et 1866
– entre 1884 et 1892, ou encore l’indianiste Émile Senart
de 1908 à 1928. Outre les études linguistiques et philologiques
qui sont à l’origine de sa création, la société s’intéresse à l’his-
toire, aux religions, au patrimoine au sens large de l’Orient,
accueillant notamment les études et témoignages de voyageurs
(militaires, archéologues, géographes, architectes, hommes
d’Église...). Par ses membres, elle est liée à d’autres institutions
françaises (École des langues orientales ; Collège de France ;
Académie des inscriptions et belles-lettres ; École française
d’Extrême-Orient...) et collabore avec de nombreuses institu-
tions étrangères dans le monde. La célébration de son cente-
naire en 1922 atteste de la vitalité et de la notoriété de la vieille
dame (Société asiatique 1922a et b). Trois jours de festivités
(11-13 juillet) marquent l’événement, dont une « séance solen-
nelle à la Sorbonne sous la présidence de M. le Président de la
République », une « réception chez le Prince Roland Bonaparte,
membre du Conseil de la Société asiatique », une « réception
à l’Hôtel de Ville par la Municipalité de Paris », un « dîner
au Palais d’Orsay, sous la présidence de M. Albert Sarraut,
Ministre des Colonies ». La société reçoit, de la part d’acadé-
mies, universités et sociétés savantes d’Europe, d’Amérique et
d’Asie, des lettres de félicitations et de souhaits de longue pros-
périté scientifique. Ses contributions importantes aux Congrès
internationaux des Orientalistes – le premier se tint à Paris
en 1873 – et la part qu’elle a prise à la création de la Fédération
des Sociétés orientales interalliées en 1919 sont rappelées et
saluées par l’ensemble des orateurs et des adresses.
La Perse et la Mésopotamie sont loin de constituer son
principal centre d’intérêt, même à ses débuts. L’orientalisme
qu’elle défend doit s’entendre dans une acception très
large, depuis l’Afrique du Nord jusqu’à l’Extrême-Orient. Le
bilan présenté lors du centenaire répartit ainsi ses activités
en treize « départements » présentés comme suit : égypto-
logie, assyriologie, exégèse biblique, études araméennes,
études éthiopiennes, islamisme, études arméniennes, india-
nisme, Indonésie et Indochine, sinologie, études japonaises,
géographie. Cinquante ans plus tard (Société asiatique 1973),
on en compte dix-huit, ainsi répartis : assyriologie, égyp-
tologie, études sémitiques, hébraïques, arabes et berbères,
turques ; Orient chrétien, Iran ancien, Iran moderne, Asie
centrale et études mongoles, études tibétaines ; indianisme ;
Asie du Sud-Est : péninsule indochinoise, monde insulin-
dien ; études chinoises, coréennes, japonaises. Ces deux listes
témoignent non seulement de l’étendue des champs embrassés
par la Société asiatique, mais aussi de l’évolution de l’orien-
talisme en général en deux siècles. La bibliothèque de la
société, née dès 1822 d’un don du duc d’Orléans, n’a cessé
de voir ses collections grandir dans tous ces domaines, au
rythme des achats et surtout des dons, legs et échanges. Riche
de plus de 100 000 volumes, parmi lesquels des publications
anciennes et/ou étrangères devenues rares, elle compte aussi
de nombreux textes orientaux, i. e. originaux ou copies
– manuscrits, imprimés ou estampages – de textes khmers,
tibétains, sanskrits, arabes… ; à titre d’exemple nous citerons
les archives du dernier royaume du Panduranga-Campa (xviie-
xixe siècle). Les déménagements successifs de la bibliothèque
jusqu’à son adresse actuelle au 52, rue du Cardinal Lemoine
(Paris 5e) ont perturbé l’ensemble des fonds et il est difficile
de suivre dans le détail leur historique. Les archives, qui
d’ailleurs n’ont jamais fait l’objet d’un recensement véritable,
ont le plus souffert de ces aléas ; elles sont majoritairement
conservées dans des cartons de déménagement, avec parfois
un intitulé sommaire. Un inventaire général inédit, réalisé
dans le prolongement de l’inventaire du fonds Foucher,
permet à présent d’en esquisser les grands traits.
La Société asiatique possède ses propres archives adminis-
tratives – correspondance, comptabilité, rapports et comptes
rendus de séances, registres, dossiers sur les congrès des
orientalistes, coupures de presse, photographies d’orienta-
listes… Même si l’ensemble est malheureusement lacunaire,
comme le signale Louis Finot qui semble avoir examiné ces
papiers pour écrire l’histoire de l’institution à l’occasion du
centenaire (Société asiatique 1922a : 2-65, spéc. 2), l’étude
d’un tel fonds offrirait un grand intérêt pour l’histoire de
l’orientalisme.
Les archives scientifiques, quant à elles, correspondent à
autant de dons et legs de membres de la société ou de leurs
proches, reçus dès le milieu du xixe siècle. Du legs Édouard-
Simon Ariel (1818-1854) – sous-commissaire de la Marine
et conservateur de la bibliothèque publique et des anciennes
archives de Pondichéry – transféré par Jules Mohl à la
Bibliothèque impériale, restent quelques éléments d’études
de sanskrit et d’histoire des religions. Du philologue Gustave
Garrez, la Société asiatique conserve également quelques
notes scientifiques sur la littérature et la philologie indiennes
et le bouddhisme, ainsi que sur l’histoire et la littérature
grecques, la Perse ou le judaïsme ; du père jésuite Augustin-
Marie Boyer, sanskritiste, des papiers relatifs à des « matériaux
védiques et iraniens ».
Deux fonds d’archives d’éminents indianistes ont été
préservés par l’institution : ceux d’Alfred Foucher (1865-1952,
voir infra) et de Jean Filliozat (1906-1982), directeur de l’École
française d’Extrême-Orient (Éfeo) de 1956 à 1977, professeur
au Collège de France et fondateur de l’Institut français d’indo-
logie de Pondichéry en 1955. Avec la partie de sa bibliothèque
traitant de la médecine indienne, ses enfants ont donné à la
société tous ses papiers scientifiques, après un classement
d’ensemble (ces archives sont consultables sur autorisation).

Dossier Archives de l’archéologie européenne (Area)
54 Les Nouvelles de l’archéologie n° 110 – Novembre 2007
Les papiers Antony Landes (1850-1893) – administra-
teur en Indochine mort noyé accidentellement lors des fêtes
du Têt – traitent des littératures et religions annamites et
tonquinoises ; un ensemble de manuscrits orientaux complète
son apport aux collections de la société. Le fonds impor-
tant d’Étienne Aymonier (1844-1929), officier de marine
en Cochinchine, premier directeur de l’École coloniale de
Paris entre 1888 et 1905, concerne pour sa part Angkor, le
Cambodge et l’Annam, explorés par lui dans les années 1870
et 1880. Il comprend des notes et carnets de voyages, des
relevés épigraphiques, de nombreuses photos… sans oublier
des dessins de Jean Commaille (1868-1916), premier conser-
vateur d’Angkor. Le tout est en cours d’étude par Mme Nut, de
l’Institut national des langues et civilisations orientales.
La Chine est très bien représentée dans les archives. Les plus
anciennes proviennent du sinologue Gabriel Devéria (1844-
1899), académicien, frère cadet de l’égyptologue Théodule
Devéria, qui après une carrière diplomatique – dont vingt
ans passés en Chine – enseigna le chinois à l’École des
langues orientales. La Société asiatique possède aussi toute la
bibliothèque d’Édouard Chavannes (1865-1918), académicien,
professeur au Collège de France, auteur de nombreux travaux
sur la Chine et l’Asie centrale anciennes, et quelques-uns de
ses papiers scientifiques, dont les publications de ses deux
missions archéologiques en Chine (1889-1893 et 1907-1908),
et les publications des documents trouvés par l’archéologue
naturalisé britannique Aurel Stein au Turkestan. Le fonds
Chavannes contient également une collection exceptionnelle
d’estampes populaires chinoises du xixe siècle et du début du
xxe siècle. Le fonds Henri Maspero (1883-1945) représente
pour sa part un ensemble considérable : avec sa bibliothèque,
toutes ses archives ont été données par son épouse à la Société
asiatique ; un classement partiel en a été réalisé par le sino-
logue Michel Soymié. Spécialiste de la Chine et du Vietnam,
auteur de l’ouvrage de référence La Chine antique (Paris,
1927), membre de l’Éfeo entre 1908-1920, Henri Maspero fut
nommé professeur au Collège de France à la chaire de langue
et littérature chinoise à partir de 1920. De la même manière,
l’ensemble des archives scientifiques du sinologue Paul
Demiéville (1894-1979) a été déposé à la Société asiatique
par sa fille Mme Jeanne-Marie Allier, actuelle bibliothécaire
de l’institution. D’origine suisse, l’élève de Maspero et de
Foucher fut notamment membre des écoles françaises (Éfeo
de 1919 à 1924, Maison franco-japonaise de 1926 à 1930),
rédacteur en chef du Hobogirin, dictionnaire encyclopédique
du bouddhisme d’après les sources chinoises et japonaises,
enseignant à l’École des langues orientales, à l’École pratique
des hautes études (Éhe) puis au Collège de France avant d’être
élu à l’Académie. Outre les documents papier, la Société asia-
tique détient des plaques de verre de son voyage à travers la
Chine et l’Indochine en 1921. Le dernier legs, datant de 1990,
est celui de James Hamilton (1921-2003) ; il n’est arrivé rue
du Cardinal-Lemoine qu’au printemps 2006. Les livres de ce
sinologue et turcologue, spécialiste d’Asie centrale, sont en
cours d’intégration dans les collections de la bibliothèque ;
en revanche les archives, non triées, se trouvent encore dans
leurs cartons de déménagement.
La société possède par ailleurs des archives de
plusieurs tibétologues, à commencer par Philippe-Édouard
Foucaux (1811-1894), premier professeur de tibétain à l’École
des langues orientales à partir de 1842, professeur de sanskrit
au Collège de France à partir de 1862. Celles de son élève
Léon Feer (1830-1902) sont beaucoup plus nombreuses et
concernent aussi d’autres sujets (langues très diverses, sujets
d’histoire antique, histoire du protestantisme). Un demi-siècle
plus tard, l’ancien président de la Société asiatique Jacques
Bacot (1877-1965), académicien, dont les voyages de jeunesse
autour du monde et au Tibet en 1904 et 1906 ont formé le
goût pour l’orientalisme et qui devint directeur d’études à
l’ÉPhe à partir de 1936, lègue à la bibliothèque ses livres, ainsi
que des manuscrits et des archives scientifiques.
Bien que moindres, les archives concernant le Proche-
Orient ancien et le monde musulman ne sont pas dénuées
d’intérêt. La Société asiatique conserve quelques papiers du
numismate Adrien de Longpérier (1816-1882) : notes manus-
crites, photographies, dessins et croquis, documents numis-
matiques et épigraphiques (Perse, Pont, Abyssinie…). Edmond
Drouin (1838-1904), spécialiste des monnaies parthes, a donné
un ensemble de lettres d’orientalistes, réuni par lui en 1901
dans un volume relié, ainsi que les manuscrits de ses études
publiées entre 1867 et 1890, assemblés de la même façon en
deux volumes reliés. Le fonds Lucien Bouvat (1872-1942),
actif et dévoué bibliothécaire de la Société asiatique, diplômé
des Langues’O (« langues dites musulmanes ») et surtout
turcologue, collaborateur de la Revue du Monde musulman,
contient des documents scientifiques ainsi que des papiers
relatifs à la Société asiatique. À cet ensemble, il faut peut-être
rattacher le petit lot de textes et de photos de l’administrateur
Paul Marty, concernant sa publication Études sur l’Islam au
Sénégal (Paris, 1917, 2 volumes). Tout récemment, la biblio-
thèque de Louis Bazin (1920), l’un des plus grands turcologues
français de la seconde moitié du xxe siècle, académicien, a été
donnée à la Société par ses enfants. Le tout a été amené en
cartons fermés (37 !) portant quelques indications générales du
contenu ; ceux-ci n’ayant pas été ouverts depuis par manque
de personnel, il est difficile d’établir l’importance des docu-
ments manuscrits par rapport aux livres et aux tirés à part.
Reste à mentionner un fonds dit « Marco Polo » contenant
des reproductions (photos, plaques de verre, transcriptions
manuscrites…) de manuscrits, essentiellement italiens mais
aussi orientaux, relatifs à Marco Polo, et des notes relatives
au même sujet. Il faut peut-être le rattacher au sinologue
français Paul Pelliot (1878-1945) et au médiéviste britannique
A.-C. Moule, qui ont travaillé ensemble pour une publication
commune sur le récit du Vénitien, dans les années 1920-1930
(Moule et Pelliot 1938).
Parmi ce formidable ensemble d’archives, le choix d’Area
s’est naturellement porté sur celles d’Alfred Foucher : elles
constituent en effet un ensemble homogène – les archives
de toute une vie d’orientaliste – et sont particulièrement
riches pour l’histoire de l’archéologie française à l’étranger
dans la première moitié du xxe siècle (Fenet sous presse).
Les documents (correspondance, manuscrits, notes scienti-
fiques, rapports administratifs d’écoles et de commissions,

Annick Fenet, Pierre-Sylvain Filliozat et Ève Gran-Aymerich | La Société asiatique
Les Nouvelles de l’archéologie n° 110 – Novembre 2007 55
photographies et plaques de verre…) couvrent de surcroît une
zone géographique vaste (depuis l’Iran jusqu’au Japon) autour
de l’Inde, sa terre de prédilection.
L’indianiste A. Foucher,
de l’Asie Centrale à l’Extrême-Orient
Si Alfred Foucher est encore un modèle, ce n’est pas seule-
ment en raison de son apport considérable au progrès des
connaissances scientifiques sur l’Inde, c’est aussi qu’il a
répondu à toutes les exigences de la profession. Voyageur,
homme de terrain et savant de cabinet, archéologue et philo-
logue, savant à la pointe de la recherche et pédagogue char-
meur, il a été aussi un grand administrateur des études et des
institutions. À cela s’ajoutent une culture humaniste excep-
tionnelle et un talent d’écrivain unique dans l’école française
de l’indianisme scientifique.
Sa première mission en Inde en novembre 1895 dura près
de deux ans. Jeune universitaire – il avait juste 30 ans –, il
débarquait dans l’Empire des Indes au faîte de sa puissance
et de son illusion. Il lui fut donné d’observer la vie indienne
sous tous ses aspects, du milieu colonial aux figures les
plus pittoresques du peuple. Sa formation à Paris, auprès de
Sylvain Lévi (1863-1935) notamment, lui avait fait acquérir
des connaissances livresques d’histoire de l’art et de langues
indiennes. Sur le terrain il découvrit de ses yeux les monu-
ments et rencontra les savants, les traditionnels pandits,
visita des écoles sanskrites. Un champ d’étude vaste et vierge
s’ouvrait à sa curiosité. Il appréciait la qualité des connais-
sances acquises par contact oral direct dans un milieu vivant.
Dans ses dernières années, il eut le souci de préparer pour ses
étudiants un manuel élémentaire de logique formelle sans-
krite, en raison d’un souvenir de jeunesse :
Aussi quand en 1895, à l’âge de 30 ans, je me rendis pour
la première fois dans l’Inde, je croyais déjà savoir quelque
peu de sanskrit. En visitant le Sanskrit College de Bénarès
[…] j’eus tôt fait de m’apercevoir que j’avais, sinon à le
rapprendre, du moins à le récapituler d’après une méthode
linguistiquement moins correcte, mais singulièrement plus
vivante. C’était comme une autre langue […] parlée et assou-
plie à l’expression des idées les plus profondes comme les
plus familières, que j’entendais bourdonner à mes oreilles...
(Foucher 1949 : v).
Au cours de cette première mission de formation et
d’exploration, il fait une abondante moisson de connais-
sances nouvelles. Il s’est attardé dans le district de Peshawar,
cœur de l’ancien Gandhâra. Par une orientation majeure de
sa carrière, il se fixe sur l’archéologie de cette région et sur
le bouddhisme, dont il expose à partir de 1897 les premiers
résultats scientifiques dans divers articles et notes. En 1901,
il devient le directeur de l’École française d’Extrême-Orient
(Éfeo) pour un an, après Louis Finot (1864-1935). Il participe
ainsi à la tâche d’organisation de cette institution tout récem-
ment fondée, et publie des notes sur l’art du Gandhâra dans
le bulletin de l’École de 1901. En 1905, paraît L’art gréco-
bouddhique du Gandhâra, Étude sur les origines de l’influence
classique dans l’art bouddhique de l’Inde et de l’Extrême-
Orient, tome I, Paris. C’est « le » grand livre sur une période
cruciale de l’histoire de l’art en Inde, en tant que transition
de l’influence hellénistique à la culture de l’Inde. C’est aussi
un grand livre sur le bouddhisme. Il dépasse en effet, et de
beaucoup, la promesse de son sous-titre. Alfred Foucher s’est
manifestement attaché à définir non seulement la technique
d’origine grecque, mais aussi l’adaptation au milieu indien
et bouddhiste des commanditaires des œuvres d’art, milieu
qu’il découvre à l’aide de la comparaison méthodique avec
les sources littéraires. Il prend d’ailleurs le soin d’exposer
sur chaque point sa méthode d’approche – observation des
œuvres et appel aux textes dans le plus grand détail –, et son
avancée progressive vers la meilleure interprétation.
Sa carrière se partage ensuite entre l’enseignement à la
Faculté des Lettres de Paris et l’École pratique des hautes
études, sans cesse ponctuée par de nouvelles missions de
grande importance. Il assure de nouveau la direction de
l’École française d’Extrême-Orient de 1905 à 1907. De 1918
à 1921, il revient en Inde pour collaborer avec l’Archaeolo-
gical Survey of India et son directeur Sir John Marshall (1876-
1958), avant de poursuivre par une mission en Perse. En 1922,
il est chargé par l’Académie des inscriptions et belles-lettres
de répondre à la demande du gouvernement d’Afghanistan
d’organiser la recherche archéologique dans ce pays. Il y
séjourne jusqu’en 1925, fondant la Délégation archéologique
française en Afghanistan (Dafa) et dirigeant les fouilles à la
recherche de l’antique Bactres (Bernard 2002). En 1926, il est
chargé de la direction de la Maison franco-japonaise fondée
par son ami Sylvain Lévi. Ce sera sa dernière mission.
Quand il revient en France, il succède à Émile Senart (1847-
1928) à la direction de l’Institut de civilisation indienne et
entre à l’Académie des inscriptions et belles-lettres dès 1928. Il
consacre alors sa science et son talent à l’enseignement. Avec
un souci particulier d’authenticité, il cherche à faire connaître
autre chose que le passé mort des textes et des monuments
oubliés, à transmettre sa propre expérience d’explorateur de
la culture profonde de l’Inde, à montrer ce qui du patrimoine
culturel ancien reste vivant. Il adapte à Paris le programme
d’enseignement du sanskrit des écoles traditionnelles, en
prenant comme base les mêmes manuels.
Ses activités de maître, de voyageur, d’administrateur,
ne lui ont guère laissé le temps de rédiger les ouvrages où
déposer les résultats de ses recherches. La retraite lui permet
de s’y consacrer. On voit donc paraître, à l’issue de sa carrière
universitaire, le principal de son œuvre. En 1939 sort l’une
des plus prestigieuses publications de l’Archaeological Survey
of India, The Monuments of Sanchi, trois grands in-folio
où Alfred Foucher traite l’iconographie, aux côtés de Sir
John Marshall qui assure la description architecturale et
de N.-G. Majumdar qui publie les inscriptions. Sanchi, site
antique de l’Inde centrale, offre à Alfred Foucher beaucoup
de représentations des vies antérieures, avec un traitement
culturel proprement indien, alors que le Gandhâra lui avait
donné l’occasion de retracer la vie du Bouddha dans de grands
détails. Avec ces deux sources majeures de documents sur
l’art bouddhique, avec le savoir qu’il a acquis par le recours
perpétuel aux écrits bouddhiques, il peut parcourir l’ensemble
 6
6
1
/
6
100%