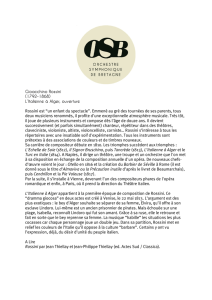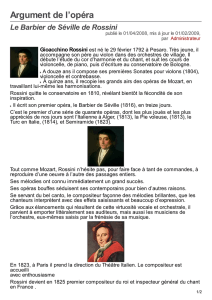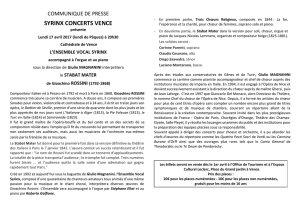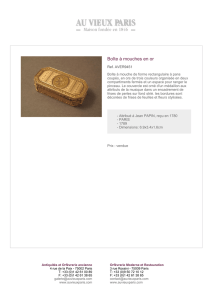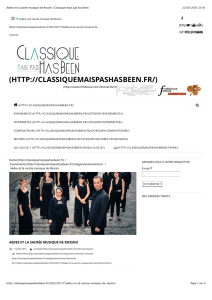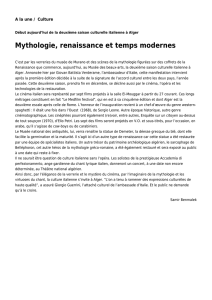nne à Alger L`Italienne à Alger

N° 203 Par Danielle PISTER
CERCLE LYRIQUE
DE METZ
2011-2012
Composition graphique et impression : Co.J.Fa. Metz - tél. 03 87 69 04 90.
L'Italienne àà AAlger
de Gioacchino Rossini
La conférence sur « L’Italienne à Alger » de Rossini sera faite par Pierre Degott,
Professeur à l’Université Paul Verlaine de Metz, membre du comité de
l’ « Association des Amis d’Ambroise Thomas et de l’Opéra français », le samedi 3
mars à 16 heures au foyer « Ambroise Thomas » de l’Opéra-Théâtre (entrée libre).
La conférence sera précédée, à 15 heures, de l’Assemblée générale du Cercle
Lyrique de Metz, puis ensuite de l’Association des Amis d’Ambroise Thomas, et
ouverte à tous les membres des deux associations et des personnes intéressées.
Représentations messines de « L’Italienne à Alger » auront lieu les
mercredi 7 mars et vendredi 9 mars à 20h ainsi que le dimanche 11 mars à 15h.
La distribution de cette coproduction de l’Opéra National de
Lorraine et de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole est la suivante :
Direction musicale : Paolo Olmi. Mise en scène : David Hermann.
Décors : Rifail Ajdarpasic. Costumes : Bettina Walter.
Lumières : Fabrice Kebour.
Distribution vocale :
Isabella : Isabelle Druet Lindoro : Yijie Shi
Mustafa : Carlo Lepore Taddeo, compagnon d’Isabella : Nigel Smith
Elvira, sa femme : Yuree Jang Zulma : Olga Privalova
Haly : Igor Gnidii
Chœur des hommes de l’Opéra National de Lorraine ; Chœur des hommes de
l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole ; Orchestre symphonique et lyrique de Nancy.
Couverture : Portrait de Rossini jeune, pendant la composition de « L’Italienne à
Alger ».
Conception de la plaquette : Danielle Pister et Georges Masson .
Directeurs de publication : Georges Masson, président et Jean-Pierre Vidit, premier
vice-président.
Adresse postale du Cercle Lyrique de Metz : B.P. 90261 - 57006 Metz Cedex 1
Adresse e-mail du président : [email protected]
Adresse du site et du blog Internet : www.associationlyriquemetz.com
L'Italienne
à AAlger
de Gioacchino Rossini

La ville d'Alger sous les turcs.

1
L'Italienne àà AAlger
Gioacchino Rossini
1815
par
Danielle PISTER
44
0 12497388: 124: 1224 3886
7 >' (CD # (*<<
<9 30$0+9K. <@)9
@/ <9 P+< 9K. ?0i)+
H) <CI 70 Q @01
7+? )) P2 <<R
V ?<R %0 ?@) +@
<- .< j] 0? <W
% <C< K2 Q2 %(<C
\ 7]+ 0< <QV 0)Z
IC 0< I ?C0 )7
% 0++0=0V7] 0=07 0=0P?
<& Q3.. WR ?0) V0
VIDÉOGRAPHIE
Retrouvez toute l’actualité du Cercle lyrique de Metz sur
http://www.associationlyriquemetz.com
Le Cercle Lyrique de Metz a décidé de créer un site et un blog Internet, site
installé par les soins de Sandra Wagner, et que nous avons, au fil des mois, structuré
à l'image d'un journal culturel numérique, grâce à la précieuse collaboration de notre
actuel webmaster, Jean-Pierre Pister, ainsi que des spécialistes de notre comité-
directeur qui y contribuent.
Nos rubriques se sont étoffées, que ce soit au niveau de l'annonce des activités lyriques
et musicales de la région, (Opéra-Théâtre de Metz-Métropole, Orchestre National de
Lorraine, Arsenal Metz-en-scène, Kinepolis : l'opéra au cinéma...), que des critiques
d'opéras donnés à Metz ainsi que des comptes rendus de spectacles vus extra-muros
(triangle Metz-Nancy-Strasbourg), de même que des critiques figurant sous le label
« L'opéra à l'écran ». On est d'ailleurs convenu de rendre compte dorénavant de toutes
les retransmissions d'opéras depuis le MET de New-York et programmées au Kinepolis
de Saint-Julien-les-Metz, qui figurait, d'ailleurs, parmi les quelque vingt partenaires de
soutien de notre colloque.
J'y ajouterai les rubriques « Conférences », « Conseils discographiques », « In memo-
riam », « Anniversaires », « Vu dans la presse », « Les livres du C.L.M. », les « Actes
du colloque » (avec son programme complet et la plupart des communications qui y ont
été prononcées), « Archives », « Partenariats », « Espace membres », etc....Dans la plu-
part de ces textes, des illustrations visuelles ou vocales sont jointes. Par ailleurs, dans
la mesure des résultats de nos investigations, nous sommes à présent dans la capacité
de mettre dans la partie « espace membres » de notre site, accessible aux adhérents
du C.L.M., les livrets de la plupart des opéras programmés au cours des saisons
messines.

43
2
0 1234 125673889 125:73811 129;
7 !+ &%< %'='
V0< ?H< <<2
@/ V0< ?H< <<2
H) @0 0 VP+( VP+(
K% @W ?< +?
V @0 <@ 0P .
<- W(P <. <. 2@
% (0 C2 V
\ << W.) <V3.
IC %@ W< .<
% .`<`%<H %<H <9W 7
0 1294 12:871228 12:5 12:4
7 * (+' $ +#
?HV 9<@ V0< 0R7
@/ ?HV 9<@ V0< 07
H) <CI @( <CI W3V
.P(( %( +? M+P
V Z< <V %(7 %(7
<- <. ?f?g 2 .< 0P
% V <++ K.3
\ @ \ +@
IC <(( ?) ?<
% `2,( ,`? 99 ?
0 12:2 1248 124: 1224
7 +* % $ >?@<A
@@ H0W .,W 9$@)
@/ Z7@+ .,.+ 0W V5&
H) W3V <CI ?+P Q
2?( %. 2R h(
V %(7 7V %(7 ?@)
<- W( 0C ++ Q7@
% Q3<P ]P .. 7VR
\ (( 2 ? .
IC ?@) K\ ?@) @@
% 0C % 7 V
0 3889 3884 3818
7 0(< # $B
V@P+ .9 WP
@/ .+@)@ C<@ VC0.@1
H) <.(( Q <.((
<< PCPR fPf
V P70 ?9 P70
<- <W ?< (+((
% P)P+ 0VC ((
\ Q<< ?3<)) %
IC ?% 70 <
% 7C @+ K
DISCOGRAPHIE

342
SOMMAIRE
Le Cygne de Pesaro p. 7
L'Italienne à Alger p. 12
L'intrigue p. 16
Nouveauté et continuité p. 18
Les personnages p. 28
Réception de l'œuvre p. 36
Les créateurs p. 37
À lire p. 39
À écouter p. 40
Discographie p. 43
Vidéographie p. 44
Solisti Veneti, dirige avec brio une partition critique de l’œuvre. On peut
regretter que la version CD n’ait pas repris les airs alternatifs que compor-
tait le microsillon.
Seule Lucia Valentini-Terrani peut prétendre tenir la dragée haute à
Marilyn Horne avec sa voix somptueuse, la plus proche du contralto de la
créatrice. Mais elle chante plus Tancrède que l’ingénieuse Isabella dans les
versions dirigées par Bertini et Ferro. Dans la première, Bruscantini campe
un Mustafà vocalement et dramatiquement adéquat, Benelli ne démérite
pas, Enzo et Corbelli complètent avec talent la distribution. Dans la version
Ferro, la direction engendrerait la sinistrose. Dommage pour Francisco
Araiza, le plus séduisant des Lindoro au disque. Cette version a cependant
le mérite d’être exhaustive. L’équipe réunie par Claudio Abbado, pour sa
version studio, séduit sur le papier, moins à l’écoute. Le chef n’est pas en
cause mais Agnes Baltsa n’est pas à l’aise dans cette tessiture, Lopardo
manque de charisme et Raimondi ne convainc guère en Mustafà. Jennifer
Larmore, dirigée par Lopez-Cobos, campe une Isabella autoritaire à sou-
hait et son entourage est de bon niveau. En appendice, on peut entendre le
second air de ténor écrit par Rossini pour le second acte. Dix ans plus tard,
dans des extraits en anglais, la voix de Jennifer Larmore trahit une fatigue
certaine.
Il faut signaler un duo, Ai capricci della sorte, entre Cecilia Bartoli et Bryn
Terfel, chez Decca, où il est démontré que l’art de la vocalise peut faire bon
ménage avec un humour de bon aloi. Bartoli a enregistré d’autres extraits
dans divers récitals Rossini.
La version la plus récente, sous la direction du grand spécialiste rossinien
Alberto Zedda, avec la génération montante des chanteurs qui maîtrisent
parfaitement ce répertoire, et sont déjà reconnus internationalement, offre
une excellente surprise. La Sicilienne Marianna Pizzolato se glisse avec
bonheur dans le personnage de la volcanique héroïne. Lawrence Brownlee,
bien connu des habitués des retransmissions du Metropolitan Opera, peut
séduire, par la beauté de la voix et son art du chant, plus d’une Italienne.
On n'oubliera pas les pionniers de la « Renaissance Rossini » mais, pour
leur plus grand bonheur, les mélomanes savent que la relève est assurée.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
1
/
47
100%