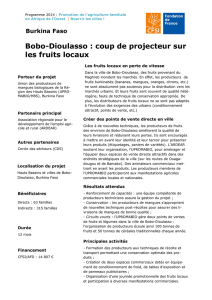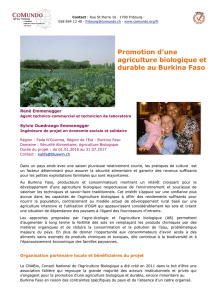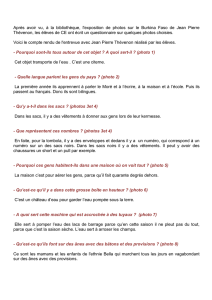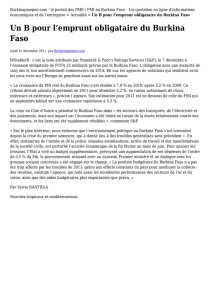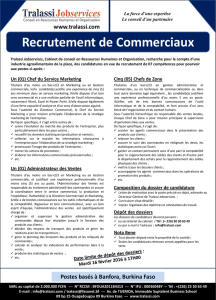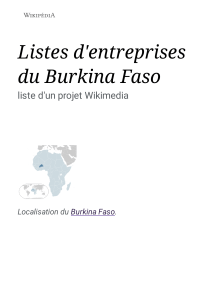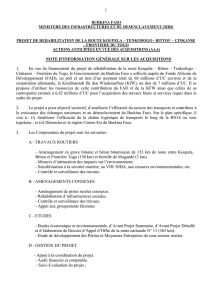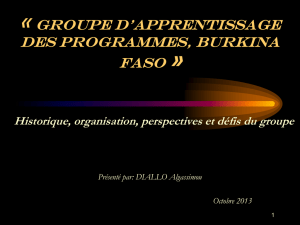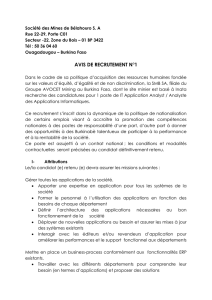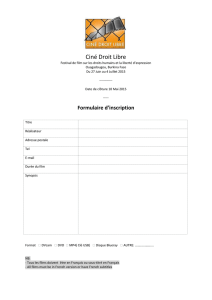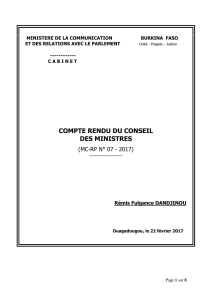Miser sur l`investissement dans des pôles de croissance et se

Étude de cas - La Banque mondiale au Burkina Faso - Avril 2016
Miser sur l’investissement dans des pôles de croissance
et se leurrer sur ses bienfaits pour l’agriculture familiale
Le Burkina Faso est un pays enclavé
d’Afrique subsaharienne, à faible revenu
($690,4 de revenu national brut par ha-
bitant en 2014) et aux ressources natu-
relles limitées. La population, qui croît
au rythme annuel moyen de 3%, était
estimée à près de 17,9 millions en 2014.
L’économie est fortement dominée par
l’agriculture. Le coton est la culture de
rente la plus importante pour le pays,
même si les exportations aurifères
ont pris de l’importance ces dernières
années. Depuis 2014, la baisse des cours
du coton explique un ralentissement de
la croissance du pays, passé de 6 à 4%.
Introduction
1. Élements de contexte
Priorités politiques dans le secteur
agricole
L’orientation stratégique en matière
de politique agricole est inscrite dans
plusieurs documents de politique
générale dont l’élaboration du Cadre
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
(CSLP) en 2000, la Stratégie de Déve-
loppement Rural (SDR) en 2003, mais
aussi la stratégie de croissance accé-
lérée pour le développement durable
(SCADD, 2011-2015).
Plus spécifiquement dans le secteur
agricole, le programme national du
secteur rural (PNSR) guide les projets
et l’action des partenaires techniques
et financiers. Conformément à ces
textes, le gouvernement entend
réaliser une croissance économique
forte qui, pour l’agriculture, se
concrétise par le soutien de l’agro-
business et des exploitants familiaux.
1: Cette fiche se base sur une étude menée au Burkina
Faso par Hamadé Sigué en collaboration avec la
Confédération paysanne du Faso, à la demande de
SOS FAIM et visant à faire le point sur les stratégies et
financements de la BM dans le secteur agricole. L’étude
complète se trouve sur le site www.toustrompés.be
L’agriculture en chire au
Burkina Faso
Population active agricole (2004)
92,18%
Part du PIB agricole dans le PIB
total (2014) : 38,0%
Production de céréales (2004)
2.902 milliers de tonnes
Rendement des céréales (2013)
1.152 kg/ha
Production de viande (2007) 240
milliers de tonnes
Terres arables (2009) 21,6%,
Terres cultivables 9 milliards
d’ha, dont 1/3 actuellement
exploités
Consommation d’engrais (2010)
9,4 kg/ha
Nombre de tracteurs pour 1000
ha cultivés (2003) 0,4
Forêts (pourcentage du territoire)
(2013) 20,0%
© SOS Faim

2. L’engagement de la Banque
Mondiale au Burkina Faso
Stratégie
Les Politiques d’Ajustement Structurel
(PAS) des années 1980 de la Banque
Mondiale (BM) ont jeté les bases d’une
logique poussant à une libéralisation de
l’économie et une production agricole
principalement orientée vers l’expor-
tation du coton. L’engagement global
de la BM au Burkina Faso s’élève à $120
millions dont 110 millions proviennent
de l’Association Internationale de Dé-
veloppement (AID). Cet investissement
est dédié à la réalisation de projets
agricoles, d’infrastructures éducatives
et sanitaires, en lien avec les priorités
nationales. L’appui de la BM vise à
minimiser la vulnérabilité économique
et à promouvoir la transformation
économique à travers l’augmentation
de l’investissement privé, la création
d’emplois et la hausse de la production
agricole. Cet engagement est fortement
en déclin ces dernières années, ce qui
pose question au regard de l’engage-
ment de la BM pris en 2008 de soutenir
l’agriculture familiale.
Cfr. graphique
Source : Site de la Banque Mondiale : http://www.banquemondiale.org/fr/country/burkinafaso
Burkina Faso : Engagements par exercice (en millions de dollars)
Les montants comprennent les engagements de la BIRD et de l’IDA)
En revanche, l'engagement actuel de
la Société financière internationale
(SFI) - filière de la BM qui soutient les
acteurs privés qui investissent dans
les pays en voie de développement
- grimpe aujourd’hui à $52 millions,
principalement dans le secteur des
mines, de la finance, des assurances,
de l’électricité, et du commerce.
Dans le classement Doing Business
(DB), un indicateur visant à classer
les pays membres du groupe de la
BM (188 États membres) selon la fa-
cilité à y faire des aaires, le Burkina
Faso est passé de la 149 place en
2015, à la 143 place en 2016, et ce,
principalement grâce à une évolution
de son cadre réglementaire pour faci-
liter la création d’entreprises (délais
écourtés, capital minimum diminué).
Selon la BM, ce bond en avant en fait le
5 pays réformateur sur la période.
3. Les projets financés dans le
cadre de l’IDA Le projet de pôle de croissance de Bagré
(PPCB) est un projet d’aménagement
et de réattribution des terres dans la
zone de Bagré. Il s’inscrit dans un projet
antérieur de l’État visant dans les années
1970 à combattre l’onchocercose dans
la région (couramment appelée la cécité
des rivières) pour lutter contre la pau-
vreté, stimuler l’emploi en milieu rural et
atteindre la souveraineté alimentaire.
À l’époque, les bénéficiaires des aména-
gements successifs de la zone étaient
surtout les agriculteurs familiaux. Mais
en 2009, sous la pression des bailleurs,
les financements sont conditionnés à
la rentabilité des investissements et
une ouverture aux investisseurs privés
nationaux est consentie avec un pla-
fond de 54 hectares par bénéficiaire.
En 2011, la BM donne un nouveau tour-
nant au projet PPCB, et la gestion des
aménagements qui était depuis lors à
caractère public passe à une gestion
privée d’économie mixte. À vocation
agroindustrielle, le projet PPCB entend
soutenir l’investissement privé, tout
comme l’agriculture familiale, à travers
le renforcement de capacité institution-
nelle, la réalisation d’infrastructures
critiques et les services critiques.
L’étude à la base de cette fiche a surtout
mis en avant le projet BagréPole, un
projet ambitieux visant à développer la
ville de Bagré pour en faire un modèle de
pôle de croissance agro-industriel. Mais
d’autres projets concernent également
le secteur agricole comme (1) le PAFASP
(Programme d’appui aux filières agro-
sylvopastorales), visant à renforcer les
capacités des agriculteurs familiaux et
les infrastructures de mise en marché
à travers le financement de micro-pro-
jets; (2) le PAPSA (Projet d’amélioration
de la productivité et de la sécurité
alimentaire), visant à accroitre les pro-
duits agrosylvopastoraux, au profit des
petits producteurs, et particulièrement
les femmes et (3) le PNGT (Programme
national de gestion territoire), visant
à accompagner les communes
tdans le cadre de la mise en œu-
vre de leur développement territorial.
Le pôle de croissance de Bagré

a) De facto, un projet au profit de
l’agrobusiness
Témoignage d’une promotrice
par rapport à la subvention de
FASBagré
« On est venu me dire de monter
mon dossier et venir déposer que
j’aurai un financement à hauteur
de 80% pour la réalisation de mon
projet. Alors je me suis lancée dans
le processus. Pour le montage de
mon plan d’aaire, j’ai contribué
pour 500 000 FCFA correspondant
au 20% de contribution exigée par
le PPCB. Après tout ça, j’ai déposé
mon dossier à FASBagré. On m’a
dit ensuite d’aller voir un notaire.
A ce niveau, on me demande 1 000
000 FCFA et un PUH (titre de pro-
priété). J’ai tout fait pour donner
l’argent et je suis revenu pour
entrer en possession de mon PUH
et jusqu’à là toujours rien. Après les
diérents voyages à Ouagadougou,
amortissement de mon engin et
les diérentes contributions, je me
suis appauvrie. Je me demande
si tout cela était nécessaire ? Mes
1 500 000 FCFA suisaient pour
servir de garantie en banque pour
que je gagne un crédit. Le PPCB
n‘est pas venue pour nous aider
mais pour nous appauvrir. »
Il est prévu que le projet contribue à
l’accroissement de l'activité écono-
mique par l’augmentation de l'inves-
tissement privé, la création d'emplois
et l’intensification de la production
agricole. Dans cette perspective, la
redistribution des terres profite de facto
majoritairement à l’agrobusiness (plus
de 75% des terres aménagées). Même
sur les 25% restant, les agriculteurs
familiaux n’y trouvent pas leur compte.
Le projet ne finance pas les dépenses
encourues par les agriculteurs familiaux
pour leur permettre de produire plus et
mieux, mais il finance un fonds d’appui
appelé FASBagré, servant à accompa-
gner les exploitants en co-finançant
la réalisation de plans d’aaires, ainsi
que des voyages d’études à l’étranger.
Ce fonds ne finance ni les équipe-
ments, ni les fonds de roulement, ni les
infrastructures, ni les autres intrants
nécessaires à la production agricole.
C’est le crédit contracté par les pro-
moteurs qui servira pour financer ces
investissements. Très concrètement, ce
genre de service est loin des réalités et
des besoins des exploitants familiaux ;
un tel fonds aurait pu servir à faciliter
l’accès au mircocrédit, à travers des
fonds de garantie directement acces-
sibles à des agriculteurs familiaux sur
base d’un titre de propriété délivré dans
le cadre du projet. Malheureusement,
ni le projet dans sa globalité, ni le fonds
FASBagré n’ont été conçus dans cette
perspective.
b) Un projet top-down sans
concertation eicace avec les
acteurs du terrain
même de disposer d’une information
fiable à répercuter au niveau des béné-
ficiaires. Lors de la création de la fédéra-
tion, l’administration de Bagrépôle avait
annoncé la mise en place avec un fonds
de roulement d’environ 500 millions de
FCFA en vue de permettre à la fédéra-
tion de mener des activités et faciliter
son opérationnalisation sur le terrain.
Ceci est resté sans suite…
Plus particulièrement au niveau de
la production de riz, une union des
groupements de producteurs a été
créée en 2006 (UGPRB) afin de résoudre
les problèmes de commercialisation
et d’équipement. À nouveau et tout
comme la fédération, l’UGPRB n’a
aucune représentation au sein du
conseil d’administration et donc aucun
moyen d’influencer le projet.
c) Un projet conduisant à l’expulsion
des paysans
Le PPCB ne s’en cache pas, il compte
des PAP – Personnes Aectées par le
Projet – aussi appelées ‘les déguerpis’.
Il s’agit de personnes expulsées des
terres sur lesquelles elles vivaient ou
qu’elles exploitaient, pour permettre
l’aménagement des périmètres irrigués.
D’après les informations oicielles,
1556 personnes seraient concernées.
On parle d’un ratio de 5 à 6 ha retirés
contre une superficie de 0,5 à 1 ha
aménagé octroyé en compensation.
Une enquête commanditée par la CPF
est en cours pour faire le bilan des PAP
et des mesures de compensation (in-
demnisation, réattribution de parcelles,
etc.). Néanmoins, on dénonce déjà de
toute part le fait que, tant les déguerpis-
sements que les mécanismes d’indem-
nisation (montants et modalités) aient
été imposés aux PAP sans faire l’objet
de négociation ni d’attribution au préa-
lable des parcelles d’exploitation et de
logement. Pour la majorité d’entre eux,
cette situation d’attente dure depuis
plus de deux ans.
À ce sujet, le président de l’Union
s’exprime : « J’ai 3 femmes et 7
enfants avec une superficie de 0,74
hectare. Au lieu d’octroyer 100 ha
à un seul agrobusiness-man, pour-
quoi ne pas nous les attribuer, nous
petits producteurs ? Nous sommes
en train d’évoluer vers une situation
où nous servirons de main d’œuvre
pour ces gens, des ouvriers agri-
coles, en quelque sorte ».
En 2013, une fédération a été créée
suite à un besoin du PPCB de disposer
d’un interlocuteur unique représentant
les producteurs et leurs organisations.
Les missions et rôle de cette fédération
sont : l’organisation des producteurs
pour la réussite des activités, l’infor-
mation, la sensibilisation, la formation
des producteurs ou l’appui conseil pour
faciliter l’adoption des principes et
techniques améliorant la production de
riz. Cependant, la fédération déplore sa
non-représentation au conseil d’admi-
nistration du projet, ce qui ne permet
pas de jouer son rôle au profit des
organisations paysannes membres, ni
Le PAFASP, le PAPSA et le PNGT
Ces trois projets se distancient de
BagréPole en ce qu’ils ne misent pas sur
l’investissement privé (étranger). Dans
leurs stratégies et leurs approches,
ils ciblent les agriculteurs familiaux et
les acteurs ruraux, à travers la mise en
œuvre de micro-projet (PAFASP), ou un
objectif de renforcement de capacités
(PAPSA), en accordant une place parti-
culière aux femmes.
Le PNGT est certainement le programme
le plus salué par les acteurs de terrain,
de par son caractère inclusif. En eet,
il est ancré dans les structures locales
existantes et d’aucuns reconnaissent

4. Les revendications de la
Confédération paysanne du
Faso (CPF)
La Confédération paysanne du Faso, interrogée par le consultant, a signifié à
l’encontre de la BM un éventail de revendications formulées comme suit :
Selon le président de la CPF :
« La BM fait de l’économétrie (ren-
tabilité financière) et propose des
modèles au pays. Des projets finan-
cés, la préoccupation de la BM vise
la mise en marché et les infrastruc-
tures, mais rien n’est fait au niveau
de la production. C’est un trompe-
l’œil quand la BM déclare mettre
l’agriculture familiale au cœur de
ses préoccupations. En conclusion,
la BM détourne les Etats de leur
souveraineté et de ce fait, n’est pas
pour la promotion de l’agriculture
familiale. Sinon, comment peut-on
comprendre que l’agriculture soit
le socle du développement et que
l’Etat opte pour soutenir des inves-
tisseurs étrangers ? L’Etat doit être
souverain et ne doit pas être obligé
d’accepter tous projets venant des
bailleurs ».
Soutenir l’agriculture familiale
Avec l’avènement de la promotion de
l’agrobusiness, les préoccupations
et attentes des petits exploitants
semblent être reléguées au second
plan des priorités du gouvernement
burkinabé et de la BM. Or, conformé-
ment à son principe de contribuer
à lutter eicacement contre la pau-
vreté, la BM de par son influence sur
le gouvernement, devrait accorder
prioritairement son financement aux
exploitants familiaux.
Mieux impliquer les acteurs et les
responsabiliser dans les projets
Le niveau d’implication des acteurs
est faible. Les interventions de la BM
doivent être accompagnées d’une
réelle volonté d’impliquer les acteurs
et de les responsabiliser. Aussi, cette
implication doit s’accompagner d’une
formulation de véritable politique
d’opérationnalisation des structures
de représentations des producteurs
(recrutement, formation et respon-
sabilisation). La non implication et la
responsabilisation insuisante des
structures représentatives des organi-
sations des producteurs est un goulot
d’étranglement dans la mise en œuvre
des projets agricoles.
Résoudre, aux côtés de l’Etat
burkinabé, les problèmes du foncier
Dans le cadre du projet PPCB, les
bénéficiaires plaident pour une ré-
partition des terres agricoles juste et
équitable. Cela doit être un préalable
à une ouverture vers les agrobusiness
-man. (i) Satisfaire les besoins en
terre, (ii) sécuriser les exploitants
familiaux et (iii) octroyer une indem-
nisation équitable et suisante aux
populations déplacées.
Sécuriser au plan foncier les petits
producteurs
La délivrance des titres de propriété
est une des grandes revendications
des producteurs. Il est important
que le gouvernement burkinabé, en
collaboration avec la BM, travaille à
résoudre la question de la sécurisa-
tion foncière. Les titres doivent servir
de garantie pour contracter des prêts.
Octroyer une indemnisation juste,
équitable et suisante aux popula-
tions déplacées
Concertations entre les diérentes
parties pour arrêter de façon consen-
suelle les modalités d’indemnisation.
Harmonisation des modalités à l’en-
semble des sites et de façon équitable
pour les producteurs qui séjournent
dans le site depuis bien longtemps.
Alléger les procédures et lourdeurs
administratives
La complexité des procédures, notam-
ment dans la passation des marchés
et le déblocage des fonds, plombent
le niveau d’absorption financière des
projets et compromettent la réalisa-
tion des actions sur le terrain.
Ces procédures et lourdeurs sont d’ap-
plication au niveau de l’Etat mais aussi
de la BM, et doivent être simplifiées.
Adapter les financements pour
qu’ils correspondent au contexte local
et profitent en priorité aux agricul-
teurs familiaux
Dans la majeure partie des projets
étudiés, les financements de la BM
ne sont pas en adéquation avec les
réalités locales (exclusion de certaines
priorités des producteurs dans les
plans de financement, contribution
des bénéficiaires élevée, etc.). Pour
une adéquation avec les réalités
locales, il est souhaitable que les
conditions du fonds puissent prendre
en compte la subvention d’un mini-
mum d’équipement pour les petits
producteurs (femmes et jeunes). Les
contributions personnelles doivent
être revues à la baisse pour être adap-
tées à la capacité financière réelle des
promoteurs, mais aussi à la nature
de l’action à exécuter. L’exemple du
modèle système de warrantage mis en
place par la CPF et la FEPAB qui était
performant et adapté aux conditions
des producteurs ne demandait qu’à
être consolidé et diusé à grande
échelle.
que la concertation au niveau commu-
nal joue un rôle majeur dans la réduction
des problèmes fonciers, bien que la CPF
déplore du coup l’absence d’inclusion
des organisations paysannes faitières.
Dans tous les cas, ces projets ne sont
pas pour autant à applaudir des deux
mains. Tous font l’objet de sérieuses
critiques au niveau de leur mise en
œuvre. Les lourdeurs administratives
freinent les retombées positives au
profit des agriculteurs et entrainent,
de ce fait, un faible niveau d’exécu-
tion budgétaire (PNGT2 – 36% de
réalisation). Au-delà, le PAFASP a été
fortement critiqué. D’une part, car il
est trop centré sur les filières d’expor-
tations (mangues, oignon, bétail et
volaille) et moins sur les cultures
vivrières. D’autre part, pour avoir
court-circuité les chambres régionales
d’agriculture et avoir fait fi de la dimen-
sion de genre (15% des bénéficiaires
sont des femmes).
Étude de cas - La Banque mondiale au Burkina Faso - Avril 2016
Auteur : Viginie Pissoort
Mise en page : Fanny Gosset
1
/
4
100%