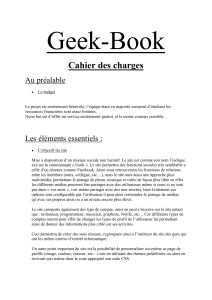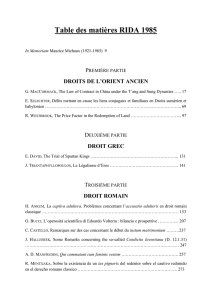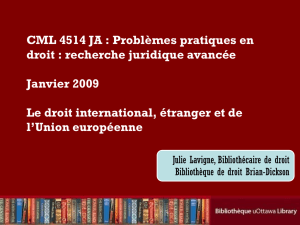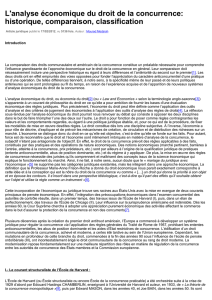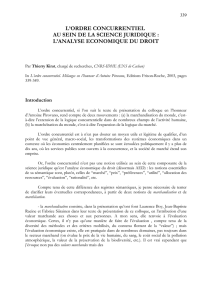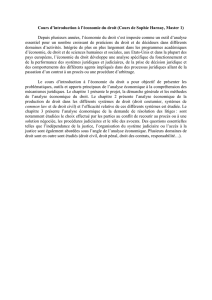BRUNO DEFFAINS, SAMUEL FEREY THÉORIE DU DROIT ET

BRUNO DEFFAINS,SAMUEL FEREY
THÉORIE DU DROIT ET ANALYSE ÉCONOMIQUE
L’analyse économique du droit est aujourd’hui un champ de tout premier
plan de la recherche en économie. Certains commentateurs y voient même l’un
des renouvellements les plus importants de la théorie économique depuis un
demi-siècle (Medema [1999]). Née aux États-Unis sous l’influence d’écono-
mistes et de juristes rattachés à l’École de Chicago, l’analyse économique du
droit contemporaine a eu un retentissement sans précédent dans ce pays. Insti-
tutionnellement, ce développement a touché aussi bien la recherche acadé-
mique en économie que les pratiques des juristes eux-mêmes comme la créa-
tion de cursus de Law and Economics dans les facultés de droit ou l’utilisation
de plus en plus importante d’arguments économiques par les avocats ou les
juges (Garoupa et Ulen [2006]). Ainsi, la nécessité, pour les économistes
comme pour les juristes, de participer à la construction d’un discours interdis-
ciplinaire à la frontière de la théorie du droit et de la théorie économique est
devenue de plus en plus évidente. D’une part, la place grandissante des conten-
tieux juridiques sur des questions économiques (droit de la concurrence, droit
des contrats, droit du travail) impose aux économistes de mieux connaître, de
mieux comprendre et de mieux expliquer le rôle des règles de droit et de leur
application au sein des économies contemporaines. D’autre part, l’effet écono-
mique des règles juridiques impose également aux juristes de mieux connaître
les conséquences économiques de chacune de leurs décisions.
Alors même que le mouvement a essaimé dans nombre de pays européens
(Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Italie), la situation en France est
assez en retrait dans la mesure où les juristes et les théoriciens du droit restent
extrêmement réservés sur la pertinence du projet d’analyser le droit grâce aux
outils des économistes1. Pour ce qui concerne la France, cette réserve s’exprime
Droits — 45, 2007
1. Cette différence d’accueil réservé par les juristes à l’analyse économique du droit
a suscité de nombreuses interrogations sur les facteurs qui ont joué aux États-Unis et pas
en Europe (Garoupa [2006]). Ainsi, il est clair que l’organisation des études juridiques
aux États-Unis, le terreau jurisprudentiel sur lequel s’est développée la rencontre entre
droit et économie, la place de la common law dans le système juridique américain sont
autant de déterminants qui ont joué, à des degrés divers, un rôle important.
223
S:\53775\53775.vp
mercredi 23 mai 2007 11:57:04
Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite Default screen

de multiples façons et frôle parfois la caricature. Ainsi par exemple, pour
Legendre, la « mode passagère » de la « thématique Law and Economics » est
« censée aligner la réflexion juridique sur la théorie du marché » (Legendre
[2001], p. 189), ou, pour Supiot, l’analyse économique du droit ne serait
qu’une variante d’une théorie utilitariste et partagerait avec elle ses conséquen-
ces sacrificielles (Supiot [2005], p. 297)1; ou encore, pour Gaudu, les écono-
mistes feraient preuve de scientisme lorsqu’ils discutent du droit (Gaudu
[2005]). Provenant d’éminents juristes2, ces critiques peuvent cependant facile-
ment être écartées.
D’une part, elles ne font pas droit – par ignorance sans doute – à la pluralité
des approches existantes en économie du droit (Mercuro et Medema [1997]).
Certes, on trouve des analyses économiques du droit libérales, voir ultralibéra-
les autour de l’École autrichienne par exemple, tout comme on trouve des
recherches proches de l’utilitarisme au sein de l’école de Chicago3. Mais au
regard de la diversité des recherches menées dans ce champ, il est proprement
impossible d’assimiler analyse économique du droit et libéralisme tout comme
d’assimiler analyse économique du droit et utilitarisme. Qu’il suffise ici de rap-
peler, sur le premier point, que l’un des fondateurs de l’analyse économique du
droit, Ronald Coase, n’a cessé de chercher à comprendre pourquoi certains
modes de coordination non marchands pouvaient précisément être efficaces.
Qu’il suffise également de mentionner, sur le second point, qu’il ne faut pas
confondre l’utilitarisme en tant que théorie de l’action et en tant que théorie
morale. On peut tout à fait adhérer à une représentation de la théorie de
l’action en termes d’utilité sans pour autant adhérer à la théorie morale utilita-
riste4. On peut d’ailleurs considérer que, même en ce qui concerne la théorie de
l’action, la théorie économique a rompu avec l’utilitarisme. Et si elle a gardé la
notion d’ « utilité » pour analyser les comportements des agents, elle ne fait plus
désormais référence à un quelconque contenu psychologique.
Ainsi, l’économie du droit contemporaine est marquée au coin du plura-
lisme méthodologique et théorique. À côté des travaux directement inspirés de
Posner, on trouve désormais une analyse économique du droit néo-institu-
224 Bruno Deffains, Samuel Ferey
1. La critique de Supiot est d’autant plus surprenante qu’il cite dans la même page
Hayek et Posner alors que tout sépare ces deux auteurs aussi bien du point de vue de leur
représentation du droit que de leur représentation de l’économie ! Plus simplement,
Supiot adresse à l’ensemble de l’économie du droit une critique qui ne concerne que la
théorie utilitariste du droit parfois défendue par certains économistes du droit.
2. Notons sur ce point que des philosophes du droit de premier plan, comme Hart
par exemple, ont été relativement bienveillants à l’égard de l’analyse économique du droit
(voir Hart [1961] ; Hart [1977]).
3. Sur le lien extrêmement complexe de Posner et de l’utilitarisme, voir par exemple
Strowel [1992].
4. Ainsi, un auteur comme Rawls, par exemple (du moins le Rawls de la Théorie de la
justice), tente de construire une théorie de la justice explicitement anti-utilitariste sur le
fondement de la théorie du choix rationnel (Rawls [1971]). Preuve s’il en est qu’il faut se
garder de confondre la théorie de l’utilité en tant que théorie de l’action et en tant que
théorie normative.
224
S:\53775\53775.vp
mercredi 23 mai 2007 11:57:05
Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite Default screen

tionnaliste fondée avant tout sur l’importance des coûts de transaction, une
analyse économique du droit comportementale qui a renoncé à l’hypothèse de
rationalité parfaite au profit d’une théorie de la rationalité limitée, ou encore
des analyses directement inspirées de la théorie des jeux qui mettent l’accent
sur les asymétries informationnelles et sur les stratégies des acteurs.
Les quelques critiques à l’encontre de l’analyse économique du droit briè-
vement rappelées ci-dessus ne sauraient donc constituer des critiques sérieuses
contre l’économie du droit en tant que champ disciplinaire. Leur portée
concerne certains auteurs ou certains corpus particuliers de l’économie du
droit. Elles ont cependant un mérite : celui de traduire sûrement un manque
d’explication sur le statut épistémologique des recherches menées en économie
du droit. On doit d’ailleurs reconnaître que ces malentendus sont souvent le
fait des économistes du droit eux-mêmes. Ainsi, par exemple, si l’on étudie la
classification proposée par Kornhauser, et largement reprise dans les ouvrages
de présentation de l’économie du droit, les économistes du droit semblent dis-
tinguer trois statuts à leur discours : le premier est descriptif ; le second, prédic-
tif ; et le troisième, normatif.
En tant que discours positif, l’analyse économique du droit est un discours
sur le droit. Il s’agit alors de prédire les conséquences des règles de droit (thèse
prédictive) ou, du moins, de décrire les réactions des agents aux différentes
règles de droit (thèse behavioriste). Dans les deux cas, l’hypothèse retenue pour
analyser le comportement des agents est l’hypothèse de rationalité, et la règle
de droit est représentée comme une contrainte – un prix « implicite » – pesant
sur les décisions individuelles des agents. En tant que discours normatif (thèse
normative), l’économie du droit a également un autre but, celui de défendre
l’idée que l’efficacité économique ou la maximisation du bien-être constitue un
but légitime du système juridique.
Une telle classification est très utile pour les économistes. Elle permet en
effet de bien faire le départ entre théorie positive et théorie normative. Mais,
pour le juriste, on peut raisonnablement penser qu’elle est insuffisante. En
effet, elle ne précise pas les rapports qui existent – et qui ont toujours existé
depuis la naissance du courant Law and Economics aux États-Unis au tournant
des années 1970 – entre théorie économique et théorie du droit. En effet, en
tant que théorie positive, l’analyse économique du droit semble être un dis-
cours externe au droit qui s’intéresse aux conséquences des règles de droit
comme peut le faire, par exemple, la sociologie juridique. On l’accuse alors de
rabattre systématiquement la norme sur les faits. En tant que théorie norma-
tive, l’économie du droit est une théorie morale qui, là encore, n’est que de peu
d’aide pour le juriste dès lors que les controverses sur la finalité d’un système
juridique ne relèvent pas en propre de la théorie juridique, au moins dans la tra-
dition positiviste.
L’objet de cet article est précisément de proposer quelques pistes de
réflexion sur les rapports qui peuvent exister entre théorie du droit et théorie
économique. Nous aimerions démontrer que l’économie du droit peut être
considérée non pas seulement comme une théorie prédictive des effets des
règles de droit, mais comme une théorie de l’interprétation juridique. Les res-
sources qu’elle peut apporter à la théorie du droit sont alors d’autant plus pré-
Analyse économique 225
225
S:\53775\53775.vp
mercredi 23 mai 2007 11:57:05
Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite Default screen

cieuses que celle-ci est plongée depuis les années 1960 – au moins au niveau
théorique et épistémologique – dans une crise persistante de l’interprétation.
Présentée ainsi, l’économie du droit présente alors plusieurs séries d’enjeux.
D’une part, cela permet de faire un sort à un certain nombre de confusions per-
sistantes en ce qui concerne le projet de l’économie du droit. D’autre part, une
telle perspective ouvre, à notre avis, des recherches fructueuses à l’intersection
de la théorie économique et de la théorie du droit.
Au vu de cette entreprise, il ne saurait être question de traiter de l’ensemble
de la théorie du droit contemporaine. Notre méthode est autre : elle est de par-
tir d’une théorie du droit particulière – à savoir, le positivisme – pour construire
des relations possibles entre théorie du droit et théorie économique. Plusieurs
raisons militent pour ce choix restrictif : d’abord car le positivisme reste la
théorie spontanée des juristes pour penser leur propre pratique ; ensuite car la
théorie positiviste1est d’emblée une théorie du droit qui vise précisément à iso-
ler le registre juridique des autres registres de la vie sociale2; enfin car
l’économie du droit s’enracine profondément dans la tradition positiviste via
principalement la tradition réaliste américaine. Ainsi, tout en restant dans une
approche positiviste du droit, il est possible à notre sens de dessiner plusieurs
lignes de dialogue largement complémentaires entre analyse économique et
théorie du droit.
Nous développerons cette question en deux points. D’une part, on montre
d’abord que l’analyse économique du droit peut être comprise comme une
réponse à la crise de l’interprétation qui touche la théorie du droit, et notam-
ment la théorie positiviste, depuis un demi-siècle (I. Analyse économique du
droit et crise de l’interprétation). C’est en tout cas ainsi que l’ont envisagée de
nombreux auteurs en économie du droit et en premier lieu Posner (Posner
[1977]). C’est d’ailleurs ainsi qu’elle a parfois été discutée par les théoriciens
du droit (Hart [1977] ; Rosenfeld [2000]). Dans un deuxième temps, nous
montrons alors quelles peuvent être les contributions de l’analyse économique
226 Bruno Deffains, Samuel Ferey
1. Nous employons ici l’expression « la théorie positiviste » sans, bien entendu, sup-
poser que celle-ci est unifiée. Il faudrait davantage parler des positivismes tant ils peuvent
prendre des formes différentes. Cependant, ces théories sont unies par un certain nombre
de préoccupations communes et ce sont celles-ci qui nous intéressent pour le moment
(cf. Jouanjan [2000]). Mais il est clair que, au sein même des réalistes, on trouve de nom-
breuses variantes. Michel Troper remarque lui-même qu’il tente de construire une théorie
réaliste parmi d’autres possibles (Troper [2002-2003], p. 297). De même, l’ouvrage
publié sous la direction de Jouanjan consacré au réalisme s’intitule Théories réalistes au
pluriel.
2. Ce faisant, la Théorie pure du droit dessine deux discours assez distincts quoique
liés : le premier est la théorie générale du droit qui a vocation à expliquer tous les systè-
mes juridiques existant en cherchant ce qui fait la caractéristique fondamentale du phé-
nomène juridique. La seconde est la science du droit qui a vocation à décrire des systè-
mes juridiques particuliers en faisant abstraction des autres discours à propos du droit.
Dans toutes ses œuvres, Kelsen a ainsi cherché à opérer des distinctions entre les phéno-
mènes juridiques, d’une part, et les autres phénomènes sociaux (moraux, économiques,
politiques), d’autre part.
226
S:\53775\53775.vp
mercredi 23 mai 2007 11:57:06
Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite Default screen

du droit dans la construction d’une théorie de l’interprétation juridique1
(II. L’analyse économique du droit comme théorie de l’interprétation juri-
dique). Cela permettra de proposer quelques pistes de recherches futures sur
les rapports qui pourraient se nouer entre économie du droit et théorie du droit
autour d’un diptyque fondamental interprétation/information.
I.ANALYSE ÉCONOMIQUE DU DROIT
I.ET CRISE DE L’INTERPRÉTATION
Comme nous l’avons dit, notre point de départ est la théorie positiviste du
droit. Ce choix peut être discuté, mais il nous semble justifié par plusieurs rai-
sons. La première, c’est que la théorie positiviste, de par sa construction extrê-
mement solide, permet de faire surgir un certain nombre de distinctions struc-
turantes en ce qui concerne l’étude des phénomènes juridiques. La seconde est
que l’analyse économique du droit comme le positivisme juridique ont, par le
biais du réalisme juridique, largement dialogué entre eux. La thèse de cette pre-
mière partie est simplement que l’analyse économique du droit nous semble
être une tentative de réponse à la crise de l’interprétation qui touche la tradition
positiviste depuis les années 1960. Par « interprétation », nous entendons une
opération intellectuelle qui vise à « déterminer le sens d’un texte en vue de pré-
ciser la portée de la règle dans le contexte de son application »2(Frydman
[2005], p. 15). Ainsi, l’interprétation est « l’ensemble traditionnel de questions
relatives aux modalités d’application d’un mot, d’une phrase ou d’un instru-
ment particulier dans un contexte déterminé »3(Cover [1983], p. 7). Dans un
premier temps, nous rappelons quelques éléments structurants du positivisme
juridique. Nous insistons particulièrement sur le fait que, en définissant la
norme de droit comme la signification d’un acte de volonté, le positivisme juri-
dique se trouve devant une tâche redoutable, celle de préciser comment les
autorités chargées de l’interprétation des règles juridiques effectuent ce travail
de reconstruction du sens (A) La norme comme signification d’un acte de
volonté). Dans une seconde partie, nous voudrions alors replacer l’analyse éco-
nomique du droit dans le contexte de la crise de l’interprétation qui a profondé-
ment bouleversé l’ensemble de la théorie du droit depuis les années 1960. En
insistant sur la filiation entre le réalisme juridique et l’analyse économique du
droit, il s’agira alors de montrer que l’on peut considérer l’analyse économique
du droit comme un candidat sérieux à proposer une théorie de l’interprétation
juridique (B) Théorie(s) réaliste(s) et crise de l’interprétation).
Analyse économique 227
1. Nous développons infra la distinction entre théorie de l’interprétation et théorie
de l’interprétation juridique.
2. Souligné par nous. Cette notion de contexte aura une importance déterminante.
3. Ibid.
227
S:\53775\53775.vp
mercredi 23 mai 2007 11:57:07
Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite Default screen
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%