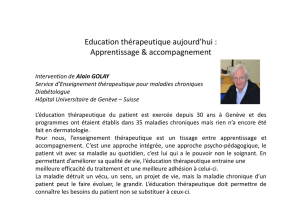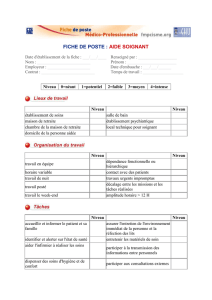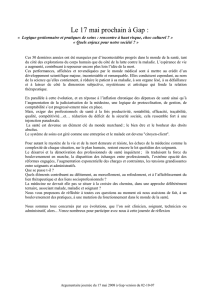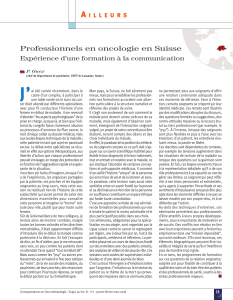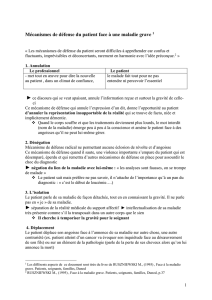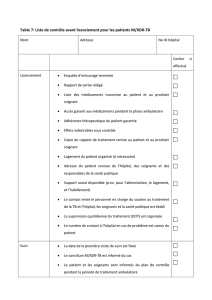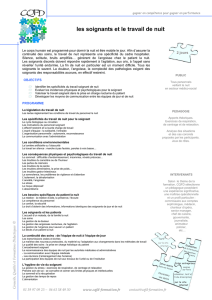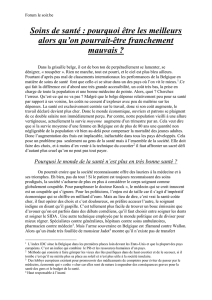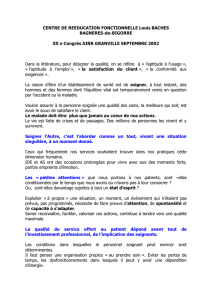Attitude vis-à-vis des

Micheli-du-Crest No 25 CH-1211 Genève 14 Tél. 022 372.90.96 Fax 022 372.91.05
courriel:[email protected] www.hug-ge.ch
Conseil d’Ethique Clinique
Attitude vis-à-vis des médecins et des soignants potentiellement
infectieux pour les malades (HIV, HBV ou C positifs)
Demande d’Avis Consultatif au CEC du Dr Nadia BESSIRE, médecin d’entreprise
des Hôpitaux Universitaires de Genève.
I. Contexte de la demande
Le médecin d’entreprise des HUG, la Docteure Nadia BESSIRE, s’est adressé à la
Commission de l’Infection de l’Institution pour qu’elle lui indique quelles sont ou seraient
les recommandations en Suisse ou dans les HUG à l’égard de cette question. Comme il
n’existe pas à ce jour de réflexion locale ou nationale à ce sujet, la Commission de
l’Infection a proposé au médecin d’entreprise de solliciter l’Avis consultatif de notre
Conseil.
Voici le libellé de la question posée à notre Conseil : « Dans le cadre de ma fonction de
médecin d’entreprise, je peux être amenée à connaître le statut sérologique HIV, hépatite B
(HBV) ou C (HBC) d’un collaborateur des HUG. Toute donnée médicale reste en principe
confidentielle mais, dans le cas d’un collaborateur effectuant des manœuvres invasives vis-
à-vis d’un patient, il existe un risque non négligeable de transmission de la maladie. Dans
ce contexte, il est de la responsabilité de l’hôpital de prendre des mesures pour éviter tout
risque de transmission au patient. Malheureusement, il n’existe pas en Suisse de
recommandations claires concernant l’attitude à avoir face à cette problématique».
Il faut déjà noter que, de façon directe ou indirecte, le Conseil d’Ethique Clinique a déjà été
interpellé à ce sujet :
-1. le 16 juillet 1997, par le Docteur (maintenant Professeur) Jean-François BALAVOINE, qui
posait au Conseil la question suivante « Une personne séropositive (HIV) est-elle, de manière
générale, habilitée à fournir des soins aux patients ? » (CEC, 1997).
Nous avions alors répondu que : « Il nous semble qu’il s’agit de plutôt de savoir si cette personne est ou
non contagieuse, et que, en cas de réponse positive, les précautions adéquates doivent être prises, en
fonction de la situation clinique. L’aspect formel que doivent prendre ces précautions est de nature
technique et leur application résulte d’un contrôle institutionnel. Il s’agit au fond de l’exercice de la
responsabilité de l’institution vis-à-vis des malades qu’elle accepte de prendre en charge. Le problème
d’éthique est donc soit peu visible à nos yeux, soit absent, et la question se déplace vers des réponses soit
d’ordre infectiologique, soit d’ordre institutionnel (politique générale de notre institution, laquelle doit être
définie par le médecin d’entreprise, en harmonie avec les instances traitant des ressources humaines); … »
et, plus loin : « A notre sens toutefois, la réflexion purement éthique, se limite à quelques points :
-premièrement, le malade séropositif et s’occupant d’autrui a un devoir de véracité vis-à-vis de ses
conseillers médicaux, le plus souvent son médecin-traitant, et il doit notamment s’assurer que, dans sa
situation, aucun des gestes qu’il est amené à entreprendre ne met en danger ses malades. Au fond, il
devrait en aller de même pour tout malade séropositif amené à côtoyer autrui (conjoint, crèche,
collègues,...), le risque devant être pesé de cas en cas. Ainsi, la situation du soignant séropositif ne paraît
avoir une spécificité particulière;
-deuxièmement, le médecin au courant de la situation de son malade, a un devoir de solidarité avec
les personnes qui pourraient être mises en danger. A cet égard, la situation nous paraît très proche de celle
qui prévaut quand un malade séropositif refuse ou omet de prendre des précautions lors des rapports
sexuels et d’en informer son/ses partenaire(s). Ici, les devoirs du médecin ont été depuis longtemps discutés

2
dans le détail et une pesée des intérêts peut amener le thérapeute à signaler son malade à une instance
officielle, levant ainsi le secret médical. Toutefois, le risque paraît ici bien mince pour les malades traités par
un soignant séropositif, hormis quelques situations très particulières, mais, encore une fois, l’évaluation de
ce risque n’est pas du domaine de l’éthique, mais du « technique »;
-troisièmement, l’Institution a un devoir de solidarité vis-à-vis de son personnel et doit le soutenir,
notamment en précisant sa politique à l’égard ces questions qui, probablement. Ne se posent pas de façon
exceptionnelle aujourd’hui, en aidant ses employés dans cette situation difficile par une attitude empathique
et constructive. »
-2. l’année suivante, en 1998, le Pr. François CLERGUE (service d’anesthésiologie des HUG)
nous interpellait au sujet de « l'attitude à adopter en cas de contamination d'un membre du
personnel par un liquide biologique potentiellement infectieux (particulièrement avec le VIH)
provenant d'un patient, dans le cadre d'une intervention chirurgicale ». Dans notre réponse, qui ne
se rapportait pas tout à fait à la situation du soignant contaminant, nous insistions toutefois pour
que la personne potentiellement dangereuse pense aux intérêts de la personne contaminée de
façon prédominante, et nous allions, dans notre Avis consultatif, jusqu’à recommander que dans le
cas d’un malade suspect, mais inconscient, un test sérologique puisse être pratiqué (CEC, 1998).
Nous écrivions en effet alors :
« A l'unanimité de ces membres, la commission d'Ethique Clinique émet l’avis consultatif suivant :
L'accord préalable du patient est nécessaire pour pratiquer un test VIH.
Le patient capable de discernement ou son représentant doit être informé qu'en cas de
contamination possible d'une tierce personne, par son sang ou par un autre liquide biologique, une sérologie
VIH sera pratiquée Les patients qui vont subir un acte médical pendant lequel le risque de contamination du
personnel soignant est augmenté (par ex: intervention chirurgicale, accouchement, cathétérisme
cardiaque...) doivent être systématiquement informés de cette pratique.
Les raisons pour lesquelles une sérologie VIH est nécessaire doivent être clairement expliquées au
patient. Un refus de la part du patient de se soumettre en cas de nécessité à un test de dépistage peut
amener les soignants à proposer une prise en charge présentant moins de risque de contagion, même si
elle ne constitue pas le traitement optimal.
Dans le cas des patients amenés inconscients à l'hôpital chez lesquels il est impossible de
demander le consentement, en cas de nécessité le test VIH peut être pratiqué, le patient doit en être
informé dès que possible. (…) ».
-3. Rappelons enfin qu’il existe une Directive Institutionnelle, signée de l’ancien Conseiller
d’Etat GO. SEGOND, datée du 15 avril 1994, intitulée « SIDA et emploi ». Il y est, notamment
écrit que « Etant donné que l’infection par le VIH, en l’absence de symptôme, ne porte pas atteinte à
l’aptitude au travail, la personne concernée n’a aucune obligation d’en informer ses supérieurs ou ses
collègues de travail. Lorsqu’une personne est malade du SIDA, elle est uniquement tenue de donner des
informations si son état risque de compromettre l’exécution du travail en toute sécurité ». Il est vrai que
cette directive peut être comprise, dans la question qui vous préoccupe, de deux façons
différentes : soit elle clôt le débat, le collaborateur potentiellement infectieux est dégagé de toute
obligation vis-à-vis du malade, soit, si l’on en croit la dernière phrase, on pourrait comprendre
qu’un collaborateur mettant un malade à risque de transmission virale « compromet l’exécution du
travail en toute sécurité » et qu’il a l’obligation d’informer le patient et sa hiérarchie. Cette directive,
depuis onze ans, n’a été ni amendée, ni abrogée.
II. Faits médicaux et recommandations de différentes instances
Une estimation fiable du risque de transmission virale pourrait intervenir dans l’analyse éthique de
cette question. En effet, l’importance et la lourdeur des mesures envisageables par une Institution
devraient être mise en perspective : une décision aussi grave qu’une interdiction professionnelle,
même partielle, pourrait dépendre de l’importance du risque concerné.

3
Mentionnons tout d’abord que, dans la population générale (dont les soignants font partie, sauf
qu’ils pourraient présenter, pour les plus anciens d’entre eux, non vaccinés contre l’hépatite B, un
risque HBV plus élevé), la prévalence des individus potentiellement infectants est de < 0.5 % pour
HBV, de 1 % pour HCV et de 0.15 % pour HIV) (Moloughney B, 2001). Des données parcellaires
montrent qu’environ 1 % des chirurgiens sont, au début des années 90’s, HBV positifs (Ristinen,
1998), alors que les taux de HIV et HCV sont équivalents à ceux de la population générale.
Nous disposons de quelques estimations du risque de transmission virale per-opératoire, qui
semble surtout lié à l’activité chirurgicale cardio-thoracique, orthopédique, colo-rectale et
obstétricale (CDC, 1991). Une situation-type de ce type de risque est celle, assez fréquente, lors
de laquelle un chirurgien, surtout en train d’opérer une région peu visible, palpe une aiguille fichée
dans le tissu d’un malade et se blesse, répandant alors du sang dans la cavité opératoire. Cette
situation a été observée dans environ 30 p.cent des cas lors desquels un chirurgien s’est blessé
lors d’une intervention (CDC,1991). Même la précaution consistant à utiliser un double gantage et
à limiter les interventions à celles qui ne présentent pas un risque élevé de transmission ne
mettent pas totalement à l’abri les malades (Schalm S, 2000).
Par ailleurs, le risque de contamination du patient dépend du type de virus :
-1. pour l’hépatite C : après un contact percutané avec une source contaminée, le taux de
séroconversion HCV est de 1.8 % (CDC, 1998). Les conséquences de l’infection à virus HCV sont,
dans 75 à 85 % des cas, l’évolution vers une hépatopathie chronique, dont 10-20 % de cirrhoses
du foie. Au prix d’un traitement d’interféron α-2 pendant au moins trois mois, associé ou non à la
ribavirine, il semble que le passage à la chronicité puisse être réduit (Orland J, 2001 ; CDC, 2001),
voire presque nul (Jaeckel E, 2001). Dans un modèle mathématique tentant d’évaluer le risque de
transmission HBC d’un chirurgien à un patient, le risque est estimé à 2 10-3 ± 2 10-4 % (moyenne ±
écart-type) pour un chirurgien dont l’état sérologique est inconnu ; pour un chirurgien positif pour
HCV-RNA, il se monte à 0.014 ± 0.002 %. Ainsi, le risque de transmission dans au moins une
procédure sur 5000 en dix années d’activité est de 0.9 ± 0.1 % quand le statut sérologique est
inconnu, et de 50.3 ± 4.8 % quand le chirurgien est HCV-RNA positif (Ross, 2000). Ce risque est
similaire à celui d’acquérir une hépatite C lors d’une transfusion sanguine moyennant les
précautions actuelles, les « précautions standard » (Koerner, 1998). Il est par ailleurs intéressant
de mentionner que, dans l’industrie, un risque de décès supérieur à 1: 10'000 procédures risquées
ou non par année est considéré comme inacceptable (Poole C, 1997 ; Calman, 1996). Il n’existe
pas de vaccin à ce jour qui permettrait une prophylaxie du virus HCV.
-2. pour l’hépatite B : tout d’abord, il convient de rappeler que le risque de transmission du virus de
l’hépatite B est de 30 % lors d’une piqûre d’une personne avec une aiguille contaminée par du
sang d’un tiers présentant une sérologie positive HBVeAg, ce facteur de risque représente donc
un risque très considérable.
Il en va de même chez les malades avec une biopsie hépatique montrant la présence de l’antigène
HBV-DNA ou de l’antigène HBVc sur leurs hépatocytes. Récemment, il a été montré qu’environ 20
% des malades porteurs du virus B (HBsAG +), mais HBVe négatifs, pouvaient être tout de même
infectants s’ils étaient porteurs de virus B avec une mutation sur le codon 28 precore ou encore
chez des patients porteurs d’autres mutations (Boxall E, 1997). De plus, la prophylaxie de
l’hépatite B par des immunoglobulines spécifiques est efficace (NACI, 1998). En revanche, le
risque général de transmission HBV d’un soignant à un malade est très mal connu. Il est
probablement très bas, bien qu’un auteur estime que ce risque se monte à 1 : 1000 procédures
(Poole C, 1999) ou 1 : 2300 (Ross, 2002), chiffres contestés par d’autres auteurs (Eddleston A,
1997) qui disent que ce risque, quoique peu évaluable, est « extremely low » (Beltrami, 2000).
Actuellement, il n’existe pas de preuve qu’un traitement post-exposition ou dans le contexte d’une
hépatite B habituelle, soit efficace. Un traitement de lamivudine n’est donc recommandé qu’en cas
d’hépatite B aiguë particulièrement sévère (CDC, 2001). Toutefois, le traitement antiviral permet de
réduire considérablement la charge virale et il pourrait rendre non contagieux un membre du
personnel jusque là potentiellement infectant, dans la mesure ou, par PCR (polymerase chain
reaction), plus aucune copie virale ne serait détectable. Une limite de 0.5 à 1.0 105 ml-1 copies a

4
parfois été proposée comme limite supérieure permettant une activité chirurgicale « à risque »
(Schalm S, 2000). Enfin, et ceci est très important, il existe un vaccin très efficace et pratiquement
sans danger permettant la prophylaxie de l’hépatite B. Ceci va nous mener à la discussion des
aspects éthiques de la vaccination obligatoire du personnel à l’embauche dans les HUG.
-3. pour le virus HIV : le risque de transmission HIV est dix fois moindre que celui de la
transmission HBV, surtout HBVe. Il est évalué à 0.3 % (CDC, 1991) et il est considéré comme
« très bas » par le CDC (Robert L, 1995). De plus, la prophylaxie post-exposition est efficace : elle
réduit de > 90 % le risque d’évolution vers la maladie. Il n’existe pas de vaccin à ce jour qui
permettrait une prophylaxie du virus HIV.
Une recommandation du Center for Disease Control and Prevention (CDC), datant de 1991
(CDC, 1991), dit que :
« Investigations of HIV and HBV transmission from health care workers (HCWs) to patients indicate that,
when HCWs adhere to recommended infection-control procedures, the risk of transmitting HBV from an
infected HCW to a patient is small, and the risk of transmitting HIV is likely to be even smaller. However, the
likelihood of exposure of the patient to an HCW's blood is greater for certain procedures designated as
exposure-prone (i.e. colorectal, cardio-thoracic and obstrical surgery). To minimize the risk of HIV or HBV
transmission, the following measures are recommended:
-1. All HCWs should adhere to universal precautions, including the appropriate use of hand
washing, protective barriers, and care in the use and disposal of needles and other sharp instruments.
HCWs who have exudative lesions or weeping dermatitis should refrain from all direct patient care and from
handling patient-care equipment and devices used in performing invasive procedures until the condition
resolves. HCWs should also comply with current guidelines for disinfection and sterilization of reusable
devices used in invasive procedures.
-2. Currently available data provide no basis for recommendations to restrict the practice of
HCWs infected with HIV or HBV who perform invasive procedures not identified as exposure-prone,
provided the infected HCWs practice recommended surgical or dental technique and comply with universal
precautions and current recommendations for sterilization/disinfection.
-3. Exposure-prone procedures should be identified by medical/surgical/dental organizations and
institutions at which the procedures are performed.
-4. HCWs who perform exposure-prone procedures should know their HIV antibody status.
HCWs who perform exposure-prone procedures and who do not have serologic evidence of immunity to
HBV from vaccination or from previous infection should know their HBsAg status and, if that is positive,
should also know their HBeAg status.
-5. HCWs who are infected with HIV or HBV (and are HBeAg positive) should not perform
exposure-prone procedures unless they have sought counsel from an expert review panel (The
review panel should include experts who represent a balanced perspective. Such experts might include all of
the following: a) the HCW's personal physician(s), b) an infectious disease specialist with expertise in the
epidemiology of HIV and HBV transmission, c) a health professional with expertise in the procedures
performed by the HCW, and d) state or local public health official(s). If the HCW's practice is institutionally
based, the expert review panel might also include a member of the infection-control committee, preferably a
hospital epidemiologist.) and been advised under what circumstances, if any, they may continue to
perform these procedures. Such circumstances would include notifying prospective patients of the
HCW's seropositivity before they undergo exposure-prone invasive procedures.
-6. Mandatory testing of HCWs for HIV antibody, HBsAg, or HBeAg is not recommended. The
current assessment of the risk that infected HCWs will transmit HIV or HBV to patients during exposure-
prone procedures does not support the diversion of resources that would be required to implement
mandatory testing programs. Compliance by HCWs with recommendations can be increased through
education, training, and appropriate confidentiality safeguards. »
Il est intéressant de noter que, depuis que ces précautions ont été diffusées aux Etats-Unis, il n’a
plus été rapporté en cinq années aucun cas de transmission HIV et seulement un rapport de
transmission de l’infection HBV, à partir d’une unique source, mais à plusieurs malades, dans ce
pays (1991-1996) (Harpaz, 1996).
Des directives plus récentes, italiennes, sont plus contraignantes pour les
médecins/soignants (Mele A, 2001). Elles disent ce qui suit :

5
« The recommendations can be summarised as follows: all healthcare workers must undergo hepatitis
B virus vaccination and adopt the standard measures for infection control in hospitals; healthcare workers
who directly perform invasive procedures must undergo serological testing and the evaluation of
markers of viral infection. Those found to be positive for: 1) HBsAg and HBeAg, 2) HBsAg and hepatitis
B virus DNA, or 3) anti-hepatitis C virus and hepatitis C virus RNA must abstain from directly performing
invasive procedures; no other limitations in their activities are necessary. Infected healthcare workers are
urged to inform their patients of their infectious status, although this is left to the discretion of the
healthcare worker; whose privacy is guaranteed by law. If exposure to hepatitis B virus occurs, the
healthcare worker must undergo prophylaxis with specific immunoglobulins, in addition to vaccination. »
D’autres directives ont été publiées par différentes instances (UK Department of Health, 1993 ;
American Medical Association, 1991 ; AIDS/TB Committee, 1997 ; LCDC, 1998). Elles sont
généralement de nature indicative, essentiellement parce qu’il est très difficile de définir quelles
devraient être l’autorité exécutive et l’autorité de contrôle, et parce que leur application pose des
problèmes pratiques difficiles (Magnavita M, 2003). De plus, quelques auteurs, comme DANIELS
(Daniels, 1992 ) ont relevé que ces directives n’étaient pas toujours cohérentes entre elles et
qu’elles pouvaient être source d’abus ou d’illusion quand elles mettaient trop en exergue
l’information aux patients exposés. Citons ici cet auteur : « The ethical controversy surrounding the
Centers for Disease Control (CDC) and American Medical Association (AMA) guidelines for restricting the
practice of HIV-infected health professionals appears to hinge on whether we give priority to the rights of
infected workers or patients. We cannot simply dismiss the concerns of patients as irrational, despite the low
risks of transmission. Nor can we avoid the dispute about rights by claiming with the AMA that professionals
have obligations to refrain from imposing "identifiable risks," however low, on patients. Nevertheless,
allowing the full exercise of patient rights, either by giving patients the opportunity to know the risks they face
and to switch providers, or by removing infected providers (compulsory switching), would make each of us
worse off. This gives us adequate reason to reject these guidelines and to emphasize other infection control
measures. »
Une Directive de l’Union Européenne (Directive 89/361, 1989) stipule que l’employeur doit, en
cas de travail dangereux pour un employé, reconnaître formellement ce risque, alors que l’employé
ne peut être exposé au risque que dans des cas exceptionnels, après l’accord d’une tierce partie
(généralement un service médical extérieur qui ne doit pas être le médecin de l’entreprise). Ceci
concerne, il est vrai, plutôt le risque qu’encoure un médecin qui traiterait un malade contagieux
que l’inverse. Toutefois, cette Directive montre que l’entreprise ne peut pas rester en marge d’une
activité dangereuse se déroulant en son sein.
Enfin, en cas d’exposition accidentelle aux virus HBV, HCV et HUV, un traitement est souhaité. En
effet, une recommandation du Center for Disease Control and Prevention (CDC), datant de
2001 (CDC, 2001), dit que : « Recommendations for HBV postexposure management include
initiation of the hepatitis B vaccine series to any susceptible, unvaccinated person who sustains an
occupational blood or body fluid exposure. Postexposure prophylaxis (PEP) with hepatitis B
immune globulin (HBIG) and/or hepatitis B vaccine series should be considered for occupational
exposures after evaluation of the hepatitis B surface antigen status of the source and the
vaccination and vaccine-response status of the exposed person. Guidance is provided to clinicians
and exposed HCP for selecting the appropriate HBV PEP.
Immune globulin and antiviral agents (e.g., interferon with or without ribavirin) are not recommended for
PEP of hepatitis C. For HCV postexposure management, the HCV status of the source and the exposed
person should be determined, and for HCP exposed to an HCV positive source, follow-up HCV testing
should be performed to determine if infection develops (Notons que, comme nous l’avons mentionné plus
haut, cette directive peut être contestée au vu d’études postérieures à cette recommandation, études qui
proposent l’administration d’interferon 2b).
Recommendations for HIV PEP include a basic 4-week regimen of two drugs (zidovudine [ZDV] and
lamivudine [3TC]; 3TC and stavudine [d4T]; or didanosine [ddI] and d4T) for most HIV exposures and an
expanded regimen that includes the addition of a third drug for HIV exposures that pose an increased risk for
transmission. When the source person's virus is known or suspected to be resistant to one or more of the
drugs considered for the PEP regimen, the selection of drugs to which the source person's virus is unlikely to
be resistant is recommended.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%